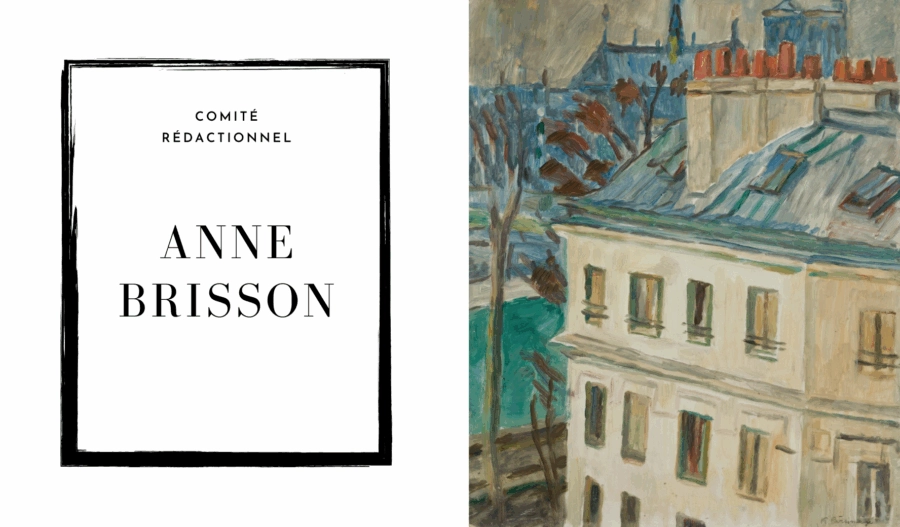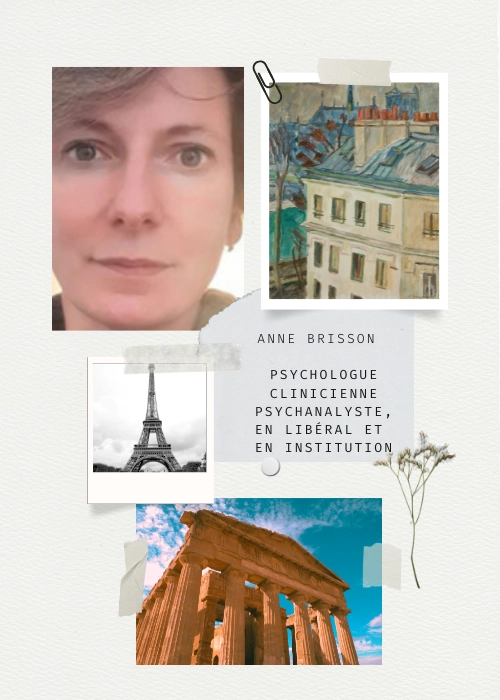Empathie
Le mot est en vogue et le concept océanique : vaste, mouvant, profond et difficile à délimiter. Ce qu’il recouvre existe sans doute depuis les origines de l’homme. C’est en tout cas ce que raconte le Pr David Lordkipanidze, paléontologue, dans un documentaire[1] sur la préhistoire en Asie.
En 2005, son équipe découvre dans le contrefort des montagnes du Caucase, sur le site de Dnanisi, des fossiles humains datant de 1,8 millions d’années. Un courant de lave volcanique venu du Sud de la Géorgie a déposé sur ce site un ensemble de fossiles, ce qui a constitué une « capsule temporelle » qui permet de reconstruire aujourd’hui le comportement et l’environnement de ces humains du passé.
Ainsi les paléontologues identifient une famille composée d’un jeune adolescent, d’un adolescent, d’une adulte et d’un individu très âgé. Le crâne du vieillard est retrouvé avec une mâchoire qui indique qu’il avait perdu toutes ses dents durant sa vie et qu’il avait donc vécu 2 ou 3 ans totalement édenté.
Cet individu très âgé ne pouvait par conséquent se nourrir seul, les autres membres du groupe familial l’ont probablement nourri pour lui permettre de survivre. Pour le Pr Lordkipanidze, c’est le signe que lors de ces temps très anciens, notre genre « Homo » avait à cœur de s’occuper des siens.
L’empathie telle qu’elle se manifeste entre les générations, des plus autonomes vers les plus dépendantes, existe dès la préhistoire.
Elle est depuis fort longtemps un ingrédient nécessaire de toutes les interactions et relations entre les hommes, y compris dans le domaine du soin. Mais alors, est-il encore possible de faire du neuf avec un phénomène existentiel vieux de 2 millions d’années…
Si l’on se penche sur les découvertes scientifiques les plus récentes, on s’aperçoit très vite que les neurosciences n’ont pas encore fait le tour du sujet.
Une petite distinction s’impose avant d’aller plus loin. L’empathie est la capacité à partager et comprendre les états émotionnels et affectifs des autres, elle permet une coexistence harmonieuse des individus en motivant de nombreux comportements prosociaux.
La sympathie est la capacité à ressentir une motivation orientée vers le bien-être des autres, elle fournit une base affective au développement moral chez l’enfant, elle joue un rôle essentiel dans les interactions sociales.
Empathie et sympathie sont des états affectifs et motivationnels distincts qui mettent en jeu des circuits neuronaux en partie indépendants suivant des trajectoires neurodéveloppementales spécifiques.
Et pourtant c’est bien la combinaison des deux qui rend l’homme profondément… humain !
Comme l’explique Jean Decety (professeur de psychologie, psychiatrie et neurosciences), la connaissance des circuits neurophysiologiques qui sous-tendent ces deux concepts est encore incomplète et laisse des énigmes à résoudre : « Assurément, les comportements associés ou déclenchés par ce que les psychologues et biologistes appellent « empathie » et « sympathie » sont hétérogènes à l’extrême, allant du mimétisme à l’altruisme, en passant par la contagion émotionnelle, la compréhension des sentiments et des émotions des autres, la compassion, la cruauté, etc. »[2]
Par ailleurs, essayer de comprendre les perturbations de l’empathie chez l’homme implique de s’intéresser à sa construction à l’intérieur de chacun au cours du temps : cela « nécessite un examen du développement neuropsychologique de l’enfant, incluant les aspects endocriniens et hormonaux, la physiologie du système nerveux autonome, les facteurs génétiques et leurs interactions avec le contexte psychologique et social »[3]. Autant vous dire que ni la greffe d’empathie ni la pilule compensatrice ne sont encore d’actualité.
Dans le champ de la psychanalyse, l’empathie n’est pas tout à fait la même que celle qui se manifeste dans la vie quotidienne, puisqu’elle participe à l’action thérapeutique. Pour Freud, elle est la voie qui mène à la compréhension d’une autre vie psychique, car elle favorise le processus par lequel nous parvenons à comprendre « ce qui est étranger au moi chez d’autres personnes ».
Pour le dire autrement, l’empathie nous aide à entendre ce que l’autre nous dit mais qu’il ne comprend pas lui-même, elle donne accès à la partie inconsciente de la psyché.
L’empathie est ensuite complétée par l’adjectif « métaphorisante » grâce à Serge Lebovici qui, depuis sa pratique du psychodrame dans les années cinquante jusqu’aux consultations parents-bébé, utilise ce concept pour traduire le jeu psychique et émotionnel qui anime les interactions vécues par les thérapeutes et leurs patients.
Dans le psychodrame comme dans le travail avec les bébés, ce qui est thérapeutique, c’est de favoriser le jeu des représentations pour relancer un fonctionnement mental qui n’a pas les moyens de retrouver ou de créer des figurations.
C’est Winnicott qui le premier a mis l’accent sur le « jeu » dans la relation thérapeutique, un jeu qui ne relève ni de la réalité psychique intérieure ni de la réalité extérieure : il se situe dans un espace transitionnel, un terrain commun, une aire partagée, où le patient et le thérapeute jouent ensemble car le jeu organise la symbolisation, favorise la créativité, produit du sens.
L’expérience du psychodrame permet à Serge Lebovici d’expliquer que l’art du psychothérapeute s’exprime avant tout dans la « création de véritables raccourcis dramatiques qui font la preuve de son intuition ».
Dans le psychodrame, intuition et empathie permettent au thérapeute de se représenter le jeu psychique du patient, de s’identifier à lui, car il est touché et mis en mouvement par les pensées et les affects du patient. En s’identifiant de manière empathique, il laisse surgir en lui des images et des mots qui donnent du sens à ce que le patient lui a transmis en deçà du langage.
Dans les consultations parents-bébé, Serge Lebovici fait une nouvelle expérience, celle de l’énaction, moment pendant lequel le psychothérapeute éprouve dans son corps une émotion, qui n’est pas agie, mais qui est créatrice de nouvelles capacités représentatives et métaphoriques. Il existe alors une mobilisation du corps vers la psyché qui fabrique une capacité à jouer et à penser, car l’empathie métaphorisante réunit l’affect et la représentation.
Je vous propose maintenant un glissement (associatif) de la métaphore à la fable.
Dans une émission de France Inter sur l’inconscient[4], la psychanalyste qui essaie de comprendre la violence dans le couple, fait un détour par une fable de La Fontaine, « le Scorpion et la Grenouille » : le scorpion demande de l’aide à la grenouille pour traverser une rivière.
Elle commence par refuser par crainte, à juste titre, d’être piquée. Le scorpion proteste et lui dit qu’il mourra noyé en même temps qu’elle s’il l’empoisonne.
Elle accepte donc de lui rendre service, mais au milieu de la rivière, il la pique, car c’est plus fort que lui, il obéit à sa nature.
J’éprouve la puissance de la fable qui, en quelque vers, met en scène l’idée que l’homme est soumis à des motivations inconscientes qui vont à l’encontre de ses intérêts. La nature profonde, obscure et cachée de l’homme lui fait faire des choses qui vont jusqu’à le conduire à l’autodestruction.
Intriguée par la façon très percutante dont l’élaboration d’un thème est véhiculée par la fable, je cherche dans la production de La Fontaine une référence à l’empathie. Et je trouve la fable du « Satyre et du Passant » dans laquelle La Fontaine met en lumière deux freins à l’empathie : la conformité aux normes sociales et l’égocentrisme.
En effet, un satyre et sa famille invitent un passant à partager leur repas. Je vous laisse découvrir le texte par vous-même, je reviens simplement sur la chute qui dévoile que le satyre accueille le passant parce qu’il agit par conformisme, sans conviction ni sincérité, et que le passant accepte l’invitation de manière opportuniste, en restant centré sur ses besoins et sans manifestation de reconnaissance.
Ainsi pour La Fontaine, la véritable empathie, telle qu’elle se manifeste dans la vie quotidienne, est un profond intérêt pour autrui sous une forme pure qui ne doit se mélanger ni avec ce que l’on fait par conformisme, ni avec ce que l’on ne fait qu’en pensant à soi.
Deux écueils que ne connaissaient sans doute pas les premiers hommes trop occupés à survivre et que savent éviter les soignants quand ils vivent l’empathie métaphorisante dans cette situation si particulière de la relation thérapeutique.
[1] Préhistoire en Asie : l’aventure humaine, documentaire réalisé par Thomas Cirotteau
[2] Jean Decety, « Mécanismes neurophysiologiques impliqués dans l’empathie et la sympathie » in Revue de neuropsychologie, 2010/2.
[3] Idem
[4] Emission L’inconscient, France Inter, épisode du 5 mai 2024 avec Laurie Laufer, « Pourquoi la violence dans le couple ? »