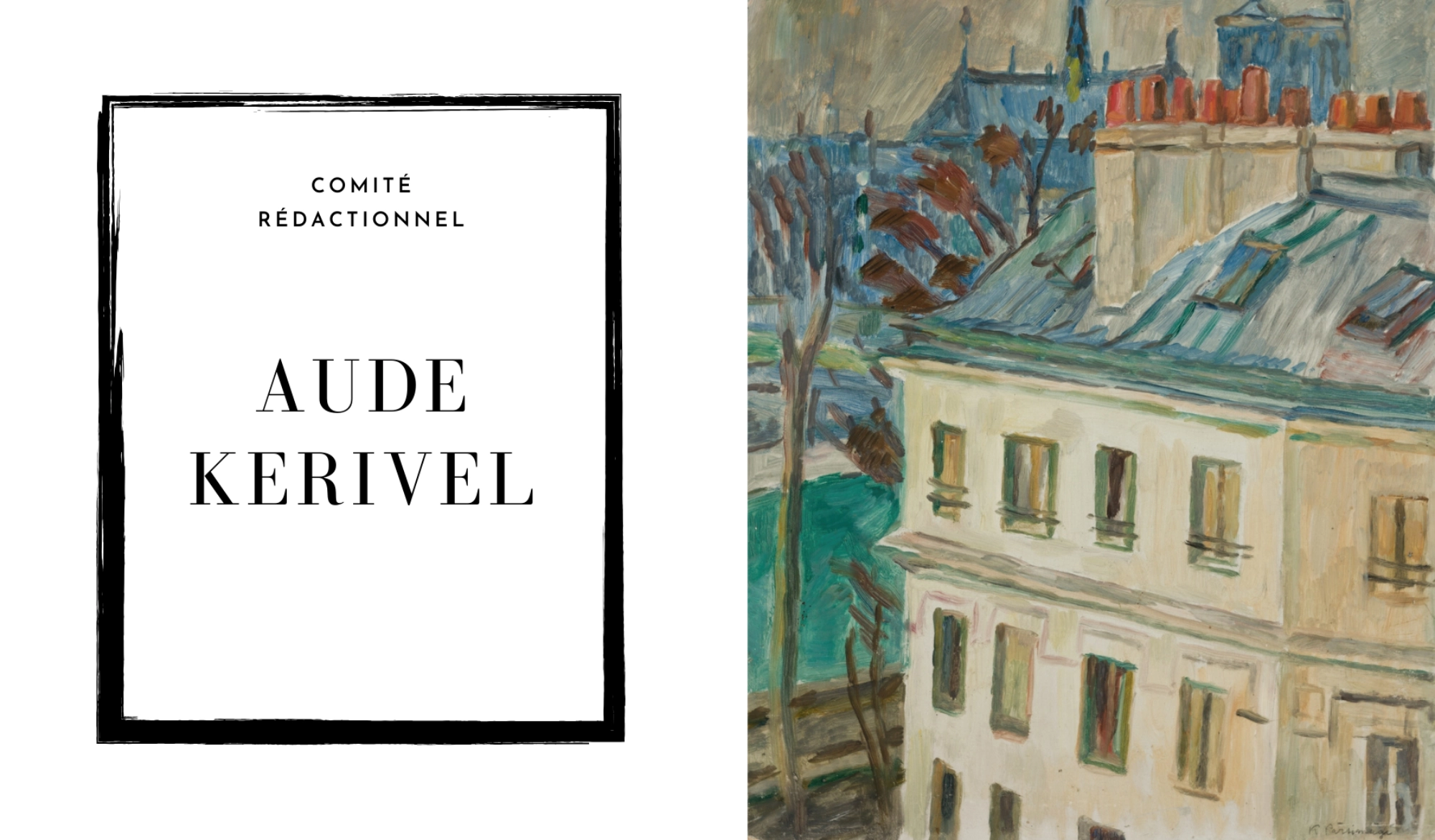Il pose son petit pied, se tenant prudemment à l’embrasure de la porte fenêtre puis bascule son derrière tout entier avant d’enfin arriver, avec une grande satisfaction à passer descendre dehors.
Mais à peine franchi, Simon fait demi-tour et re-franchit avec un petit peu plus d’assurance, cette marche qui sépare le salon de la terrasse. « Quand nous sommes arrivés dans cette maison, Clauduis (le fils de mes amis chez qui nous sommes) avait quoi 2 ans, 1 an et demi, l’âge de Simon ? Je ne me rappelle plus… On oublie ce moment juste avant qu’ils n’apprennent à marcher ».
« J’ai l’impression que les gens qui ont eu des enfants oublient vite » cette phrase a aussi été prononcée par mon ami Krystel mais pour d’autres raisons. Elle souffre des conseils bienveillants qui peuvent parfois s’apparenter à des reproches concernant sa façon de porter son bébé de 4 mois. Une affirmation qui rejoint une devise que nous avons faite nôtre avec mon amie Magali : les parents qui disent que leurs bébés font leur nuit sont des menteurs ! Ou plutôt, ils ont oublié très rapidement les nuits entrecoupées de pleurs de leurs nourrissons.
« Tu dois être heureuse de retrouver une vie intellectuelle » m’ont dit mes collègues, ma cheffe, mon directeur, lorsque je suis retournée au travail après 3 mois et demi de congé maternité.
Par cette phrase de bienvenue, ils sous-entendaient que ma vie intellectuelle s’était arrêtée au moment ou un enfant était sorti de mon ventre, me renvoyant soudainement au statut d’animal qui ne pense pas.
Comment peut-on oublier, dans un institut de recherche en sociologie que l’homme et la femme et que même les bébés sont des êtres sociaux, en interaction avec ce qui les entourent qui les invitent en permanence à se positionner, penser ?
« Ne pas oublier » « témoigner de ma vie intellectuelle de maman » tels ont été les points de départ d’un journal que j’ai tenu pendant les premières années de mon fils et dont je vais vous partager quelques extraits.
Nous passons beaucoup de temps à regarder les fleurs. Avant de l’emmener chez la nounou, nous passions au square, lui en porte-bébé devant moi, les yeux face au monde, moi mon sac avec mon ordinateur, mes talons. Nous passons devant les fleurs, je lui décris, il regarde.
Plus tard lorsqu’il a commencé à se tenir assis, au parc nous nous asseyons devant les fleurs, il regarde, je lui parle des couleurs. Rapidement il a envie de toucher. Doucement, on caresse. Maintenant qu’il marche en se tenant toujours à la main d’un adulte qui acceptera avec bienveillance de l’accompagner dans ses aventures, il va vers les fleurs.
Aujourd’hui, il m’amène vers un parterre de fleurs rouge et jaune vif. Il décide de s’assoir devant les fleurs rouges, touche les pétales avec délicatesse. Une fleur est par terre, je la ramasse et la lui donne. Il la prend la regarde, puis la repose délicatement sur une tige à côté d’autres fleurs. Il ne sait pas encore que les fleurs coupées ne refleurissent pas.
Avoir la maîtrise de son temps, un privilège des classes aisées. Être bien payé, pouvoir déléguer certaines tâches… Et avoir la chance de passer du temps à transmettre, éduquer, accompagner, regarder, donner, recevoir. Pouvoir prendre le temps de le laisser essayer de manger seul (en comprenant le temps de nettoyage de la table, du sol, de la chaise de haute, du bébé et de ses propres vêtement). Aller l’endormir en sachant que l’on n’est pas pressé.
Avoir du temps disponible. Être maître de son temps. Je prends la mesure de ce privilège. Bernard Lahire, dans son ouvrage Enfances de classe, parle des contextes et conditions de vie qui font que l’enfance est très loin d’être une expérience homogène. Bien sûr on pense aux capitaux économique, culturel, social, mais moins « au temps disponible ».
Il y a les tâches que l’on peut déléguer, à un agent d’entretien (homme ou femme de ménage) par exemple, au traiteur ou restaurateur. Il y a aussi la maîtrise de l’organisation de son temps.
Je pense tout de suite à ces femmes (et hommes) que j’ai rencontrés en formation auxiliaire de vie sociale (personnes qui s’occupent de personnes âgées, handicapées, ou d’enfants à domicile et font parfois également la cuisine et/ou le ménage pour ces mêmes personnes).
Leurs journée commencent souvent très tôt et finissent souvent très tard. Entre chaque personne chez qui elles restent souvent plus qu’elles ne sont payées (les organismes vendent parfois des prestations à la tâche et non à l’heure. Soit faire le petit déjeuner = 10 minutes. Sans considérer, qu’il faut aider la personne à se lever, à aller aux toilettes, éventuellement à faire une petite toilette du visage, à ouvrir les rideaux ou les volets, prendre des nouvelles…) il y a du transport (non rémunéré) avec des distances parfois longues à parcourir en bus, métro ou autre.
La journée de 8h00 ou 6h00 s’étends sur 12h00. Peu de temps pour son ou ses enfants. A l’inverse, celui qui peut travailler de chez lui, organiser son temps, finir le soir quand son enfant est couché, ne pas prendre de pause déjeuner, ou encore travailler moins tout en ayant un salaire décent. On entend souvent : les « enfants livrés à eux-mêmes» rendant coupables des parents alors qu’ils sont d’abord victimes d’un système.
« Elle fait beaucoup d’enfants pour toucher les allocations », « il existe une corrélation entre la taille de la fratrie et l’échec scolaire », « ces mères (de classes populaires) préfèrent garder leurs enfants avec elles malgré tout ce qui est fait pour assurer une place en crèche à leur enfant ».
Stéréotypes, discours scientifiques et politiques ne m’ont pas préparée à cette expérience. Est-ce parce qu’au fond – même si j’évolue aujourd’hui dans un milieu social privilégié – je suis issue d’une classe plus modeste, que je préfère moi aussi pendre soin de mon enfant avant qu’il entre à l’école plutôt que le mettre en crèche (même si j’ai la chance inouïe d’avoir une place en crèche !).
Dans cette logique de suspicion trop fréquente vis-à-vis des familles de milieu populaire, jamais n’est évoqué l’immense bonheur de s’occuper et de voir grandir un enfant et le sentiment de perte de temps lorsqu’on n’est pas avec lui, et plus encore lorsque l’on fait quelque chose de peu intéressant, d’inutile.
« S’il ne lâche pas encore la main quand il marche c’est parce que sa maman lui donne encore la tétée », c’est l’analyse (documentée) de l’oncle de mon compagnon, qui a sans doute un CAP petite enfance, qu’il a dû faire entre le moment où il a eu ses enfants, il y a 50 ans, enfants dont il n’a jamais changé la couche et aujourd’hui.
Analysons plus précisément cette phrase représentative d’un nombre incalculable de conseils et remarques prodigués par des proches ou des illustres inconnus depuis que ce petit être est sorti de mon ventre (d’ailleurs même avant lorsque mon futur statut de mère est visible aux yeux du monde).
D’abord, l’injonction à la rapidité à acquérir compétence et autonomie rapidement et selon un calendrier normalisé. « Il ne marche pas encore », sous-entendu, il est en retard. A ce propos, il a déjà 4 ou 5 mois. Ma voisine me croisant dans l’escalier formulait l’analyse suivante : « Petit feignassou qui ne marche pas encore, c’est parce que ta maman te porte trop ».
Deux hypothèses formulées comme des vérités. Alors mon fils ne marche pas encore a/parce que je l’allaite encore, b/parce que je le porte trop. Dans les deux cas il semble que je sois la personne responsable de cette déviance ou marginalité. (Le contraire de la normalité) c’est donc déviance, marginalité, anormalité soit « la maman » qui prend dans les bras, qui allaite encore.
La remarque n’est pas directe, c’est une suggestion déguisée. On ne s’adresse pas à elle, on s’adresse au mieux à l’enfant mais pas à la mère. Serait-ce plus ou moins violent ? La mère donc, c’est moi. Moi qui allaite trop tard, prends trop dans les bras, sors trop dehors, a trop couvert, n’a pas assez couvert, n’a pas nourri. « Il a faim » est la principale interprétation des pleurs d’un nourrisson. Sous-entendu : faites-le taire, donnez-lui à manger. Mais pas le sein, c’est trop provoquant en pleine rue. S’il pleure c’est de votre faute.
J’en rigole, mais à chaque remarque, je m’imagine la maman isolée, un peu fragile, en dépression ou fatiguée. Comment aurait-elle réagi face à l’échange (imaginaire) de cette voisine avec mon fils : « Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi tu pleures, ta maman elle t’a tapé ? » ou pire encore « Il pleure moins, au début je pensais que c’était un enfant martyr ».
Ces remarques, me laissent le plus souvent sans voix. Je me surprends à me justifier.
– Il a faim ?
– Je ne pense pas, je viens de lui donner à manger.
Malheureuse que je suis à tenter de me justifier gentiment, le passage continue.
– Vous l’allaitez ?
(Et moi je réponds, en quoi cela la regarde…)
– Oui
– Mais qu’est-ce que vous avez mangé ce matin ?
La question est tellement surprenante, elle me fait perdre tous mes moyens. J’en oublie ce que j’ai mangé le matin. Prise la main dans le sac, de la mauvaise élève qui en plus n’a pas révisé.
Cette manie de dire ce que l’on pense à la mère-de la mère, de manière indirecte en parlant à l’enfant…. D’où est-ce que cela vient ?
Il prend mon doigt, ma main et m’emmène avec lui explorer le monde. Le parc ou simplement l’appartement. Il veut que je me lève, se met à pleurer, car je ne comprends pas ou fais mine de ne pas comprendre. Il est 20h30, tu dois dormir, rester dans ta chambre plutôt que de faire le tour de l’appartement. Tu as soif de voir le monde, de découvrir.
Tu es à deux doigts de t’endormir allongé dans ton lit. Puis malgré la fatigue, tu te relèves, il faut que tu ailles vérifier la tache sur la tête de la petite vache de ta ferme, ou encore la roue de ce camion avec lequel tu as joué toute la journée, l’étiquette du coussin de ta chaise haute. Puis après une étude minutieuse de l’objet ou une dernière vérification, tu retournes te coucher cette fois, sans doute rassuré ou véritablement fatigué peut-être
40 % des femmes diplômées allemandes n’ont pas d’enfants. L’explication ?
Une injonction forte à s’arrêter de travailler les premières années de la vie de l’enfant, puis à s’investir activement dans les associations de parents d’élèves, les loisirs des enfants et un monde du travail extrêmement discriminant qui empêche toute carrière.
Lorsqu’elles partent en congé maternité, les femmes allemandes ne retrouvent pas leur emploi. Je pense à Angela Merkel. Sa page Wikipédia mentionne qu’elle n’a pas d’enfants. Il faut donc choisir entre carrière et procréation. En Allemagne plus qu’en France. En même temps Ségolène Royal n’a pas été élue présidente, et on lui a demandé « Qui allait s’occuper des enfants ». Et les pères dans tout ça ? Il n’en est pas question.
Pour la première fois, ce soir c’est Thomas qui a endormi Simon. Il pensait que c’était impossible car « il n’a pas les arguments » pour ne pas dire « de lait ». Pourtant depuis quelques mois, je lui dis que je suis certaine qu’il pourra endormir Simon.
Ce soir, j’explique que je dois absolument répondre à des emails afin de ne pas complètement perdre ma crédibilité professionnelle fortement entachée par mon statut de mère. Thomas sent que je suis stressée, il s’exécute. Je reviens 3h/4h plus tard. « Il s’est appuyé contre moi, je lui ai lu deux fois la même histoire, il s’est endormi, il est tellement mignon ». Et voilà. Il s’agissait de le faire une fois. La fierté du papa. Évidement une fois ce n’est pas assez pour impacter une carrière professionnelle.
En lisant un ouvrage sur le capital social pour l’écriture d’un article je tombe sur ce paragraphe, que je n’aurais pas relevé si je n’avais pas d’enfant…
« En France, la production domestique représentait près de 43 milliards d’heures ouvrées quand le travail professionnel en consommait seulement 35 milliards d’après une estimation de 1975 et le travail domestique ayant plutôt tendance à croître et le travail professionnel à diminuer, l’écart s’est accru depuis cette date. Des substitut marchands sont envisageables, par acquisition de produits ou services ou en recourant à du personnel domestique, mais l’essentiel du travail repose sur la main-d’œuvre « gratuite » que constituent les membres du foyer ou les personnes que celui-ci arrive à mobiliser pour l’aider »[1]
« Il est intéressé par les camions, c’est bien un garçon ! ». Il aime aussi beaucoup les fleurs, mais cela n’entraîne pas de type de remarques genrées. Il s’intéresse à beaucoup de choses, simplement nous prêtons seulement attention à celle qui nous permettent de nous convaincre de nos catégories. Non il ne « charme » pas les demoiselles, il répond au sourire, qui – il est vrai – sont plus souvent adressé par les femmes que par les hommes qu’il croise dans la rue !
Deux prémolaires ont poussé cette nuit. Il a pleuré une grande partie de la nuit, rien ne pouvait le calmer, les jouets, les livres, l’aspirateur, le panier à salade, le sein, les bras, notre lit, ses peluches rien. Fatigué toute la journée, et pourtant ce soir comme hier soir, je veux que ce moment de bonheur reste gravé dans ma mémoire. Comme chaque soir, je lui lis une histoire puis lui chante des berceuses, souvent il joue un peu, vient écouter l’histoire puis vient se blottir contre moi pour s’endormir, mais depuis deux jours, il se hisse debout en se tenant à mes genoux, et fière et heureux se lâche.
Les bras de côté tel un surfeur, ou en l’air, il tient l’équilibre, me regarde, souri satisfait de lui-même me prenant à témoin, puis se laisse tomber sur les fesses. J’applaudis, il est heureux et recommence, se hisse debout me regarde tient l’équilibre quelques secondes de plus, rigole, se laisse tomber. Il recommence, avec cette joie de la première fois, de la découverte. Plus je l’applaudis, plus il est heureux. Maintenant ce n’est plus les mains de côté mais en l’air, il rigole, semble oublier la douleur des dents qui poussent.
J’ai lu beaucoup de livres sur la place de l’enfant, l’évolution de la place de l’enfant dans la famille. Pendant 15 ans j’ai donné des cours à ce sujet, à l’université, mais aussi en école de travail social, auprès de professionnels de la petite enfance. J’avais en face de moi des étudiants professionnels de la petite enfance, parents pour beaucoup d’entre eux. Et pourtant personne ne prenait la parole pour parler de cette expérience de parent. De ce tiraillement, de cet amour incommensurable, de cet attachement…. Par pudeur, moi non plus je ne l’aurai sans doute pas fait. J’aurai parlé mode de garde, organisation, nuit, ces choses concrètes et dénuées d’émotion dont on peut parler avec détachement.
Rétrospectivement, j’ai eu la chance d’être extrêmement entourée pendant les premiers mois de la vie de Simon. Mon amoureux, extrêmement présent d’abord. Puis tous les jours des amis, de la famille venaient me voir. Puis ce fut les rendez-vous au parc avec mes amis, maman également l’après-midi ou les dîners à la maison avec mes amis sans enfant.
Qui en plus de venir jusqu’à chez moi préparaient le plus souvent le repas ou nettoyaient la table (voir la chaise haute) quand j’allais rendormir Simon qui se réveillait.
En tant que sociologue, plusieurs travaux m’ont conduite à faire l’hypothèse que l’isolement pouvait engendrer de la maltraitance. En faisant l’expérience de la maternité, je me suis encore davantage interrogée sur la situation des familles contemporaines qui seulement depuis trois générations vivent éloignées de leurs familles et ont donc davantage de probabilité d’être isolées.
Quelle mère ou quel père (sans congé paternel digne de ce nom, ce sera encore majoritairement les mères) n’a pas eu le sentiment de ne pas avoir une minute pour prendre sa douche ? Même la présence d’une grand-mère âgée peut permettre la présence auprès du bébé qui ne veut absolument pas rester seul.
Nous vivons en famille nucléaire depuis l’industrialisation, éloignés des uns des autres et ce de plus en plus dans un contexte d’injonction à la mobilité pour le travail. Vivre avec ses parents, ses beaux-parents, proches de frères et sœurs… avait certains avantages auxquels on ne pense absolument pas avant d’avoir un enfant.
Certes, vivre avec ses parents, ou ses beaux-parents (ses beaux-parents d’ailleurs le plus souvent pour les femmes comportent un certain nombre d’inconvénients), mais au moment d’élever un enfant, l’on se rend compte de la difficulté d’être seule au quotidien du moins pendant le temps du congé maternité. Je repense à ce proverbe africain qui dit qu’il faut un village pour élever un enfant. Il faut plus d’une personne, plus de deux, c’est sûr !
Comment la chose la plus ordinaire du monde, avoir un enfant, peut-elle être à ce point, extraordinaire ?
En une semaine, Simon arrive à se lever et faire quelque pas seul, même s’il préfère nous emmener partout, ne lâchant pas l’un de nos doigts et courant à la découverte d’un talus, d’un arbre, d’une fleur, d’un vélo posé par un enfant, d’un caillou, d’une flaque d’eau, de marches… se mettant à pleurer si l’on s’oppose à la direction qu’il souhaite.
Il arrive à dire aurevoir en faisant un bisou avec sa main. Pourtant nous ne lui avons pas appris. Peut-être a-t-il vu faire, plus que d’habitude en cette période de pandémie. Il arrive à prendre les crayons avec ses doigts et tirer un trait sur une feuille (et le parquet…). Il sait dire Maman, Dada, Badoum, vrrrrrmmmm, meuh, hi-han, cotcotcot… et surtout fait très bien le poisson. Il a d’ailleurs compris que les petits poissons en bois de son jeu de pêcheur, font le même bruit que celui du livre de son cousin, et ceux qu’il a dans son assiette…
Je repense aux jeunes de colos lorsque j’étais animatrice, qui ne savaient pas que les poissons de la mer c’était les poissons panés dans leur assiette. Il commence à s’opposer. Tente de me griffer le visage lorsque je fais quelque chose qui ne lui plaît pas. Se met à pleurer lorsqu’il n’est pas d’accord. J’ai honte de céder. Sa petite lèvre qui tremble me rend faible je crois. Ca passe trop vite. Après quelques histoires, qu’il choisit maintenant lui-même, il se blottit contre moi et s’endort.
Demain une nouvelle journée.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de juin 2025