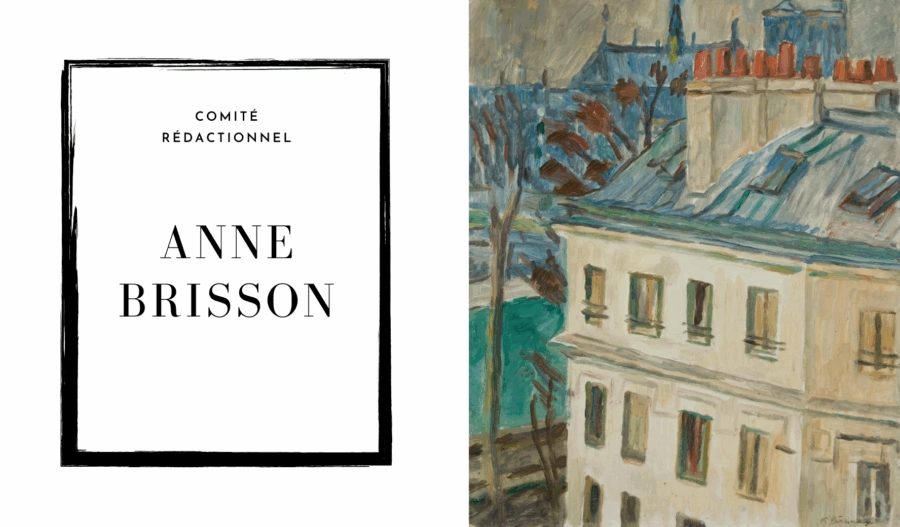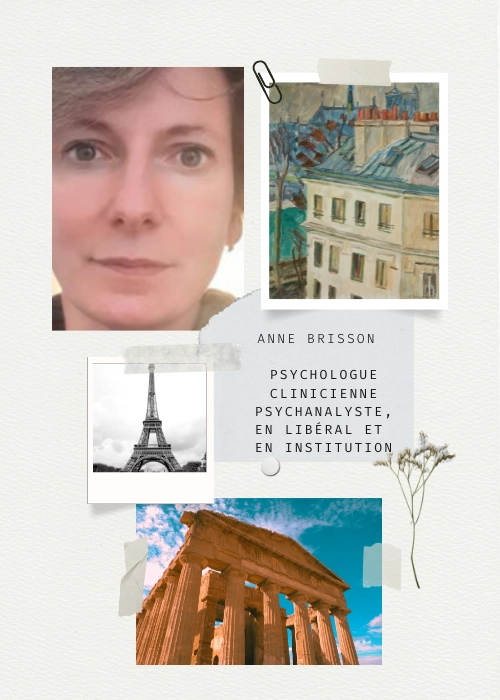C’est dire la force évocatrice du positionnement des corps dans l’espace et du foisonnement d’informations qu’il nous donne sans le recours aux mots. C’est dire aussi l’indéniable spécificité du cadre de l’analyse que l’on reconnaît au premier coup d’œil.
Revenons à Freud, directeur artistique de cette scène ! Je me souviens de mes cours de psychologie et psychanalyse à l’université. Les enseignants sont pour la plupart psychanalystes et illustrent les corpus théoriques avec des vignettes cliniques issus de leur propre pratique avec les patients adultes.
Ils insistent sur le cadre, sur l’absence de contact corporel entre le psychanalyste et le patient, sur la façon dont le corps est en partie effacé, ou neutralisé, avec le dispositif du divan, sur le champ laissé libre à l’écoute si particulière de l’inconscient.
Ce cadre rigoureux me convient d’autant plus que l’étudiante de 18 ans que j’étais est encore très embarrassée par son propre corps et a tendance à penser que l’enveloppe somatique n’est que le réceptacle vivant nécessaire à la production de la pensée : un contenant animé mais fragile, qu’il fallait garder en bonne santé (un peu de sport mais pas trop, une alimentation saine mais pas trop) pour ne pas entraver le déploiement et la fluidité des processus psychiques…
Voyons donc comment Freud se défait du regard et du toucher.
A l’époque où il est encore neurologue, il applique les méthodes enseignées par Charcot et Bernheim, il cherche à influencer ses patients pour les convaincre de renoncer à leurs symptômes. Dans un premier temps, il utilise la parole essentiellement pour son pouvoir de suggestion et fait intervenir son corps en conséquence : il se positionne face à ses patients pour faciliter l’imposition des mains sur leur tête qui accompagne le plus souvent ses paroles.
Dans un deuxième temps, il demande à ses patients de s’allonger, sans renoncer à les toucher, et continue de leur poser de nombreuses questions jusqu’à ce que certains patients lui disent que ces interrogatoires les empêchent de parler librement.
Dans un troisième temps, il abandonne complètement la suggestion, renonce au toucher, s’installe derrière le divan et commence à écouter ses patients autrement, en prêtant attention à ce qui est évoqué spontanément dans le mouvement de la parole de l’autre : « J’abandonnai donc l’hypnose et je n’en conservai que la position du patient, couché sur un lit de repos, derrière lequel je m’assis, ce qui me permettait de voir sans être vu moi-même »[1].
Allonger son corps sur le divan, c’est pour le patient s’engager dans l’exploration des énigmes de son propre fonctionnement, sans chercher l’assentiment ni le regard de son analyste, c’est essayer de décrypter en lui-même. Ecouter sans voir et sans être vu pour l’analyste, c’est consacrer son attention au discours de son patient pour distinguer dans la trame le fil conscient et le fil inconscient qui la constituent, sans avoir à contenir ni ses gestes ni ses mimiques.
Si les enveloppes corporelles sont mises au second plan, les enveloppes psychiques sont mises à contribution avec force. Le patient est contenu par la qualité de l’écoute de l’analyste : ainsi être entendu dans ce cadre permet d’une manière sortant de l’ordinaire d’être perçu et considéré.
Pour conclure sur la disposition des corps dans la cure analytique et souligner l’intérêt de cette expérience inédite, je reprends les mots de Jean Szpirko qui a écrit un article sur le passage du fauteuil au divan : « Et il me semble difficile de pouvoir éprouver la façon dont se nouent, se dénouent regard et vision sans s’être soi-même soustrait à la vue de son analyste, et avoir ainsi « appris » que le regard ne vient que de celui qui se sent regardé.
Les humains se sont de tout temps sentis saisis par la voûte des étoiles, les ombres de la nuit, les objets inanimés : une photo, une statue, un caillou dans la main, un meuble… qui les regarde. L’expérience analytique, en quelque sorte, ramasse la quotidienneté des rapports aux objets, aux autres et à l’Autre en soi-même »[2].
« C’est compliqué de trouver les mots pour dire les choses… Ce serait tellement cool de pouvoir se mettre comme une perfusion pour relier mon corps à celui de l’autre et transmettre comme cela tout ce que l’on ressent ».
Voici les paroles d’une patiente de 19 ans, autant encombrée par son corps que par les mots pour le raconter, qui traduit la nostalgie d’un lien in utero, fluide et ininterrompu, fantasme d’une communication totale et absolu en deçà du langage.
Le travail clinique avec les adolescents, les enfants et les bébés donnent une autre place au corps du patient comme du soignant.
Serge Lebovici, s’inspirant de Winnicott, Anna Freud ou Melanie Klein (sur ce point ils seraient tous tombés d’accord) disait que l’on ne pouvait plus être psychanalyste pour enfants à partir du moment où l’on ne pouvait plus se mettre au tapis auprès d’eux. Avec les jeunes patients, le corps est sur le devant de la scène.
C’est ce que décrit si bien Winnicott avec son concept de holding qui embrasse l’ensemble des soins qu’une mère donne à l’enfant pour répondre à tous ses besoins physiologiques tout en s’adaptant à ses changements physiques et psychologiques.
La base du holding pour Winnicott est le fait de tenir physiquement l’enfant, car le centre de gravité du nourrisson ne se situe pas dans son propre corps, mais entre lui et sa mère. On pourrait dire que le travail en pédopsychiatrie et en périnatalité est avant tout une clinique du holding, avec des approches diverses mais convergentes.
Pour ne citer que quelques théoriciens qui ont marqué ma formation post-universitaire, je réunis Winnicott bien sûr, mais aussi Emmi Pikler, Esther Bick et André Bullinger, car ils ont construit des outils théoriques et pratiques qui ont profondément façonné les savoir-faire des soignants, quelle que soit leur profession.
Emmi Pikler découvre combien le bébé prend plaisir à exercer son activité motrice de manière spontanée et comment il se saisit lui-même des possibilités nouvelles offertes par son développement sensori-moteur.
Le corps du bébé et ses expériences deviennent le moteur de son développement, les interventions des adultes pour lui imposer une posture qu’il n’aurait pas découverte par lui-même sont considérées comme une intrusion.
Cela conduit les soignants à garder une position d’observateur qui contient l’enfant à distance, par la force du regard, et à lui offrir un holding psychique. Esther Bick, de son côté, développe une méthode d’observation du bébé qui lui a permis d’éclairer la mise en place des moyens de défense et de survie psychique face aux premiers vécus d’angoisse.
C’est ainsi que les théories psychanalytiques se développent en remontant le temps jusqu’à la naissance. On se souvient du plaisir de Freud à observer et décrire le jeu à la bobine de son petit-fils âgé de 18 mois.
Observer le corps d’un petit enfant, ses postures, ses actions, ses déplacements, ses mimiques offrent une source d’informations qui suscitent aussitôt le psychisme du soignant ou du chercheur dans l’objectif de décoder et interpréter le matériel ainsi recueilli.
Observer, c’est se laisser traverser dans son propre corps par les éprouvés de l’autre. André Bullinger travaille pour sa part sur le corps de l’enfant dans l’espace après avoir constaté que les difficultés sensori-motrices pouvaient entraîner des perturbations importantes dans le développement moteur, cognitif et relationnel du sujet.
Son approche permet de soutenir le développement en pensant l’installation (le holding fourni par l’environnement humain et non-humain), les appuis et mises en forme corporelles pour faciliter l’action, les éléments du milieu et les flux sensoriels comme la lumière et le son.
Tous ces cliniciens chercheurs nous apprennent que la rencontre avec le corps de l’enfant est une source inépuisable d’éléments qui permettent de suivre pas à pas la construction motrice, cognitive et psychoaffective d’un sujet.
André Bullinger précise que « la théorie et les outils, une fois maîtrisés, sont faits pour être dépassés. En ces matières, le sérieux scientifique est fondé sur la succession de petites hypothèses locales, mises en correspondance avec des situations d’observation suscitées par le matériel ».
Par les aspects sensori-moteurs, l’autonomie de mouvement, la liberté d’action, le corps est central pour le développement de l’enfant. Chez l’adulte, les progrès, ou la progression, tiennent davantage à sa liberté de penser et de créer.
Me revient alors en mémoire les images très fortes d’adultes dont le corps se soulève pour résister.
Je partage avec vous ces mots de Didi Huberman qui avait conçu cette exposition intitulée « Soulèvements »[3] : « Ce qui nous soulève ? Ce sont des forces : psychiques, corporelles, sociales. Par elles nous transformons l’immobilité en mouvement, l’accablement en énergie, la soumission en révolte, le renoncement en joie expansive.
Les soulèvements adviennent comme des gestes : les bras se lèvent, les cœurs battent plus fort, les corps se déplient, les bouches se délient. Les soulèvements ne vont jamais sans des pensées, qui souvent deviennent des phrases : on réfléchit, on s’exprime, on discute, on chante, on griffonne un message, on compose une affiche, on distribue un tract, on écrit un ouvrage de résistance ».
C’est ainsi que par le corps on peut penser, tenir bon et partager ses révoltes.
[1] Sigmund Freud, Ma vie et la psychanalyse, 1925.
[2] Jean Szpirko, « Du fauteuil au divan », in Les lettres de la SPF, 2010/2, n°24.
[3] Georges Didi-Huberman et Nicole, « Soulèvements », Gallimard, 2016, catalogue de l’exposition au jeu de Paume (octobre 2016-janvier 2017)
Georges Didi-Huberman, Désirer, désobéir. Ce qui nous soulève, Minuit
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO