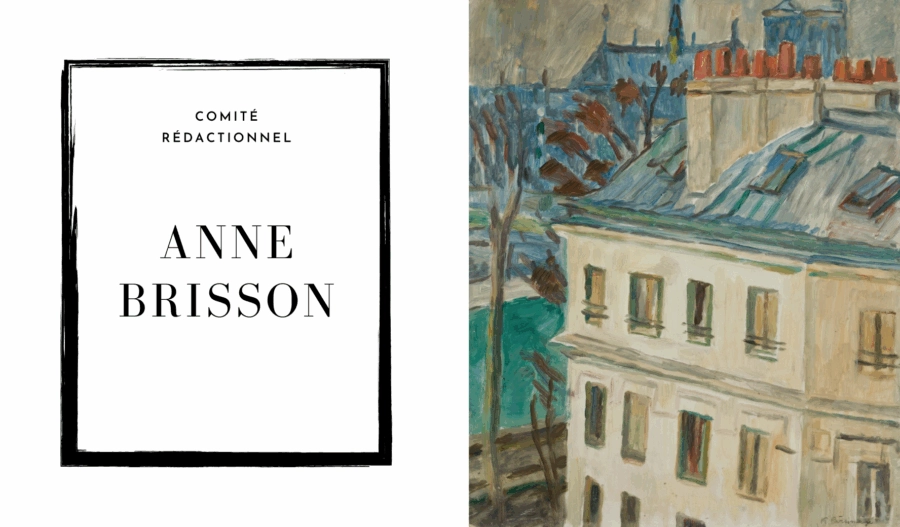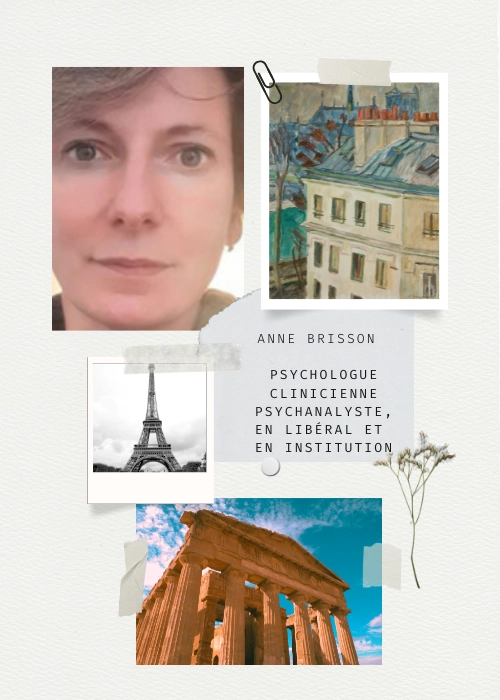Dalaï-Lama : « La vie est un choix et chaque choix que nous faisons nous rapproche ou nous éloigne de notre liberté ».
Albert Camus : « La vie est la somme de tous vos choix. Alors que faites-vous aujourd’hui ? »
En vrai, je n’avais pas tellement le choix d’écrire sur ce thème, dans la mesure où appartenir à un comité rédactionnel représente un engagement, celui d’écrire sur un sujet que je peux discuter mais pas contourner : c’est le jeu de la liberté une fois la contrainte digérée !
Tout engagement semble réduire le catalogue des choix, comme si la liberté se mesurait à la quantité de choix potentiels. Cela me fait penser à André Gide que j’ai lu quand j’étais adolescente et qui raconte « la passion qui brûla sa jeunesse » dans son livre Les nourritures terrestres.
Je fais le choix de citer le paragraphe dans son entier pour vous faire éprouver l’intensité du plaidoyer : « J’enrageais de la fuite des heures. La nécessité de l’option me fut toujours intolérable ; choisir m’apparaissait non tant élire, que repousser ce que je n’élisais pas. Je comprenais épouvantablement l’étroitesse des heures, et que le temps n’a qu’une dimension ; c’était une ligne que j’eusse souhaitée spacieuse, et mes désirs en y courant empiétaient nécessairement l’un sur l’autre. — Je ne faisais jamais que ceci ou que cela. Si je faisais ceci, cela m’en devenait aussitôt regrettable, et je restais souvent sans plus rien oser faire, éperdument et comme les bras toujours ouverts, de peur, si je les refermais pour la prise, de n’avoir saisi qu’une chose. L’erreur de ma vie fut dès lors de ne continuer longtemps aucune étude, pour n’avoir su prendre mon parti de renoncer à beaucoup d’autres. — N’importe quoi s’achetait trop cher à ce prix-là, et les raisonnements ne pouvaient venir à bout de ma détresse. Entrer dans un marché de délices, en ne disposant (grâce à Qui ?) que d’une somme trop minime ; en disposer ! choisir, c’était renoncer pour toujours, pour jamais, à tout le reste — et la quantité nombreuse de ce reste demeurait préférable à n’importe quelle unité ».
Revenons aux citations du Dalaï-Lama et d’Albert Camus qui placent le choix entre deux pôles, la liberté d’une part et la responsabilité d’autre part, et c’est bien ce tiraillement dont l’intensité varie jusqu’à devenir parfois une tension extrême que l’on ressent quand on est sur le point de faire un choix. Certains choix nous poussent sur le bord d’un gouffre, d’une falaise, d’un précipice et nous font longtemps vaciller, dans un balancement entre élan et crainte, entre désir et défense ; d’autres sont aussi faciles à faire que de sauter par-dessus un ruisseau. C’est que le choix mobilise, avec plus ou moins de force, notre activité psychique.
De fait, pour Bergson[1], « la conscience est synonyme de choix ».
Pour comprendre cet énoncé particulièrement condensé, reprenons sa démonstration : Bergson remarque que, dans notre vie quotidienne, nous faisons un grand nombre d’activité de manière quasi-automatique. Les mécanismes cérébraux sélectionnés au cours de l’évolution pour leur efficacité permettent l’automatisation de certains gestes et activités.
Ainsi lorsqu’une action devient habituelle, notre mémoire conduit à son automatisation qui elle-même débouche sur une diminution progressive du degré de conscience que nous y mettons. Pour autant, nous ne devenons pas de simples automates et dans certains contextes, notre conscience reprend sa puissance maximale.
Face à une situation inédite et pleine de nouveauté, notre conscience somnolente sort de sa veille et nous permet de prendre rapidement une décision adéquate. C’est pour cela que la conscience est synonyme de choix. Cette décision puise dans le réservoir de nos souvenirs et expériences passés, ce choix libre est donc très personnel, il révèle la personnalité et la créativité de chacun. Choisir est un acte qui réveille la conscience et qui la pousse à se manifester dans son individualité.
Comme vous l’avez remarqué, j’ai convoqué quelques philosophes et écrivains pour explorer le thème, car sachez-le, je n’ai pas vraiment le choix. Quand on a un père chercheur en philosophie qui a mis du Platon dans votre biberon, les références à la philosophie sont constitutives de votre formation intellectuelle et donc d’une partie de votre identité.
Concernant les relations entre les choix et l’identité, Gabriel Lombardi[2] fait une démonstration intéressante. Psychanalyste argentin, il est spécialiste des crises d’identité à détermination sociale et économique, dans un service clinique créé lors de la crise de 2001. Dans son article sur les « Choix qui fixent une identité », il explique que l’identité est issue de deux sources causales : tout d’abord les déterminations sociales imprimées dans le sujet (il est né dans ce pays, dans cette famille, dans cette culture), mais aussi, et c’est ce qui l’intéresse davantage, « la position prise par l’être parlant face à quelques événements très particuliers ».
Il précise : « Je parle d’événements dont la particularité ne recoupe pas le général mais le singulier. Ils se présentent dans l’expérience de la cure sous la forme d’un traumatisme subi par l’être parlant très précisément en tant qu’être capable de choix ». Il poursuit avec l’idée d’un « choix du traumatisme » : Freud considère qu’un « incident infime de l’enfance peut être signalé comme traumatique _ éligible ou refusable _, être source d’une jouissance séductrice ou effrayante _ beaucoup plus tard, au moment de la montée pulsionnelle de la puberté ». Un événement traumatique peut être « reformulé par le fantasme dans des coordonnées fictives » qui prend alors une importance disproportionnée dans la construction du sujet.
C’est la défense, utilisée par le sujet contre les effets de cet événement, qui relève d’une forme de choix. C’est le fameux choix de la névrose, parfaitement illustré par le cas d’un patient de Freud, l’Homme aux rats[3] : sa névrose se déploie au moment où il doit choisir une femme. Il ne veut pas élire comme son père une femme riche et non aimée, mais il ne se décide pas non plus pour la femme aimée mais pauvre. Il choisit de ne pas choisir et il devient malade à cause de cela. Il ne travaille plus, il n’étudie plus, pour geler la situation et empêcher la décision d’advenir. Ainsi, choisir de ne pas choisir peut produire des entraves et conduire à la bascule du fonctionnement psychique sur le versant pathologique.
S’empêcher de choisir réduit sans doute la vivacité de la conscience et la créativité telle qu’elle est conçue par Bergson. C’est aussi une situation impensable pour Pascal, puis pour Sartre. Toute la démonstration de Pascal[4] sur le pari « Dieu est ou il n’est pas » s’appuie sur l’idée que nous n’avons pas le choix de faire des choix : « Cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqué » (dans l’existence). Il en va de même pour Sartre[5] qui proclame le devoir d’engagement : nous sommes condamnés à être libres, sans cesse appelés à choisir entre différents possibles. Refuser de choisir implique finalement un choix. Quoi que nous fassions, nous sommes « embarqués et par là-même responsables ».
Pour revenir à la psychanalyse, souvent nous n’avons pas le choix de faire un travail psychothérapeutique, la souffrance psychique est trop grande, les symptômes trop envahissants et les questions qui nous agitent trop nombreuses. Et pourtant c’est ce travail introspectif qui va nous redonner la liberté de choix.
Je rejoins Gabriel Lombardi pour dire qu’une psychanalyse peut être conçue comme un travail de discernement et de production de quelques choix qui vont construire les coordonnées réaménagées de son identité : « L’effet d’une psychanalyse ne consiste pas à supprimer le symptôme même si elle peut soulager, mais à remanier les coordonnées de quelques choix aliénés du passé, pour y trouver une option nouvelle où l’être, s’il le veut, peut se donner une identité de séparation à partir d’un choix (le sien) qui interrompt tout enchaînement causal ».
[1] Bergson, La conscience et la vie.
[2] Gabriel Lombardi, « Choix qui fixent une identité », in Champ lacanien, 2008/1
[3] Sigmund Freud, L’homme aux rats, un cas de névrose obsessionnelle, 1909
[4] Blaise Pascal, Pensées, éditions Lafuma n°418, fragment sur le pari, 1670
[5] Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? 1948
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de septembre 2024