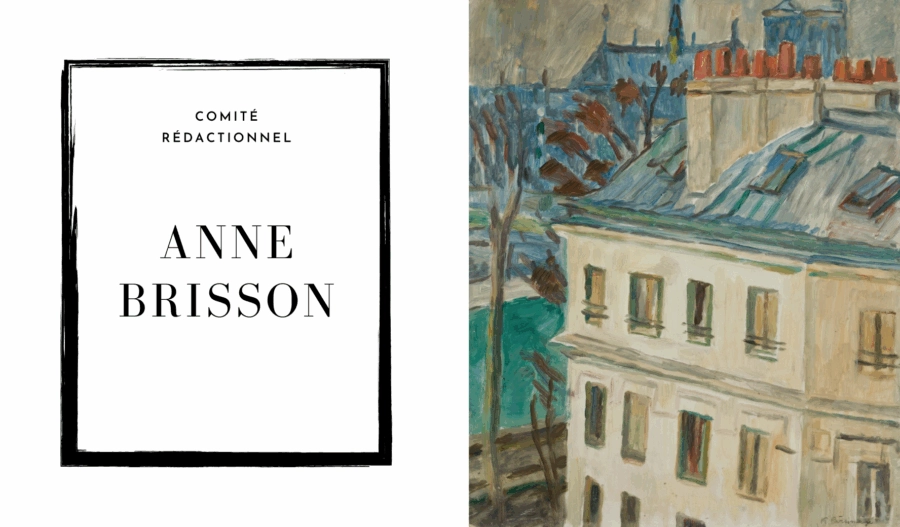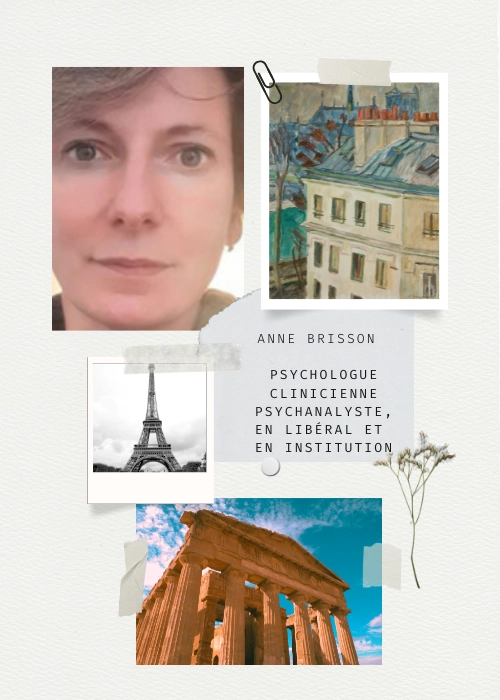Typiquement en fait partie pour moi la formule « un esprit sain dans un corps sain »[1]…
En voilà une devise qui vous hérisse le poil entre 13 et 17 ans, quand votre activité physique privilégiée est d’être allongé sur un lit moelleux avec un livre/écran et un paquet de fraises Tagada ou quand votre projet de sortir prendre une marche a pour objectif premier (mais dissimulé) d’aller fumer discrètement une cigarette…
Les traces de mon agacement adolescent sont réactivées par l’ambiance de la rentrée de septembre : nombreuses publicités pour les salles de sport, discussions sur les performances des rugbymen, informations/débats à propos des Jeux Olympiques à venir relancent mon questionnement sur la place du sport dans la vie quotidienne.
Et pour enfoncer le clou, une collègue me parle des prochains thèmes des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, dont celui qui va promouvoir activité physique et bien-être général…
Il en va de l’avenir de la psychiatrie, alors je me renseigne. Concernant l’articulation entre santé mentale et sport, voici ce que l’OMS présente comme les « principaux faits » :
- L’activité physique est très bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l’esprit.
- L’activité physique réduit les symptômes de dépression et d’anxiété.
- L’activité physique améliore les capacités de réflexion, d’apprentissage et de jugement.
- L’activité physique garantit une croissance et un développement sains chez les jeunes.
Dans le cadre de ses recommandations, l’OMS donne ensuite des indications (par tranches d’âge et groupes de population précis) sur le volume d’activité physique nécessaire à une bonne santé : 180 minutes d’activité physique par jour pour les enfants entre 1 an et 2 ans, 60 minutes par jour pour les adolescents (si j’avais su…), entre 150 et 300 minutes par semaines pour les adultes entre 18 et 64 ans.
J’ai moi-même fait l’expérience des bénéfices que procure une activité physique régulière, mais je ne peux m’empêcher d’être légèrement sceptique à l’égard des préceptes de l’OMS qui établit un lien aussi rapide entre sport et santé mentale.
Mais de fait, si le lien est facile à construire, c’est que l’OMS n’invente rien et emprunte à de nombreux chercheurs, à commencer par les philosophes de l’Antiquité.
Platon, par exemple, écrit dans le Timée : « Il n’est qu’un seul et même salut pour les deux parties de notre être : c’est de ne mouvoir ni l’âme sans le corps, ni le corps sans l’âme, afin que, se défendant l’une contre l’autre, elles parviennent à l’équilibre et à la santé »[2].
Le corps fait l’objet d’un soin attentif dans la mesure où il doit interférer avec les activités de l’âme aussi peu que possible. Socrate va jusqu’à dire que la gymnastique doit rendre le recours à la médecine inutile.
Pour Platon, la pratique du sport s’inscrit dans la recherche d’équilibre entre soin du corps et de l’âme : « Ceux qui s’adonnent exclusivement à la gymnastique parviennent à une disposition d’une excessive brutalité, alors que ceux qui se consacrent uniquement à la musique et à la poésie deviennent plus mous que ce qui est bon pour eux »[3].
Il est donc question de quantité et de modération, notions importantes pour la clinique des troubles psychiques puisqu’elle permettent d’évaluer l’importance des symptômes et l’intensité de la psychopathologie.
Il faut se souvenir que pour le philosophe Canguilhem, qui développe cette idée dans sa thèse de médecine en 1943[4], il existerait un continuum entre l’état normal et l’état pathologique : la variation de l’un à l’autre serait d’ordre quantitatif et non qualitatif.
La quantité donc… y compris pour la pratique sportive qui doit être modérée pour rester du côté du soin. Cela me rappelle le travail de Gérard Szwec sur ceux qu’il appelle « les galériens volontaires » et qui utilisent la pratique sportive en excès : des hommes qui « rament, courent, nagent jusqu’aux limites de leurs forces puis recommencent sous l’effet non d’un plaisir mais d’une contrainte de répétition d’un comportement à l’identique »[5].
Le surinvestissement moteur et perceptif vise à faire le vide dans l’appareil psychique et s’oppose à toute activité fantasmatique. La détente est attendue de l’épuisement de la machine automatique en quoi le corps a été transformé.
« Il y a toutes sortes de galériens volontaires dont le comportement intrigue, des marathoniens, des danseuses ou des sportifs pratiquant un entraînement intensif. Le but d’accomplir un exploit masque souvent d’autres buts, plus discrets, qui sont atteints par le moyen de la mise en tension répétitive du corps et des sens (…) ».
Ainsi ces galériens utilisent les activités physiques comme des « procédés autocalmants » pour s’empêcher de penser et pour ramener le calme à travers la recherche de l’excitation.
A l’inverse, certaines pratiques sportives exercées avec modération ont depuis longtemps la réputation d’aider à penser.
Elève de Platon, Aristote fonde une école à Athènes, dans un gymnase public appelé le Lycée, qui était déjà un lieu de réunion philosophique. Socrate lui-même avait l’habitude de s’y rendre.
Cette école possède une galerie couverte ou un promenoir planté d’arbres.
Le philosophe enseigne en marchant dans les jardins, suivi de ses élèves. Ainsi s’opère depuis l’Antiquité un rapprochement intuitif entre mouvement de la pensée et mouvement du corps, et le modèle le plus ajusté de cette collaboration semble être celui de la marche.
« Elle permet de nouvelles connexions entre les cellules au cerveau, d’augmenter la taille de l’hippocampe (une zone du cerveau essentielle pour la mémoire) et d’élever le nombre de molécules qui stimulent la croissance de nouveaux neurones et la transmission des messages entre eux.
C’est aussi un moyen de connecter le rythme de notre corps à notre état mental, à la différence de tous les autres moyens de locomotion, le vélo, la course, etc. qui sont trop rapides. C’est justement parce qu’on n’effectue pas d’effort conscient que la marche permet au cerveau d’être créatif et mettre un pied devant l’autre nous permet d’envisager une idée après l’autre »[6].
Et plus encore, l’article du New Yorker s’appuie sur l’exemple de nombreux écrivains pour établir une connexion profonde et intuitive entre marcher, penser et écrire : « De la même manière, l’écriture oblige le cerveau à revoir son propre paysage, à tracer un parcours à travers ce terrain mental et à transcrire le cheminement des pensées qui en résulte en guidant les mains. La marche organise le monde qui nous entoure, l’écriture organise nos pensées ».
Ainsi de nombreux penseurs racontent ce que leurs œuvres doivent à l’exercice régulier et solitaire de la marche : il y a la promenade de Kant dans les jardins de Königsberg, les voyages du jeune Rousseau à pied d’Annecy à Turin, de Paris à Chambéry, les randonnées de Nietzsche dans les montages de l’Engadine, les sorties quotidiennes de Thoreau en forêt…
Il est souvent bon de ressusciter de vieilles idées, qui viennent de l’Antiquité et qui sont impérissables, et de les remettre au goût du jour, parce qu’elles sont utiles pour penser quelle que soit l’époque.
Cependant, il me semble qu’il serait incorrect de les présenter comme des idées nouvelles ou des trouvailles. Mettre en lumière le sport comme un remède essentiel pour la santé mentale dans cette période où la psychiatrie est sinistrée est une pirouette difficile à applaudir…
La question de la place du corps en mouvement dans la vie quotidienne et son lien avec les activités psychiques retiennent davantage mon intérêt. A tous les jeunes et moins jeunes élèves qui gigotent sur leur chaise, se lèvent pour ramasser leur gomme et réclament d’aller aux toilettes, à tous ceux qui ne peuvent immobiliser leur corps, ni restreindre le mouvement, je leur offre un argument formulé par Nietzsche : « Les seules pensées valables viennent en marchant]».
[1] « Mens sana in corpore sano », citation extraite de la dixième Satire de Juvénal qui soutient ainsi qu’il faut cesser d’implorer vainement les dieux, mais requérir de leur part santé physique et mentale. La santé était jadis associée à une puissance transcendante d’où son lien avec la « sainteté »
[2] Platon, Timée, 88, c et d
[3] Platon, République, III, 410d
[4] Georges Canguilhem, Le normal et la pathologique, Paris, PUF
[5] Gérard Szwec, Les galériens volontaires, Paris, Puf
[6] The New Yorker, « Why walking helps us think », by Ferris Jabr, September 2014
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO d’octobre 2023