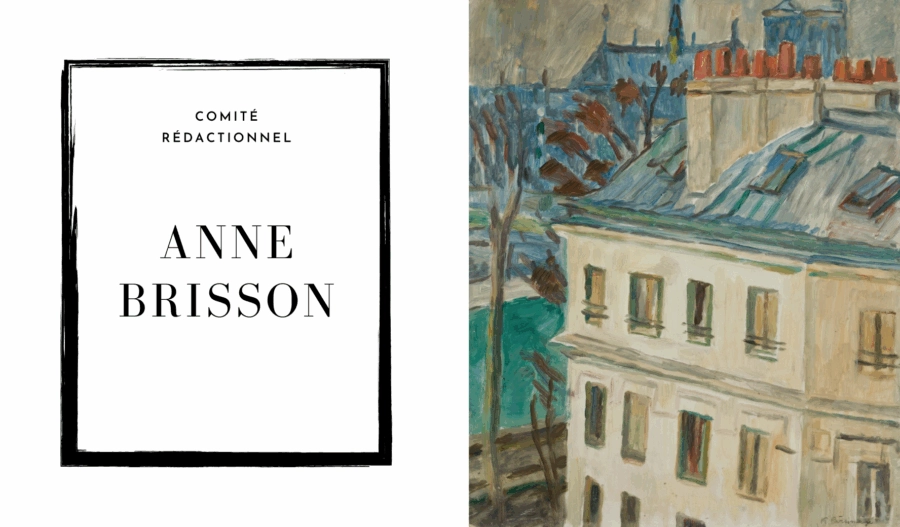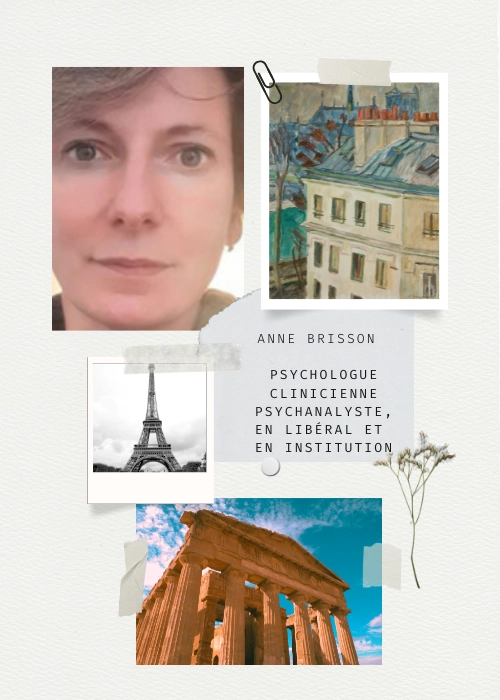Il revient sur l’historique de l’événement et me raconte que sa responsable est une jeune femme qui a la réputation d’être consommatrice de cocaïne et qui présente des sautes d’humeur imprévisibles.
Pour conclure il précise, en soulignant par ses mimiques l’aspect paradoxal de l’énoncé, qu’elle occupe le poste de « happiness manager ». Ainsi donc je (re)découvre que la fonction de « responsable du bonheur » existe dans le monde professionnel et, pour parfaire le concept, qu’elle peut être endossée par une cocaïnomane colérique.
Quelques jours plus tard, ma cousine canadienne, de passage à Paris, me raconte que son mari vient de changer de travail, il a décroché un poste dans une société gouvernementale (équivalent pour nous d’un poste de fonctionnaire) et il bénéficie dorénavant de « 4 jours de Santé mentale » par an, 4 journées dédiées, prévues dans le calendrier administratif, pour le soin de la vie psychique. Comme s’il suffisait de créer le concept, de le nommer et de l’inscrire, pour que l’équilibre psychologique soit assuré…
Notre « modernité tardive » invente continuellement de nouvelles formules, plus imagées que les précédentes, sans doute parce qu’elles doivent contenir et impulser dans le même temps la promesse d’une progression. Avec des intitulés comme « happiness manager » et « jours de santé mentale » l’écart se creuse inexorablement entre les mots et ce qu’ils recouvrent dans la réalité. L’écart se creuse jusqu’au paradoxe…
C’est ce que décrit Nicolas Santolaria dans son livre[1] sur la « tyrannie sucrée de la vie de bureau » : « Si l’entreprise nous tient effectivement captifs, elle le fait aujourd’hui d’une façon renouvelée, masquant de plus en plus habilement son caractère carcéral et répressif.
La liberté, l’autonomie, l’épanouissement sont devenus les nouveaux leviers paradoxaux de cet asservissement ludique aux allures de goûter d’anniversaire. Comment se révolter dans ce paradis moquetté quand le Chief Happiness Officer vient vérifier que vous avez bien reçu votre dose quotidienne de crocodiles Haribo ? ». Pourtant les décors enchanteurs et les discours bienveillants à l’égard de la santé mentale de chacun ont bien peu d’effet sur ce que produit la « modernité tardive ».
Pour le sociologue Hartmut Rosa, nous sommes pris dans un moment « où la vitesse du changement social atteint un rythme intragénérationnel ». Selon lui, l’accélération « devient un problème parce qu’il y a une contrainte d’accroissement n’ayant ni but, ni fin », et cela entraîne inévitablement un dérèglement de notre relation au monde.
Les individus sont pris dans une course et font face à la réalité sans pouvoir l’habiter ni se l’approprier. Ainsi, dans de nombreux métiers, les salariés souffrent d’un sentiment d’inadaptation cognitive aux exigences de l’époque.
Comme le décrit Nicolas Santolaria : « Il faut s’adapter sans cesse et traiter des informations nombreuses et complexes, alors même que l’autonomie et la reconnaissance font défaut ». Il mentionne un rapport de l’OMS publié en 2008 qui plaçait la France à la troisième place des pays recensant le plus grand nombre de dépressions liées au travail, en raison de l’apparition d’un nouveau syndrome, « l’hyperstress », un état qui précède celui du « burn out ».
Aujourd’hui, la réussite professionnelle s’appuie sur les idées de performance, de rapidité, de succès individuel, de gain, de popularité, de capacité à rebondir et laissent peu de place aux hésitations, à la fragilité, à l’impuissance, aux erreurs et aux petits échecs pourtant bien utiles pour progresser.
Et pourtant, comme le disait Freud, il existe des métiers « impossibles », c’est-à-dire des activités où la réussite complète est un leurre et où l’incomplétude de la satisfaction ou de la réussite est au cœur du processus. Gouverner, éduquer, analyser (ou soigner psychiquement), les trois métiers impossibles selon Freud et ce constat trouve une résonance incroyable dans notre actualité sociale et politique.
Impossible signifie pour Freud que « l’on peut d’emblée être sûr d’un succès insuffisant ». L’impossible dont il parle constitue à la fois un moteur et une garantie, comme le souligne Angélique Christaki qui reprend et développe[2] cette assertion de Freud.
Gouverner pour l’homme politique, c’est avoir « une parole libre qui résiste non seulement à l’utilisation de la violence, mais aussi à la tentation de persuader par la preuve, la démonstration et par tout autre artifice issu de la sophistique ou bien de la rhétorique ».
Il est évidemment difficile de trouver les moyens de gouverner des êtres humains pour qu’ils restent libres et égaux, d’autant que cela dépend de la façon dont ces hommes ont été des enfants préparés à devenir des citoyens qui participent à la vie politique.
Eduquer, c’est savoir résister à la violence que confère le pouvoir de l’autorité et à la volonté d’imposer un savoir, c’est s’identifier à la vulnérabilité infantile. Là aussi il est bien difficile d’éduquer sans appauvrir les possibilités de pensée, sans passer par la force, en s’identifiant aux enfants et à leur fragilité sans l’utiliser de manière perverse.
Analyser ou soigner psychiquement, c’est se tenir à distance des questions de pouvoir, d’autorité et de perversion, c’est accueillir le discours de l’autre sans jugement et sans interprétation préétablie, c’est renoncer au savoir que l’on croit détenir sur les patients et à la volonté de guérir à toute force.
La vocation des soignants traverse toujours un moment de désillusion comme celui de Freud avec son patient dénommé l’homme aux loups. Il avait espéré hâter le cours de la cure et surmonter les résistances de son patient en lui fixant de manière arbitraire un terme, mais cela n’a pas donné le résultat attendu. Freud reconnaît à ce moment-là que « les analystes n’ont pas complètement atteint, dans leur propre personnalité, le degré de normalité psychique auquel ils veulent faire accéder leurs patients » ! Joli moment de connaissance de soi-même, de ses propres limites et de son insuffisance.
Il y a un temps pour la vocation, pour la formation, pour l’illusion d’une vérité absolue, pour la fureur de guérir. Il y a un autre temps pour la désillusion, la reconnaissance d’une certaine impuissance, la sienne et celles des autres, pour un objectif plus modeste mais accessible : non plus lever complètement l’amnésie infantile, ni explorer tout le réservoir de l’inconscient, mais créer les conditions psychologiques les plus favorables aux fonctions du moi en le libérant de ses entraves. Comme l’écrit Roland Gori[3] : « Il y a dans l’analyse, dès lors que l’analysant et l’analyste se révèlent capables de se déprendre d’une conception totalitaire de l’interprétation, de la croyance dans les significations, la possibilité de créer par le dialogue, un monde commun ».
La santé mentale, que l’on pourrait maintenir tout au long de sa vie, grâce aux happiness managers ou aux 4 journées par an dédiées au bien-être, est de mon point de vue une publicité mensongère.
Nous sommes d’ailleurs plongés dans un paradoxe étonnant : alors que chacun raconte en toute transparence ses symptômes et décrit sa quête pour un diagnostic précis, qu’il pourrait assumer voire revendiquer (HPI, HPE, TDHA, TSA, bipolaire pour les plus répandus en ce moment sur les réseaux sociaux), être en bonne santé mentale reste l’injonction sociale pour tous.
L’incroyable recrudescence des références à la folie sur les réseaux sociaux et en particulier de la part des artistes vient souligner les rapprochements possibles entre santé mentale, normalité et affaiblissement de l’imagination. Comme l’écrivait Joyce McDougall[4], si soigner devient un effort pour « normaliser » toute expression déviante, pour parvenir à une « sur-adaptation » à la réalité, le risque est d’engendrer une certaine misère psychique dépourvue de créativité.
Ce sont les patients les plus difficiles à cerner, ceux qui nous poussent aux limites de ce qui est analysable et représentable, ceux que l’on renonce à guérir, mais que l’on cherche avec obstination à comprendre, qui nous amènent le mieux à inventer de nouvelles façons de penser.
[1] Nicolas Santolaria, Le syndrome de la chouquette, ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau, Anamosa, 2018
[2] Angélique Christaki, « Trois métiers impossible, trois métiers de résistance », in Insistance, 2016/1 (n°11)
[3] Roland Gori, « Gouverner, éduquer et analyser : trois métiers impossibles ? », in Cliniques méditerranéennes, 2016/2 (n°94)
[4] Joyce McDougall, Plaidoyer pour une certaine anormalité, Paris, Gallimard, 1978
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de juin 2024