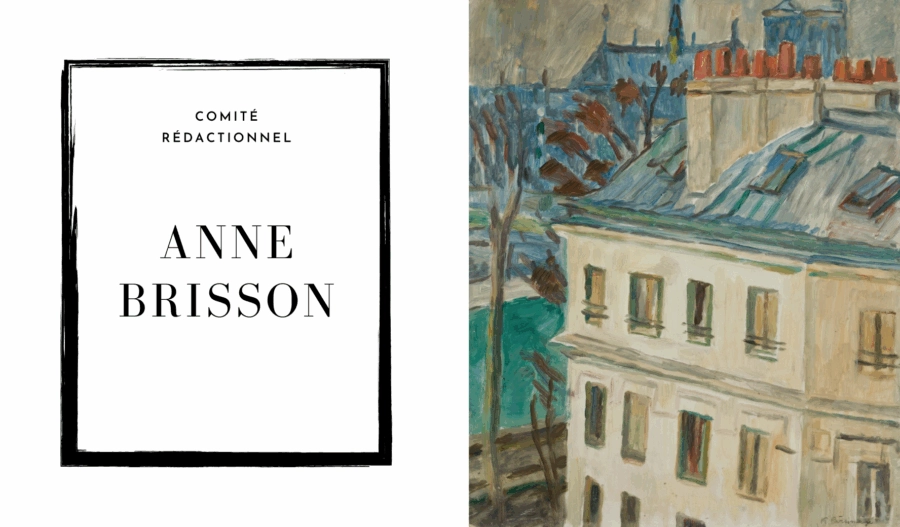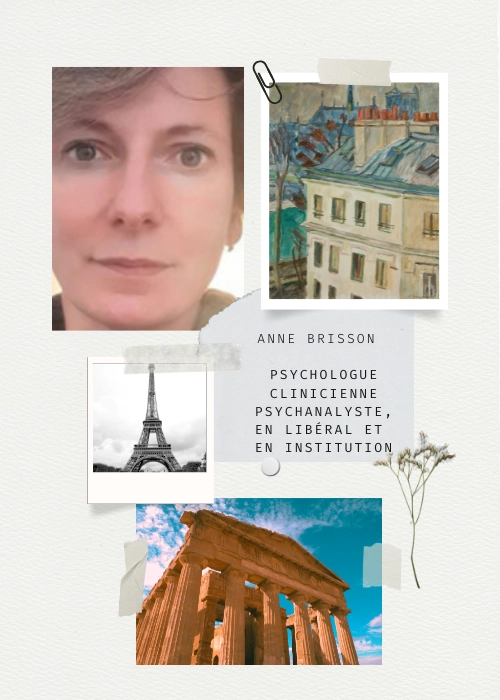Au bout de quelques semaines, je m’aperçois qu’il ne prend jamais le temps de déjeuner, encore moins de monter jusqu’au self, faire la queue, prendre un plateau, négocier les portions, faire des commentaires sur le menu.
Et encore moins de s’asseoir pour se nourrir et perdre par la même occasion une précieuse demi-heure. Curieuse (et impressionnée par les gens qui semblent pouvoir vivre sans sommeil ni nourriture), je lui pose la question de son modus operandi en matière de nutrition et il me répond en se comparant aux hommes préhistoriques : « Ils ne mangeaient que tous les trois jours ! Entre temps, ils allaient à la chasse et se reposaient… »
L’argument est énoncé avec humour, il déclenche le rire, rien ne sert alors d’en vérifier les fondements scientifiques. Je vais le faire aujourd’hui, car l’alimentation se trouve au croisement de nombreuses réflexions actuelles concernant la santé : celle de la planète, celle du corps et celle de l’esprit.
Le régime alimentaire des homininés (entre 7 et 2,8 millions d’années) était principalement constitué d’aliments crus (feuilles, fruits, racines) qui étaient peu nourrissants et qu’il fallait manger en grande quantité pour assurer une énergie suffisante. Ils devaient aussi consommer des larves d’insectes pour leur apport en protéines.
Le repas des premiers Hommes (entre 2,8 et 1,5 millions d’années) contenait aussi fruits, racines, petits reptiles, puis s’est enrichi progressivement d’un nouvel apport énergétique, celui de la viande crue. Cette viande était prélevée sur des carcasses d’animaux, car la pratique de la chasse n’apparaît que vers 450 000 ans.
La cuisson est associée aux Homo erectus (entre 790 000 et 450 000 ans), elle rend comestibles certains aliments toxiques ou indigestes à l’état cru, diminue le temps de mastication et libère les nutriments des végétaux, mais elle détruit certaines vitamines dont la vitamine C. Le fermenté a des vertus importantes comme conserver les vitamines sans utiliser la cuisson. Il offre de plus des saveurs fortes avant que les épices ne soient au menu de nos ancêtres, à partir du Néolithique.
Je donne toutes ces précisions sur une alimentation très éloignée de nous dans le temps et qui pourrait nous sembler primitive, car elle a été remise au goût du jour par les adeptes du « régime paléo ».
J’ai découvert ce régime grâce à l’insistance d’une amie pleine de convictions qui m’en vantait les incroyables mérites. Il s’agit de revenir à l’alimentation de nos ancêtres dans un mouvement critique à l’égard de ce que l’ère industrielle a produit en excès et de manière de plus en plus artificielle.
Le régime paléo a été popularisé par le Dr Boyd Eaton en 1985 dans un article scientifique, puis repris dans un livre pour le grand public par Loren Cordain, scientifique américain, spécialiste de la santé et de l’exercice physique.
Ce régime s’appuie sur la consommation de protéines animales, de végétaux et d’oléagineux et sur la suppression des féculents, du sucre et des aliments transformés. Il promet d’atteindre les objectifs suivants : perte de poids, prise de masse musculaire, réduction de la fatigue, prévention de certaines maladies (cardiovasculaires, ostéoporose, syndrome métabolique) et soulagement possible de certaines maladies auto-immunes.
Le mérite que l’on peut accorder à ce régime, décrit par certains comme trop exigeant et monotone pour être respecté sur la durée, est la remise en question de notre alimentation moderne.
L’industrie alimentaire atteint son apogée dans la formulation de ses produits, avec l’utilisation du point de félicité (Bliss point), c’est-à-dire le niveau d’un ingrédient, tel que le sel, le sucre ou le gras, qui optimise le plaisir gustatif.
Le corps humain cherche à favoriser les aliments qui lui procurent le plus de satisfaction.
Certains stimuli (goûts, arômes, textures) déclenchent la fabrication d’endorphines et activent le système de récompense de manière que l’on ait envie de renouveler l’expérience. La dopamine provoque la sensation de plaisir et joue un rôle dans la motivation à la réitérer. Il se trouve que le sel, le gras et le sucre activent de façon synergique le circuit de la récompense.
L’industrie agroalimentaire cherche ainsi à optimiser le plaisir ressenti par le consommateur en jouant sur ces ingrédients de base, indépendamment de leur intérêt nutritionnel… L’exemple le plus connu est celui des chips : Allez, je vous mets un paquet de chips sous le nez et je vous lance un défi : Êtes-vous capable de n’en manger qu’une seule ? Quel effort mental cela représente ? Pouvez-vous le faire sans ressentir de frustration ? Si vous y êtes arrivés, vous êtes vraiment exceptionnel !
La plupart des personnes n’envisagent pas la consommation d’une seule et unique chips et succombent inexorablement au Bliss point.
Alors je vous rassure : je suis persuadée que l’on peut consommer des chips, être à peu près lucide sur les dérives de l’industrie alimentaire, être en quête du régime parfait qui tient à distance les maladies somatiques et mentales, ainsi que le vieillissement, sans pour autant renouer avec l’alimentation préhistorique !
Ce qui est particulièrement intéressant dans l’actualité des recherches en matière de nutrition, c’est qu’elle dépasse la question de la santé du corps et met l’accent sur l’alimentation et ses effets sur la santé mentale.
Le psychiatre Guillaume Fond[1] écrit que « la psycho-nutrition va changer le visage de la psychiatrie ». Ce terme de psycho-nutrition m’a fait penser à un article d’Emmanuel Salanskis[2] sur la psycho-diététique de Nietzsche.
Il est nécessaire de préciser que pour Nietzsche, l’esprit n’est pas une réalité distincte du corps, il n’est donc pas possible de le traiter séparément. Selon lui, la maladie mentale est à la fois corporelle, spirituelle et culturelle. Avant de s’occuper du psychisme, il pense « qu’il faut d’abord persuader le corps ». Par ailleurs, il refuse de prescrire des recettes universelles, car en matière de régime l’universalisme est une grave erreur.
Ainsi, il critique l’exemple de Luigi Cornaro, aristocrate vénitien du 16e siècle, mort à 103 ans, auteur d’une série de Discours sur la vie sobre, traduits et réédités à de nombreuses reprises.
« La longévité exceptionnelle de Cornaro était censée démontrer la salubrité fondamentale de son mode de vie » et de son régime frugal, ce que réfute Nietzsche qui traite la question de l’alimentation de manière résolument individualiste. Le régime nietzschéen est en fait un paradoxe ambitieux : il s’agit d’une part « d’être attentif à son corps et de chercher un optimum de force par des moyens idiosyncrasiques », mais « d’autre part, de ne pas vouloir la santé à tout prix et d’accepter la souffrance comme un stimulant du dépassement de soi ».
On peut finalement se demander qui est capable d’un tel régime si ce n’est Nietzsche lui-même ! Mais ce que je souhaite souligner c’est l’idée qu’il faut tendre à être en bonne santé tout en considérant la maladie comme une source d’expériences et d’informations, car le déséquilibre qui survient engendre pensée et innovation.
Revenons aux recherches récentes de Guillaume Fond sur la psycho-nutrition : « Le régime méditerranéen – un peu de poisson gras, de l’huile d’olive, beaucoup de fruits, de légumineuses (pois chiches, lentilles, haricots blancs ou rouges, etc.) et de légumes… – a par exemple largement fait la preuve de son efficacité en santé mentale : le suivi de plus de 12 000 Espagnols pendant six ans a notamment révélé que ceux qui mangent « méditerranéen » ont jusqu’à 30 % de risque en moins d’être touchés par la dépression que les autres.
Ce régime aide à la fois à prévenir et à soigner la dépression, ce qui est très rare : en dehors de l’alimentation, ce double pouvoir n’est pour l’instant attesté que pour l’activité physique et la méditation de pleine conscience.
Plus généralement, une méta-analyse de 2020 a montré que la consommation régulière de légumes diminue de 9 % le risque de dépression et celle de fruits de 15 % ».
Les compléments alimentaires d’Oméga-3 sont donc déjà proposés aux patients dépressifs, tandis qu’une autre piste est explorée, celle du microbiote intestinal, dont l’équilibre influencerait notre état psychologique. Des études en cours cherchent à valider les effets des probiotiques sur la dépression, mais aussi sur les troubles anxieux, l’hyperactivité, l’autisme, les addictions…
Malheureusement l’alimentation seule ne suffit pas à apporter les quantités nécessaires d’Oméga-3 ou de probiotiques et il faut recourir à la prescription de compléments : le bonheur n’est pas simplement dans l’assiette.
Se priver de la félicité sans atteindre le bonheur… le chemin vers la santé du corps et de l’esprit me semble étroit et tortueux.
Il va falloir se résoudre, comme pour de nombreux projets dans une vie, à tendre vers l’idéal sans jamais le saisir. De même qu’il faudrait pouvoir équilibrer félicité alimentaire et bonheur psychique, car un régime trop rigoureux et dépourvu de plaisir serait décourageant, il serait bon de savoir tricoter les recommandations universelles et la connaissance de ses besoins individuels.
Je n’irai pas chasser le mammouth un jour sur trois, mais je dois reconnaître que la joie de mon collègue à me décrire son mode alimentaire était parfaitement communicative ! Et cela, de manière spirituelle, m’a nourrie.
[1] Guillaume Fond, Bien manger pour ne plus déprimer, Odile Jacob, 2022.
[2] Emmanuel Salanskis, « La psycho-diététique de Nietzsche », in La question de la médecine dans la philosophie de Nietzsche, sous la direction d’Isabelle Wienand et Patrick Wotling, 2020.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de janvier 2024