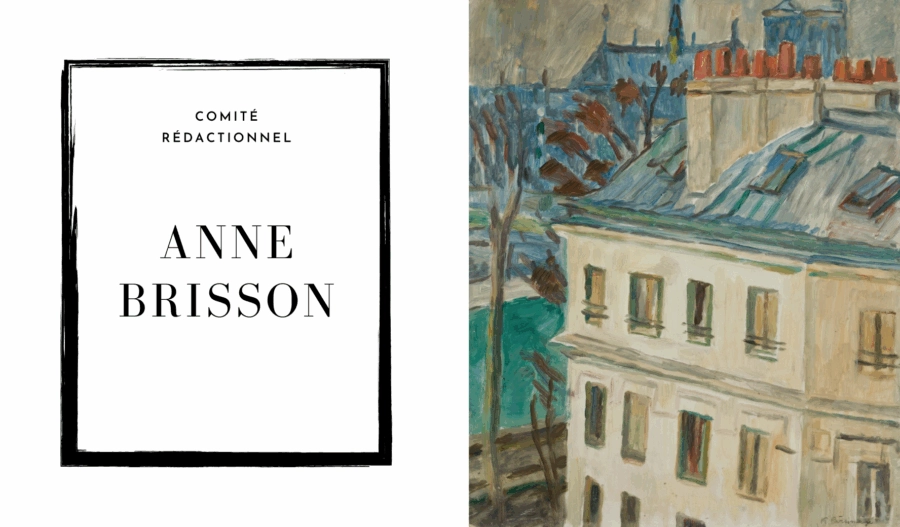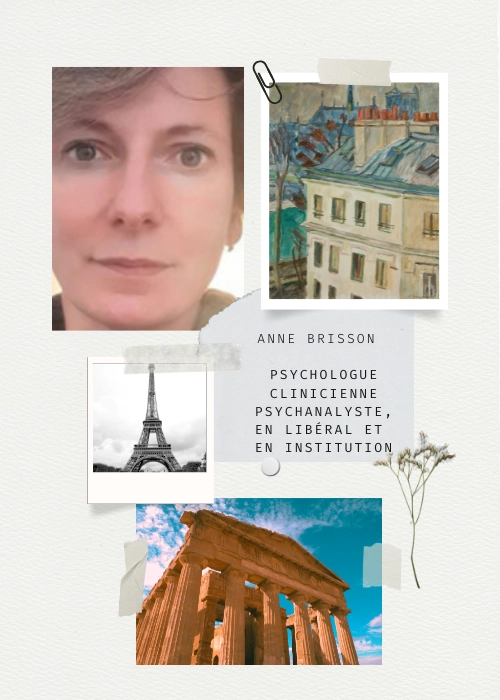« Si l’homme n’est pas fou, c’est qu’il n’est rien. Le problème c’est de savoir comment il soigne sa folie. Si vous n’êtes pas folle, comment voulez-vous que quelqu’un soit amoureux de vous ? Pas même vous, vous comprenez ? Ce qui ne veut pas dire que si vous ne savez pas être folle alors on va vous foutre à l’hôpital psychiatrique, parce que les fous qu’on met dans les hôpitaux psychiatriques, c’est des types qui ratent leur folie. L’important de l’homme, c’est de réussir sa folie »[1].
C’est ainsi que François Tosquelles, psychiatre espagnol, républicain, exilé en France, parle de la folie.
Dans un autre style, mais sur le même fil, Joyce McDougall fait elle aussi un « Plaidoyer pour une certaine anormalité[2] » : « A ceux, aujourd’hui nombreux, qui ne voient dans la psychanalyse que la forme même de l’effort pour « normaliser » toute expression déviante, ce livre apporte une double réponse. D’une part, il existe une « suradaptation » à la réalité dont seule l’expérience analytique révèle la misère psychique sous-jacente. D’autre part, les « déviations » les plus aberrantes témoignent, quand on parvient à en reconstruire le scénario inconscient, d’une créativité remarquable ».
Selon la définition de l’OMS, le concept de santé mentale qui émerge à la fin du 19e siècle suppose l’aptitude chez l’individu à nouer des relations harmonieuses avec autrui et à participer de manière constructive aux modifications du milieu social et physique.
Elle implique aussi la résolution harmonieuse et équilibrée des conflits en puissance parmi ses propres tendances instinctives. Comme l’explique Claude-Olivier Doron[3], l’idée centrale de ce mouvement moderne et progressif est la suivante : le sujet de la santé mentale, c’est l’individu et ses rapports avec l’environnement, et cela nécessite que « l’individu ait pu développer sa personnalité de façon à ouvrir à ses impulsions instinctives un champ d’expression harmonieuse dans la pleine réalisation de ses possibilités ».
Le projet était beau et plein de promesses et plaçait l’harmonie au cœur du système : d’abord à l’intérieur de l’individu pour un développement équilibré, puis à l’extérieur, entre les individus, pour un monde relationnel dans lequel tout conflit est neutralisé. C’est dans ce contexte que les thérapies de groupe prennent leur essor.
Rappelons que la source théorique de l’harmonie est psychodynamique, il s’agit de l’Ego psychology élaborée par Anna Freud dans sa recherche de l’équilibre entre les pulsions.
Lacan avait perçu dès le départ les enjeux politiques douteux du concept, et pourtant la santé mentale commence par engendrer des transformations positives : elle ouvre le champ de la psychiatrie, elle fait sortir les patients des asiles, elle fait diminuer la contention, soutient l’autonomie des malades, déploie les soins communautaires.
C’est ainsi que se développent les courants anglais, américains, italiens de l’antipsychiatrie et le courant français « désaliéniste ».
Ouvertures, critiques, élaborations, constructions de nouveaux modèles, et puis la bascule qui referme : « La notion de santé mentale, en venant se greffer à ces courants révolutionnaires, se constitue comme un opérateur de « désinstitutionnalisation » pour changer en profondeur les pratiques asilaires.
Quelques années plus tard, la désinstitutionnalisation sera l’argument clé des gestionnaires pour détruire le soin aux personnes psychotiques, sous prétexte de progressisme et de lutte contre l’asile »[4].
Belle idée moderne de la psychiatrie d’après-guerre, la santé mentale s’est transformée en outil de normalisation et de contrôle. Depuis les années 1980, comme le décrit Mathieu Bellahsen, « une neuropsychiatrie « scientifique » a ouvert la voie au discours gestionnaire : il s’agissait désormais de classer, de gérer, d’évaluer »[5].
Ainsi, une nouvelle phase d’expansion de la santé mentale commence et la conquête du terrain s’appuie sur l’édification de classifications internationales des maladies et des troubles mentaux.
« Ce modèle classificatoire s’est également fondé sur une convergence d’intérêts entre l’industrie pharmaceutique et le système assurantiel nord-américain »[6]. « En réalité, bien loin de soigner la pathologie en elle-même, les thérapeutiques médicamenteuses servent plutôt à entrer en contact avec la personne afin d’apaiser une souffrance trop vive et de permettre un travail de mise en sens. Cette dimension, la plus ardue, est pourtant la plus passionnante pour les cliniciens et la plus importante pour les patients. Si l’on prend l’exemple d’une personne reçue pour une bouffée délirante aiguë qui exprime la difficulté de son rapport aux siens et au monde qui l’entoure, dans une perspective DSM, le rôle du clinicien est de faire taire le délire pour amender le symptôme »[7].
Il n’est plus question de comprendre pourquoi cette personne délire à ce moment-là, sur ce thème-là. Pour Mathieu Bellahsen, abandonner la mise en sens, c’est aussi faire perdre aux soignants le sens même de leur travail, et cela « érige le renoncement au rang de science objective ».
Je suis plongée dans ces réflexions qui se font écho entre elles : j’écoute par hasard Claude-Olivier Doron qui parle de la santé mentale sur France Culture, il me fait penser à Mathieu Bellahsen et son livre qui raconte la façon dont la santé mentale est devenue outil de normalisation et de contrôle, qui, lui, cite François Tosquelles, qui me rappelle la découverte de l’antipsychiatrie pendant mes années étudiantes, et pour finir clignote comme un néon coloré dans ma tête la très belle formule de Joyce McDougall, « plaidoyer pour une certaine anormalité », qui m’a servi de guide dans ma découverte de la clinique.
Je suis immergée dans ce grand bain quand je croise Léa Fonder comédienne et auteure, dans un café de quartier qui accueille troupes et spectateurs à la sortie du théâtre Darius Milhaud.
C’est un cadre qui, quelques minutes après la fin du spectacle, défait la frontière entre la scène et la salle et qui permet les rencontres informelles et improvisées. Elle a écrit une pièce sur l’enfermement psychiatrique dont aurait pu croire qu’il avait évidemment changé de forme depuis les premiers asiles.
Et pourtant… même si dans l’histoire, chaque génération cherche à faire rupture avec la précédente, il existe des situations qui relèvent de la permanence.
Léa Fonder est partie d’expériences récentes d’hospitalisation pour convoquer des artistes célèbres qui ont vécu et écrit l’enfermement à des époques très différentes.
Vincent Van Gogh, Camille Claudel, Antonin Artaud, Sarah Kane et Virginie Despentes sont ainsi réunis l’espace d’une journée pour témoigner de leur vécu face à leur enfermement forcé : « Ces histoires me touchent. Elles révèlent l’absurdité de l’enfermement psychiatrique lorsqu’il est utilisé non dans le but de soigner, mais de mettre au banc de la société ceux qui y sont un tant soit peu réfractaires. Encore aujourd’hui et trop souvent la psychiatrie, à force de médicaments et d’infantilisation, a pour but de maîtriser les patients à défaut de les guérir. « Les Enfermés »[8] a été écrit dans le but d’exposer ces thèses, d’attirer le public dans cet asile imaginaire mais ô combien proche de la réalité. Le cadre offert à ces protagonistes pour se rencontrer et s’exprimer reflète leur génie, leurs angoisses, leur désœuvrement aussi, confrontés à un enfermement tant physique que mental ».
Voici un extrait du début de la pièce :
8h05
LE DOCTEUR. – Bonjour, bien dormi ?
VINCENT VAN GOGH. – Tous les matins, le docteur me réveille en en me posant cette éternelle question.
VIRGINIE DESPENTES. – Une question à laquelle il n’attend évidemment aucune réponse.
SARAH KANE. – Un jour je lui ai répondu : « Oui ça va merci. », mais il n’a pas écouté ma réponse.
LE DOCTEUR. – Vous n’avez pas besoin d’un ami, vous avez besoin d’un médecin. Nous avons une relation professionnelle. Je pense que nous avons une bonne relation. Mais c’est professionnel.
ANTONIN ARTAUD. – Le même personnage revient chaque matin accomplir sa révolte, criminelle et assassine, sinistre fonction, qui est de maintenir l’envoutement sur moi. De continuer à faire de moi cet envouté éternel, etc. etc.
Un peu plus tard, au moment de la distribution des médicaments :
ANTONIN ARTAUD. – Les médecins tiennent sous couveuse les morts.
SARAH KANE. – La nuit, les médicaments me plongent dans le coma ; arracher mon corps du lit me demande beaucoup d’efforts.
VIRGINIE DESPENTES. – Les mêmes cachetons que j’aurais payés en boite ou en concert, maintenant je lutte pour les recracher.
CAMILLE CLAUDEL. – On me force à me laver.
VINCENT VAN GOGH, il mord dans un sandwich. – Et à manger ! Je prends tous les jours le remède de l’incomparable Dickens contre le suicide. Cela consiste en un verre de vin, un morceau de pain et du fromage, et une pipe de tabac. Bien manger, bien vivre, voir un peu de femmes, en un mot vivre d’avance absolument comme si on avait déjà une maladie cérébrale et une maladie de la moëlle, sans compter la névrose qui elle existe réellement.
VIRGINIE DESPENTES. – Petit dèj’ pourri, l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais qu’on m’explique l’intérêt de faire bouger les internés si tôt, vu comment tout le monde s’emmerde.
LE DOCTEUR. – Rangez cette bouteille d’alcool Monsieur Van Gogh ! L’alcool ainsi que les drogues sont prohibés dans cet établissement ! Ne m’obligez pas à informer votre frère de votre conduite.
VINCENT VAN GOGH. – Tout de suite mon cher docteur. Quand j’ai cessé de boire, quand j’ai cessé de tant fumer – quand j’ai commencé à réfléchir au lieu de chercher à ne pas penser – mon Dieu quelles mélancolies et quel abattement.
CAMILLE CLAUDEL. – Le docteur veut que je me concentre sur des besoins primaires et veut me faire oublier tout le reste.
SARAH KANE. – Ma nourriture est pesée et on note ce que je parviens à ingérer ou non.
LE DOCTEUR. – On se doit d’avoir un œil attentif sur les anorexiques.
SARAH KANE. – Je suis grosse. Je ne peux pas manger. Je suis terrifiée par les médicaments. Mes hanches sont trop fortes. J’ai horreur de mes organes génitaux. Je ne veux pas vivre.
LE DOCTEUR, à Sarah. – Mangez Mademoiselle Kane s’il vous plait.
SARAH KANE, au docteur. – Est-ce que vous méprisez tous les gens malheureux ou est-ce que ça m’est réservé ?
LE DOCTEUR, à Sarah. – Je ne vous méprise pas. Ce n’est pas votre faute, vous êtes malade.
La pièce de théâtre de Léa Fonder raconte le déroulé d’une journée à l’hôpital à travers les ressentis des cinq artistes et, malgré les écarts dans le temps entre l’expérience de chacun d’entre eux, leur récit fabrique une trame commune qui permet de se représenter l’hospitalisation en psychiatrie, l’enfermement, ses constantes à travers l’histoire : contrainte, neutralisation des symptômes, rigidité de l’emploi du temps, régulation par les médicaments, entretiens répétitifs et dirigés, désœuvrement, ennui, isolement…
Dans un tel contexte, comment imaginer pouvoir relancer l’élan vital des patients ?
Je reprends ici les mots de Tosquelles : « Tout d’abord, je veux dire que jamais nulle particule de vie psychique naît du seul mouvement d’un homme isolé. Pour que la vie psychique naisse, il faut être plusieurs, plus ou moins rassemblés et en fait de genres très différents ; souvent de générations différentes. Il faut des rencontres-mouvements ; des déplacements dans l’espace et dans le temps – lesquels se conjuguent néanmoins en une seule danse par des ensemble qui se déroulent à des niveaux différents »[9].
Et donc, parce que lire les auteurs et aller au théâtre offrent la possibilité de faire dialoguer à l’intérieur de soi tout ce beau monde, que penserait Tosquelles de la pièce de Léa Fonder ?
Serait-il dépité de reconnaître des éléments qui soulignent la continuité entre l’enfermement de l’avant-guerre et l’enfermement psychiatrique dans sa forme moderne comme si la rupture épistémologique n’avait pas réussi à engendrer de modifications durables ?
Ou bien pourrait-il se réjouir qu’une expérience d’hospitalisation donne finalement naissance à la création d’une pièce de théâtre qui a entrainé des comédiens et des spectateurs dans des moments de partage vivant ? N’est-ce pas « réussir sa folie » que de transformer les institutions psychiatriques en théâtre de la vie et l’enfermement en un moment de construction créative ?
[1] Entretien de François Tosquelles par Cécile Hamzy, in Joana Maso, Soigner les institutions, L’Arachnéen, 2021
[2] Joyce McDougall, Plaidoyer pour une certaine anormalité, Gallimard, 1978
[3] Claude-Olivier Doron, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/comment-ca-va-la-sante-mentale-9056424
[4] Mathieu Bellahsen, La santé mentale, Vers un bonheur sous contrôle, Paris, La Fabrique éditions, 2014, p.44
[5] Mathieu Bellahsen, La santé mentale, Vers un bonheur sous contrôle, Paris, La Fabrique éditions, 2014
[6] Idem, p.55
[7] Idem, p.58
[8] Léa Fonder, « Les Enfermés », pièce de théâtre.
[9] François Tosquelles, « Emergences des crises vitales humaines », intervention reprise in Soigner les institutions, textes choisis et présentés par Joana Maso, L’Arachnéen, 2021