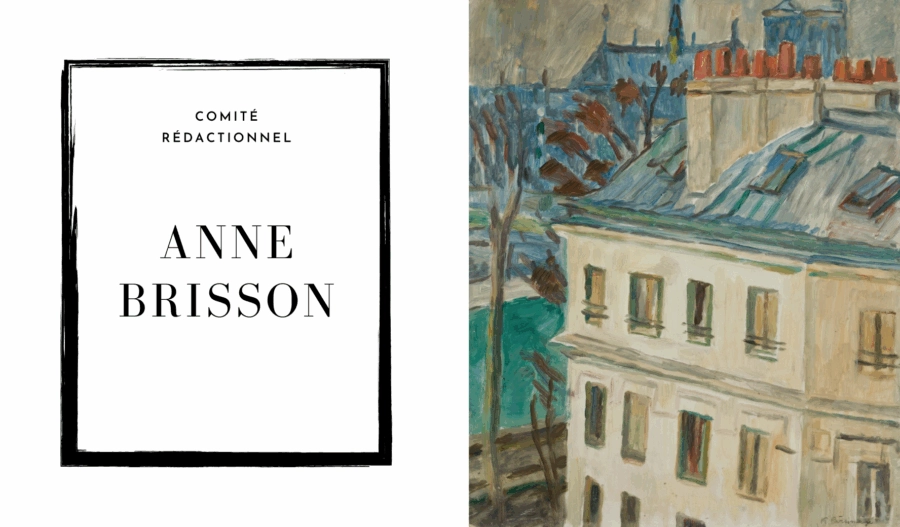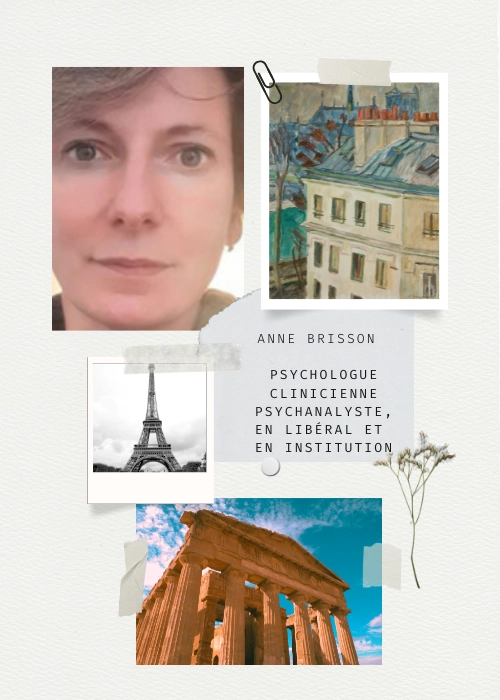Ainsi, lorsque la mort dans l’âme (et le fouet à la main), je me décide à boucler ma comptabilité 2022, persuadée d’en avoir pour plusieurs heures, voire plusieurs jours de labeur, quelle ne fut pas ma surprise en constatant que le travail de catégorisation avait progressé sans aucune intervention de ma part et que le logiciel me tendait sur un plateau doré une déclaration à finaliser en quelques clics…
On définit l’IA comme une discipline dont le but est de parvenir à faire imiter par une machine les capacités cognitives d’un être humain au moyen d’algorithmes et de calculs. Je suis forcée de constater que mon logiciel a très bien imité mes capacités cognitives, en matière de comptabilité en tout cas !
L’histoire de l’IA débute en 1943 avec les premiers travaux mathématiques qui cherchent à créer un réseau de neurones.
Le terme d’IA est prononcé en 1956, lors d’une conférence de John McCarthy (grand mathématicien à l’origine de la technique du « temps partagé » qui permet à plusieurs utilisateurs d’employer simultanément un même ordinateur), puis Arthur Samuel invente le terme de « machine learning » alors qu’il travaille chez IBM.
Un Français, Yann Le Cun, met au point le premier réseau de neurones artificiels capables de reconnaître des chiffres écrits à la main en 1989.
C’est le développement du « deep learning » qui aboutit en 1997 à un événement qui marque l’histoire de l’IA : le système Deep blue d’IBM triomphe du champion du monde d’échecs, Gary Kasparov.
Depuis les années 60, l’IA joue un rôle de plus en plus important, mais pas toujours visible ou repérable dans notre vie quotidienne, dès que nous avons recours aux machines et à la technologie.
La naissance de ChatGPT et sa mise en ligne en novembre 2022 permet un rapport plus lisible, direct et individuel avec l’IA. Chacun peut se connecter gratuitement à cet outil qui est décrit comme une IA conversationnelle capable de répondre instantanément à nos questions et d’adapter son discours en fonction de nos réponses.
Ce chatbot peut reconnaître ses erreurs, contester des informations incorrectes et rejeter des demandes inappropriées pour éviter les dérives. Depuis son lancement, les utilisateurs lui demandent de l’aide pour leurs devoirs, leur travail, lui posent aussi des questions subtiles ou absurdes pour tenter de mesurer sa puissance et ses manques.
Il y a ceux qui se réjouissent, ceux qui se méfient, ceux qui s’inquiètent. En famille, entre amis et en société les débats sont lancés : Pour ou contre ? Pourquoi faire et jusqu’où ?
Les ressources formidables de l’outil font rapidement passer de l’émerveillement à la crainte et des penseurs comme Noam Chomsky dans le New York Times, écrivent pour mettre en garde : « Alors que l’intelligence humaine est capable d’expliquer et de réguler, c’est-à-dire délimiter le possible et l’impossible, l’IA se contente de décrire et de prédire.
Le fait que nous ayons recours à des principes éthiques nous permet de déterminer ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. De son côté, l’IA produit de la pensée et du langage avec une certaine indifférence morale : « ChatGPT fait preuve de quelque chose comme la banalité du mal : plagiat, apathie, évitement (…) Ce système offre une défense du type : je ne fais que suivre les ordres, en rejetant la responsabilité sur ses créateurs »[1].
J’aimerais éviter et la fascination et la peur, pour garder ma curiosité vivante.
La première question qui me vient est de trouver ce qui, au sein de toute l’activité psychique humaine, pourrait résister à l’imitation par l’IA. Ce que dit Chomsky au sujet de la morale qui vient faire le tri dans ce que l’incroyable pouvoir de création narrative de l’homme peut produire me fait penser que la machine n’est pas encore en mesure de se regarder penser, ce que l’homme lui-même a déjà du mal à faire.
C’est ce que met en lumière le cadre analytique inventé pour favoriser l’exploration de son propre psychisme avec l’aide du psychisme d’un autre : le travail d’introspection est lent et parfois laborieux. Identité narrative, pensée associative, récit de rêve, récit de souvenir : comment l’IA pourrait se saisir de tout ce matériel qui puise dans deux sources à la fois, la conscience et l’inconscient.
Me revient le titre d’un Podcast qui m’avait beaucoup intéressée il y a déjà quelques années : « L’homme qui avait la formule mathématique des bonnes histoires »[2]. Yves Bergquist est chercheur dans le laboratoire « Entertainment Technology Center » de l’université de Californie du Sud, un centre où la technologie est donc au service du divertissement.
Son travail consiste à comprendre et prévoir les relations du public avec des contenus en s’appuyant sur des critères comme les personnages, les émotions exprimées, les structures narratives.
Pour Yves Bergquist, tout est récit : « Le divertissement est passé du statut d’objet dans nos vies à celui d’environnement dans lequel nos vies se déroulent. C’était un produit que l’on consommait avant de retourner à la réalité, il me semble que le divertissement, et le récit en général, est devenu ce qui fabrique la réalité ».
Ainsi, notre identité personnelle et nos choix sont façonnés par les processus narratifs qui nous entourent et qui nous constituent au cours de notre développement. Selon lui l’objectif de la psychothérapie est de se séparer des processus narratifs traditionnels imposés par les parents pour dégager les siens propres.
Si les processus narratifs sont au cœur de l’identité individuelle et collective, il devient très intéressant de pouvoir prédire quel type de processus narratif va pouvoir générer quel type de comportement chez les individus. Grâce à des millions de données issues de scripts, de livres, de chansons et rassemblées dans une base, les chercheurs ont conçu une formule mathématique capable de mesurer l’intérêt de tel contenu pour tel public.
Dans leur laboratoire, ils n’utilisent cette formule que pour mieux calibrer les divertissements au profit des intérêts économiques, mais sans doute que des formules similaires sont déjà utilisées dans bien d’autres domaines…
Yves Bergquist explique qu’il a fait sa formation à l’Université de la singularité, située dans la Silicon Valley. L’un des fondateurs est Ray Kurzweil, professeur au MIT, titulaire du prix américain de la technologie, qui est décrit comme une « machine cérébrale ultime »… et voici l’une de ses citations célèbres : « Télécharger un cerveau humain signifie scanner tous les détails essentiels et les installer ensuite sur un système de calcul suffisamment puissant.
Ce processus permettrait de capturer l’intégralité de la personnalité d’une personne, sa mémoire, ses talents, son histoire »[3].
Alors pour me rassurer sur la puissance et les limites actuelles de l’IA, je demande à ChatGPT de me raconter un rêve.
Il me répond sans hésitation et sans aucun délai, à la différence d’un humain qui aurait pris quelques secondes pour rassembler ses idées : « Bien sûr ! Voici un rêve imaginaire : dans ce rêve, je me trouve soudainement au sommet d’une montagne majestueuse, entourée de pics enneigés qui brillent sous la lumière du soleil. Je me sens léger comme une plume, capable de voler au-dessus de la vallée en contrebas »…
Le récit est féérique, fantastique, et s’appuie sur un assemblage d’informations sensorielles, il n’a aucun intérêt sur le plan du contenu. Alors je reformule ma requête : Raconte-moi un rêve qui pourrait intéresser Freud : « Bien sûr ! Le rêveur se trouve dans une forêt sombre et dense, où il se sent perdu. Il marche à travers les arbres, cherchant un chemin, mais il ne peut pas trouver de sortie.
Soudain, une créature mystérieuse et effrayante apparaît, mi-homme mi-animal, et le poursuit à travers la forêt. Le rêveur ressent une grande anxiété et un sentiment d’oppression pendant cette poursuite. Freud interpréterait peut-être ce rêve en mettant en avant le symbolisme.
La forêt dense pourrait représenter l’inconscient du rêveur, un endroit où il se sent perdu et confus. La créature mi-homme mi-animal pourrait symboliser des désirs ou des pulsions refoulés qui le poursuivent et lui causent de l’anxiété. Ce rêve pourrait être une expression de conflits internes et de désirs refoulés que le rêveur doit explorer pour mieux comprendre sa psyché ».
Étrangement, ce récit me touche, parce qu’il condense toutes les connaissances que la machine a enregistrées sur le rêve et sur Freud. Ce rêve d’angoisse est caricatural et son interprétation est simplifiée, le texte est cohérent et convenu, mais en utilisant le conditionnel la machine donne l’impression de prendre des précautions, de reconnaître son impuissance face à ce matériel qui, comme les souvenirs et les émotions, ne peut encore être transposé d’un cerveau à un autre, ni d’un cerveau à une machine.
C’est le propre de l’homme que de pouvoir s’attendrir, même à l’égard d’une machine qui n’en ressentira pas les effets… enfin jusqu’à présent.
[1] Noam Chomsky, Ian Roberts et Jeffrey Watemull, Tribune parue dans le New York Times, mars 2023.
[2] Podcast de Xavier Delaporte è juin 2021, in « Le code a changé », France Inter
[3] Ray Kurzweil, Humanité 2.0, la Bible du changement, 2007
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de septembre 2023