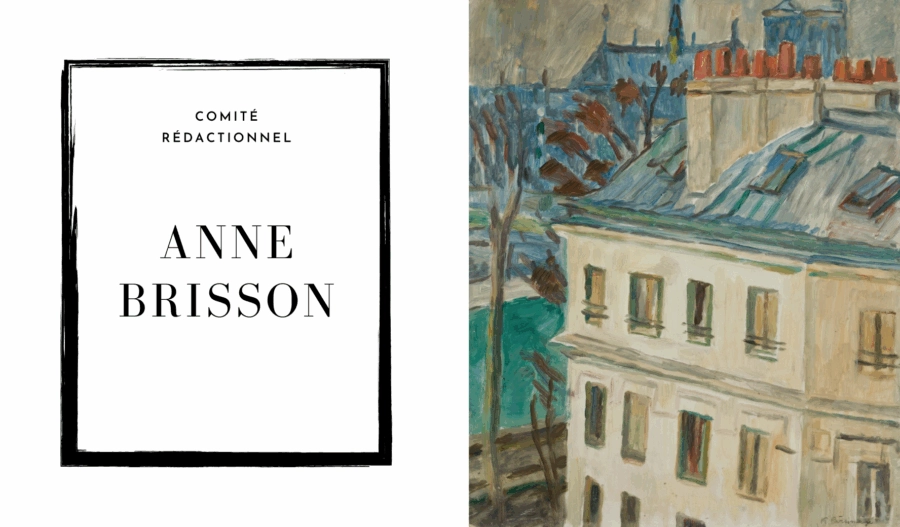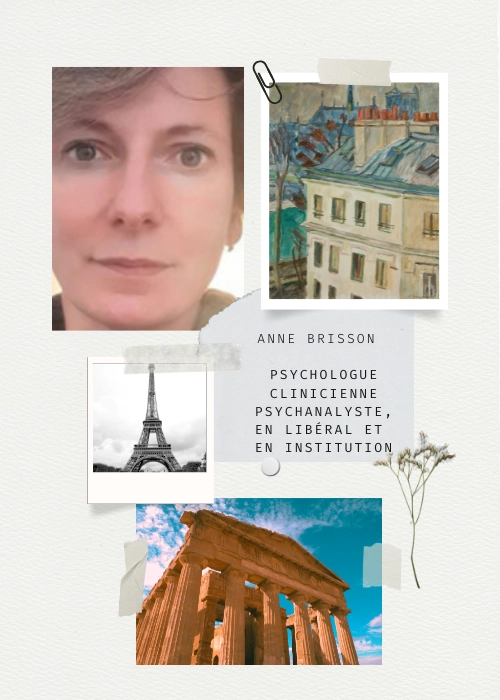J’espère simplement que dans quelques mois l’élaboration possible qui aura découlé de cette démarche me semblera intéressante et utile pour l’enfant et sa famille. Je marche et je rumine, une phrase me traverse l’esprit : « on ne va pas réécrire l’histoire »…
Non bien sûr, les événements historiques qui se sont produits dans la réalité ne sont pas malléables et ne peuvent être refaçonnés. Cependant on peut en raconter l’histoire, la raconter à plusieurs reprises, de manière diverse, à des personnes différentes.
On peut raconter l’histoire, celle qui s’appuie sur les témoignages et les preuves, mais aussi les histoires imaginaires, les contes, les légendes, parce que raconter contient toujours l’espoir ou la promesse de transformer les représentations, faire passer des messages, apprendre de l’expérience, afin que l’histoire qui va s’écrire ne reproduise pas les mêmes erreurs que celle du passé.
La narrativité est au cœur des sciences humaines : linguistique, philosophie, sociologie, littérature, psychologie, psychanalyse.
Elle traverse de nombreux champs et concerne le sujet humain de façon générale, parce que le récit, dès la naissance et jusqu’à la maturation, est lié à la construction du psychisme, à l’acquisition du langage, au développement de la communication, aux modalités relationnelles.
Par exemple, la qualité des constructions narratives constitue un critère essentiel pour l’approche dynamique du fonctionnement psychique de l’enfant, comme l’indique Laurent Danon-Boileau : « La notion de narrativité n’entretient donc pas avec la psychanalyse un lien fortuit.
Sa nécessité apparaît de manière particulièrement évidente dans le registre de la psychanalyse de l’enfant. Et quand René Diatkine souligne que l’un des effets souhaitables du travail avec un enfant pourrait être qu’il retrouve le plaisir de jouer, puis celui d’être le metteur en scène des récits qu’il propose, on saisit alors pleinement le lien avec la narrativité au sens de faculté de narrer »[1].
Pour les philosophes, l’homme structure son expérience temporelle par sa capacité à produire des récits. Ainsi, Paul Ricœur, dans son œuvre Temps et récit, cherche à élaborer une médiation entre la conscience interne de la temporalité et la succession du temps physique.
Le récit permet à l’homme de conjoindre le temps cosmique et le temps de l’âme. L’expérience humaine repose sur le recours au langage et sur la dimension temporelle. Sans passer par le récit, le sujet n’a pas d’accès au temps.
Je ne résiste pas au détour par la philosophie et vous propose de cheminer un moment avec Paul Ricoeur (cela me paraît difficile de simplifier ou réduire sa pensée). Lui-même s’appuie sur les concepts énoncés par Aristote dans son ouvrage La Poétique, pour développer la notion de « mise en intrigue ».
Aristote met en avant trois concepts fondamentaux : mimésis, muthos et katharsis. Ricœur traduit muthos par « mise en intrigue » et explique que le récit s’élabore en trois étapes. Mimésis I correspond à la précompréhension de l’action. Toute action implique des buts, des motifs, des agents et des circonstances. Ces différents concepts sont organisés en réseau et entretiennent des relations d’inter-signification.
Précomprendre la structure de l’action, c’est relier ces concepts les uns aux autres au sein même de l’enchaînement narratif. C’est aussi comprendre la médiatisation symbolique de l’action et sa structure temporelle. Mimésis I offre donc une précompréhension de l’agir humain dans sa sémantique, dans sa symbolique et dans sa temporalité.
Mimésis II est l’étape de la mise en intrigue proprement dite. Au centre de la « mise en intrigue » se trouve la notion de « concordance-discordance ». La concordance du récit implique la réunion de trois conditions.
Tout d’abord le récit doit être une totalité comprenant un début, un milieu et une fin. Un épisode ne peut marquer le commencement du récit que dans la mesure où il n’est déterminé par aucun événement antérieur.
Le milieu est caractérisé par le renversement de l’action qui provoque une rupture et qui noue l’intrigue.
La conclusion du récit doit présenter un caractère nécessaire, vraisemblable et acceptable. Ensuite, tout récit doit être complet : l’action doit être menée jusqu’à son terme et il ne doit manquer aucun épisode. Enfin, tout récit doit avoir une longueur appropriée.
Un récit trop bref ne permet pas la mise en scène des actions, leurs renversements et leurs dénouements, tandis qu’un récit trop long disperse l’intrigue.
Mimésis III correspond à la katharsis, c’est-à-dire à une re-figuration du monde du texte par le lecteur. Celui qui écoute ou lit un récit re-figure sa propre expérience du monde et, plus particulièrement, son expérience temporelle. Le monde du récit entre en relation avec le monde réel et reprend les expériences humaines au moyen du langage pour offrir un modèle de compréhension. C’est ainsi que le récit opère chez le sujet une transformation.
Ricœur fait du récit ce qui permet au sujet de structurer et d’unifier son expérience temporelle et par conséquent de se protéger de la menace d’éclatement ou de non-sens engendrée par sa condition d’être temporel.
L’œuvre de fiction comme le récit historique mettent en jeu l’expérience temporelle. Caractérisée par la concordance, l’activité narrative transforme l’inscription du sujet dans le temps en une trajectoire sensée.
Ceci conduit à la formule de Ricœur qui évoque celle de Lacan : « […] le temps est structuré comme un récit ».
La question du récit est articulée chez Ricœur au concept d’identité narrative qui apporte une solution au problème du maintien de l’identité personnelle à travers le temps et tient compte de l’identité du « sujet agissant ». Le sujet n’a qu’un accès indirect à sa conscience subjective en raison du détour nécessaire par le langage.
Ainsi la connaissance de soi est une interprétation de soi : c’est à travers son récit autobiographique que le sujet est amené à s’interpréter et à se comprendre.
Dans le récit, c’est non seulement l’action, mais le personnage lui-même et plus précisément son identité qui font l’objet d’une mise en intrigue. Le personnage est indissociable des actions dont il est l’auteur. Ce qui fait la spécificité de l’homme, selon Ricœur, c’est l’auto-désignation grâce à la capacité réflexive et au moyen du langage.
Le sujet peut se désigner comme locuteur, comme agent de ses actions, comme personnage et narrateur de sa propre histoire, à travers le récit de soi.
Le récit occupe donc une place essentielle dans la constitution de l’identité du sujet. Le sujet est raconté bien avant de pouvoir lui-même élaborer un récit autobiographique. Les récits des parents et de l’environnement familial constituent, avant même la naissance de l’enfant, les bases de son identité narrative.
Ricœur souligne aussi l’influence des récits littéraires sur la constitution du soi. Les pensées, les affects, les comportements des personnages permettent au sujet de se re-figurer ses processus psychiques et ses actions.
J’entends parler de la « médecine narrative » : A quelques jours d’intervalle, un article du journal Le Monde passe sous mes yeux et je tombe sur l’annonce de la création d’une chaire de médecine narrative au CHU de Bordeaux.
Je pense à l’articulation entre récit et soin, et la première association qui me vient est un souvenir de mes cours à l’université. Un professeur d’épistémologie nous raconte comment Freud est passé de la suggestion hypnotique à la cure par la parole et à la technique de l’association libre.
Je ne peux valider ce récit, je ne peux pas remonter le temps, ni suivre Freud à la trace pour vérifier que la narration qu’il fait de ses propres découvertes est authentique. Mais la vérité historique n’est pas mon sujet ici, l’histoire était passionnante à écouter et elle a servi de modèle à ma façon d’accueillir les patients.
C’est par son récit que cet enseignant m’a transmis des représentations et un cadre que j’utilise encore aujourd’hui dans ma pratique.
Alors je vous raconte cette histoire telle qu’elle s’est inscrite de manière condensée et subjective dans ma mémoire, il y a plus de trente ans : en 1885, Freud, âgé de 29 ans, vient en France pour rencontrer le Pr Charcot et suivre son enseignement à la Salpêtrière.
Il assiste aux présentations de malades hystériques dont les symptômes sont explorés et traités par la suggestion hypnotique. Ce que Charcot transmet à Freud et qui l’impressionne beaucoup, c’est que les faits cliniques ont la prééminence sur la théorie et qu’ils peuvent à tout moment la remettre en question.
Freud rentre à Vienne, ouvre son cabinet et commence à utiliser la suggestion hypnotique. Mais il abandonne cette technique assez rapidement : d’abord parce qu’il n’est pas très doué pour plonger ses patients dans un état hypnotique, ensuite parce que certaines patientes lui demandent de se taire, de les laisser parler sans les interrompre, de les écouter passer d’une idée à une autre…
Cette histoire met au centre du cadre thérapeutique la parole des malades, leur liberté de raconter sans être interrompu, ni influencé par un thérapeute dont le principal outil de soin est sa capacité à écouter sans brouiller ce qu’il recueille par ses propres représentations.
Dans les Etudes sur l’hystérie[2], Breuer parle de la « narration dépuratoire » de sa patiente qui permet la disparition des symptômes.
Freud écrit un peu plus loin : « Lorsqu’il s’agit, dans une analyse, de supprimer un symptôme capable de s’intensifier ou de réapparaître (douleurs, symptômes d’excitation tels que vomissements, sensations, contractures), on observe que le dit symptôme a, lui aussi, « son mot à dire » et c’est là un phénomène intéressant et qu’il n’y a pas lieu de redouter ». Le récit des patients et le discours des symptômes existent déjà chez Freud, dès sa formation à la fin du 19e siècle.
Revenons à l’actualité : Rita Charon[3] est à l’origine de la médecine narrative[4]. Professeur de médecine et docteure en littérature anglaise, elle a développé un cursus d’humanités médicales à l’université de Columbia.
Elle remet le récit du patient au cœur de la relation entre soignant et soigné : « Pendant mes études, j’ai évidemment appris à reconnaître et à soigner telle ou telle maladie, j’ai beaucoup travaillé la technique, mais personne, à la faculté de médecine, n’apprend aux étudiants à écouter ce que le patient renvoie.
Il y a des mots, mais aussi tout ce qui ne s’entend pas : des expressions du visage, des gestes de peur ou d’humeur… C’est pourquoi l’étude de la narration m’est devenue essentielle, parce que le récit devenait le pont entre le patient et moi ».
Le développement des humanités médicales commence aux Etats-Unis à la fin des années 70, mais Rita Charon et ses collègues sont les premiers à mettre en œuvre le mouvement intitulé « médecine narrative : « Nous avons intégré la philosophie, la phénoménologie, le roman, la théorie littéraire pour nous aider à mieux comprendre comment fonctionne les histoires. L’objectif étant de lire dans les patients ».
Avant Rita Charon, il y a eu Paul Ricoeur, avant lui Freud et bien avant encore Aristote. La pensée prend forme sur un socle ou se tisse sur une trame déjà existante. Si l’on cherche à détruire certaines parties du socle théorique, on fait des trous dans la trame narrative et je ne comprends toujours pas à quoi cela pourrait bien servir…
Pour Ricœur, seul un être capable de rassembler sa vie sous forme d’un récit est par ailleurs capable d’accéder à cette identité éthique qui est celle de la promesse tenue. « Toute initiative est une intention de faire et, à ce titre, un engagement à faire, donc une promesse que je fais silencieusement à moi-même et tacitement à autrui, dans la mesure où celui-ci est, sinon le bénéficiaire, du moins le témoin. La promesse, dirai-je, est l’éthique de l’initiative. Le cœur de cette éthique est la promesse de tenir mes promesses »[5].
Pour la nouvelle année qui se profile dans le froid et la nuit, faites un récit de vos expériences cliniques, de vos constructions théoriques, des représentations que l’on vous a transmises et de celles que vous avez partagées, racontez le contenu, les détails et le décor de vos bonnes résolutions, aidez-les à se transformer en promesses qui s’accomplissent.
[1] Laurent Danon-Boileau, « La qualité narrative de la parole en analyse », in Revue Française de Psychanalyse, 1998, 62, 3, p. 722.
[2] Breuer et Freud, Etudes sur l’hystérie, Paris, PUF
[3] Rita Charon, Médecine narrative. Rendre hommage aux histoires de maladies, 2015, Sipayat.
[4] Entretien avec Rita Charon, par Nathalie Brafman et Pascale Santi, Le Monde, lundi 11 décembre 2023.
[5] Ricoeur, « L’initiative », 1986, in Du texte à l’action. Essais d’herméneutique II, Paris Le Seuil, 1998.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de décembre 2023