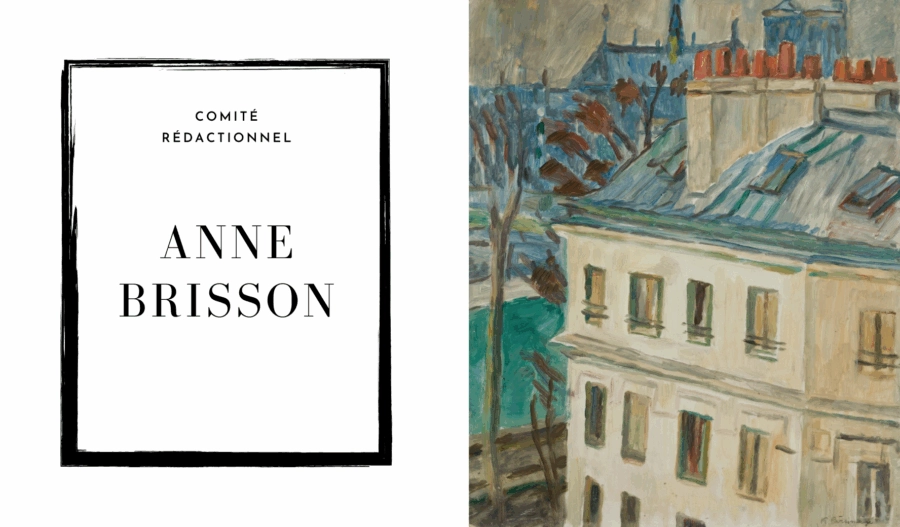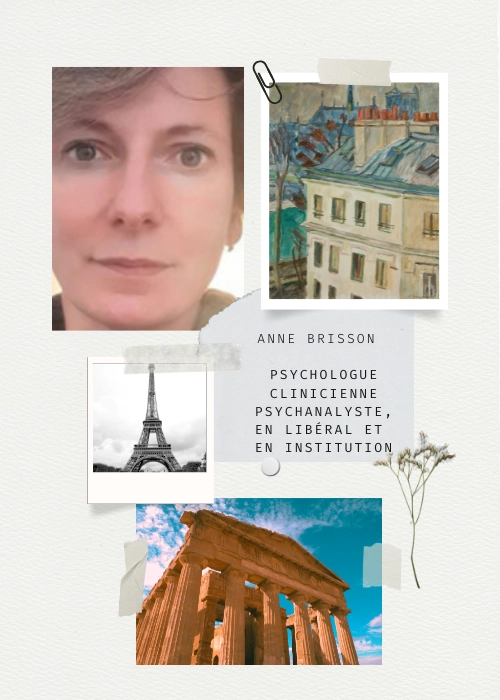J’ai eu la chance de commencer une psychothérapie à l’âge de 16 ans, puis de découvrir les écrits de Freud grâce au programme de philo de terminale.
Il ne m’a pas fallu très longtemps, après cette double rencontre, pour proclamer que j’avais remplacé mes parents bien réels par deux figures nettement plus faciles à admirer sans l’embarras des conflits intergénérationnels : ma psychanalyste et Sigmund Freud, mes nouveaux parents, bienfaiteurs en charge de la naissance de mon autonomie psychique.
Et comme tout adolescent en phase de provocation déclamatoire et bruyante, j’ai braillé cette information sur tous les toits ! (C’est le moment de rendre hommage à mes vrais parents qui ont assez bien toléré la substitution transitoire).
L’adolescence, c’est le moment sacré des transmissions, c’est la période où créativité, partage des connaissances et identification se combinent au service de l’autonomie et de la construction identitaire.
Comme l’écrit Michèle Emmanuelli dans son article[1] sur ce thème, l’adolescence est une période charnière au cours de laquelle « réactivation pulsionnelle et actualisation de la problématique de la perte d’objet, devenues menaçantes, se conjoignent en effet pour fragiliser le narcissisme, sur un mode stimulant pour certains et désorganisant pour d’autres ».
Sur le versant positif, émergent les jeux avec le langage, l’humour, l’investissement pour des activités artistiques, l’amorce de l’écriture de soi dans le journal intime.
« Par toutes ces voies, le jeune sujet cherche à mettre en forme ce qu’il ressent de manière confuse et parfois envahissante, à traiter psychiquement l’agglomérat d’affects, de sensations et de représentations que Bion[2] rassemble sous le terme d’éléments bêta pour décrire la naissance de la pensée.
Ces éléments bêta, dans la petite enfance, sollicitent la capacité de rêverie maternelle pour être métabolisés, transformés en éléments alpha : à l’adolescence, c’est la capacité du sujet lui-même qui est sollicitée.
Mais devant la difficulté à s’approprier de manière autonome cette fonction maternelle, l‘adolescent cherche appui sur une fonction tierce -paternelle- qu’un adulte est parfois à même de lui offrir, du moins un temps, dans le passage de l’enfance à l’entrée dans l’âge adulte ».
Michèle Emmanuelli choisit trois auteurs d’œuvres littéraires pour essayer de comprendre comment certains adultes apportent la transmission des savoirs et le soutien de la créativité aux adolescents.
Elle met très rapidement l’accent sur le processus identificatoire qui permet d’intérioriser certaines figures à l’adolescence, des figures porteuses de valeurs et qui vont rester vivantes et actives tout au long de la vie.
C’est ainsi que la transmission est une dose d’énergie qui circule bien longtemps après le moment où les savoirs et les expériences sont partagées. C’est un lien qui reste vivant à l’intérieur de celui qui a reçu aussi bien que de celui qui a transmis.
Pour exemple, Albert Camus sera éternellement reconnaissant à l’égard de son instituteur, monsieur Germain, auquel il écrit après avoir reçu le prix Nobel en 1957 : « Quand j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d’honneur. Mais celui-là est pour moi une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a cessé d’être votre reconnaissant élève ».
L’instituteur a joué le rôle d’un passeur, qui donne à l’enfant puis à l’adolescent les connaissances et l’impulsion nécessaire pour franchir la frontière des classes sociales et prendre un chemin très différent de celui prédestiné par le milieu familial.
Vient ensuite l’exemple de Maupassant, puis celui de « l’éveil de Rimbaud ».
Maupassant, alors qu’il a 18 ans et qu’il écrit quelques poèmes, fait une double rencontre décisive : le conservateur de la bibliothèque de Rouen et Gustave Flaubert. Ces deux figures paternelles solides, présentes et stimulantes occupent la place laissée vacante par le père réel de Maupassant, décrit comme « un grand enfant sur qui on ne peut compter ».
Le transfert paternel est ici favorisé par la différence d’âge, mais la fonction de transmetteur peut être endossée par un pair à peine plus âgé. Ainsi Arthur Rimbaud, lycéen âgé de 17 ans, rencontre Georges Izambard, enseignant remplaçant âgé de 21 ans.
Izambard considère Rimbaud comme un adulte, le traite avec un respect dont le jeune homme n’a pas l’habitude, lui donne accès aux ouvrages de sa bibliothèque : il joue le rôle d’un « éveilleur ».
On sait que l’éveil de Rimbaud ne survivra pas à la fin de son adolescence, que la greffe identificatoire ne prendra pas, et c’est ainsi que la transmission implique investissement réciproque, plaisir et liberté partagés, sans aucune garantie de résultat !
Ces exemples de transmissions mettent en lumière le maillage très serré entre connaissances et affects, savoir et libido. L’occasion rêvée de revenir sur une œuvre ancienne mais source d’inspiration, Le Banquet de Platon[3], car c’est un dialogue qui s’interroge sur le rôle d’Eros dans l’éducation.
Dans ce texte dont la forme même est celle de la transmission, deux modèles d’enseignement s’affrontent, masculin et féminin, deux formes de relation avec le même objectif de transmission.
Le banquet dont il est question chez Platon, est une réception privée offerte par Agathon pour fêter sa victoire comme poète tragique au concours des Lénéennes en 416. Les convives partagent les mets et le vin, mais surtout ils prononcent des discours sur des thèmes choisis.
Parmi les convives qui sont essentiellement des hommes, il y a des maîtres et des élèves qui entretiennent des relations d’enseignement mais aussi des relations amoureuses.
Phèdre propose de prendre Eros comme thème de tous les discours. En 416 donc, deux modèles d’enseignement existent. Le modèle masculin, la paiderastia, implique une relation sexuelle entre le maître et l’élève dans un objectif socio-éducatif et encadrée par des règles de conduite.
En effet, à cette époque de l’Athènes classique, le maître a pour tâche de faciliter l’entrée du jeune homme dans la société masculine, l’enseignement est associé à des rapports sexuels qui prennent fin quand le jeune homme est en âge de se marier.
Dans la mesure du possible, le désir, le plaisir et les sentiments devaient être écartés de cette relation de transmission, la sexualité est en quelque sorte une monnaie d’échange. Socrate s’oppose à ce modèle en reprenant l’argumentation d’une femme, Diotime, qui propose un modèle féminin de transmission.
Diotime critique de manière radicale l’institution masculine dominante en Grèce ancienne et élabore un autre modèle de transmission qui s’appuie sur la comparaison avec la grossesse et l’accouchement.
Le maître ne cherche pas « à remplir » le disciple de savoir relatif aux choses sensibles, mais le conduit, par conversion, à détourner les yeux de son âme du monde sensible pour contempler les formes intelligibles (réalité véritable dans la mesure où les choses sensibles n’en sont que les images) : il s’agit de découvrir ce que l’on possédait déjà.
Ce modèle est celui de la maïeutique, une technique d’entretien développée par Socrate qui prenait le temps de bien interroger les personnes, en respectant leur rythme, pour les amener à formuler leurs connaissances et faire émerger le savoir caché en soi. On ne peut, ici, que souligner la proximité avec la technique psychanalytique.
Je n’ai plus 16 ans et je suis devenue parent d’un jeune homme qu’il faut soutenir pour traverser le tunnel des concours qui permettent d’accéder aux écoles.
Transmission de savoir-faire et transfusion de libido narcissique. Le jeune homme m’annonce qu’il va aider un ami qui se trouve démuni à constituer les mêmes dossiers. Le jeune homme n’est pas encore complètement autonome, mais il a suffisamment reçu et métabolisé pour avoir le désir de redistribuer ce qui lui a été transmis.
Cette capacité naissante à transmettre me paraît encore plus précieuse et riche de promesses que l’autonomie complète ou la reconnaissance à l’égard des adultes.
Comme le dit Michèle Emmanuelli, la transmission, parce qu’elle s’appuie sur un système d’échanges, ouvre un espace de « cocréation, au sein duquel il peut y avoir reconnaissance mais pas de dette ».
C’est un circuit par dérivation ! L’énergie de la transmission se propage sans boucler sur elle-même, elle circule et irrigue les liens, elle rend visible de nouvelles créations, comme une floraison qui réjouit et l’élève et le maître : « Ce n’est pas la peine de me remercier. J’ai eu moi aussi tellement de plaisir à travailler avec toi et j’ai beaucoup appris en même temps »[4].
[1] Michèle Emmanuelli, « Créativité et transmission : le passage par l’identification », Cliopsy, n°2, 2009, pp. 59-64.
[2] W.R. Bion, Eléments de psychanalyse, Paris, 1973, Puf.
[3] Platon, Le Banquet, traduction de Luc Brisson, 2007, Garnier Flammarion.
[4] Karen Horney, Journal d’adolescence, 1980.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de mars 2024