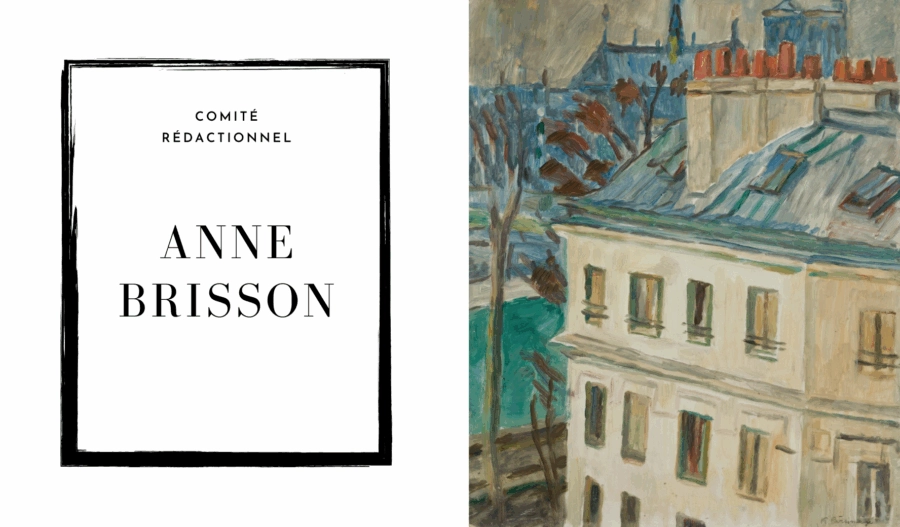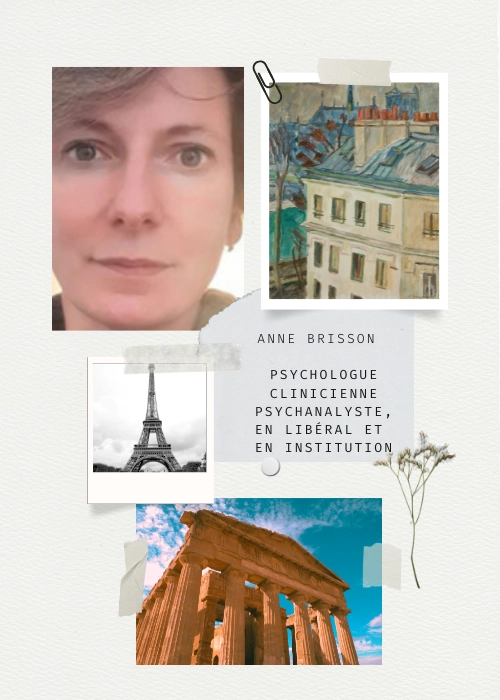Un jour j’écrirai un plaidoyer pour les cafés parisiens et les bars de quartier où existe encore un brassage de générations, de cultures, d’origines et de catégories socio-économiques, à une époque où les applis de rencontre cultivent un certain entre-soi à l’aide de leurs puissants algorithmes.
Donc je rencontre Charlie, 30 ans, monteur de films et adepte de boxe thaï, une rencontre qui doit beaucoup au hasard puisque nous avons peu de points communs au premier abord : nous ne sommes pas de la même génération, nous n’arpentons pas le même champ professionnel, nous n’avons pas les mêmes loisirs.
Je discute avec Charlie qui sort du cinéma et qui parle avec enthousiasme du film qu’il vient de voir, « Dream scenario ». Il mentionne, alors qu’il n’a aucune référence spécifique en psychologie, la notion d’inconscient collectif.
Dream scenario est un film de Kristoffer Borli qui raconte la tranche de vie d’un professeur de biologie de l’évolution : Paul Matthews mène une existence banale, discrète et sans panache, jusqu’au moment où il apparaît soudainement dans les rêves de millions de personnes.
Il devient célèbre du jour au lendemain, propulsé au rang de star des réseaux sociaux et reçoit l’attention qui lui a été longtemps refusée. Malheureusement, alors qu’il était d’abord apparu dans les rêves de chacun sous les traits d’un personnage observateur et inactif, il devient le personnage méchant, le monstre des cauchemars, violent et prédateur.
A peine a-t-il le temps de profiter de sa nouvelle célébrité qu’il devient l’homme à neutraliser et à abattre, en raison de l’indistinction qui s’installe entre réalité psychique et réalité externe. L’acteur principal, Nicolas Cage, a fait dans sa vraie vie une expérience similaire et c’est la raison pour laquelle il a été séduit par le scénario.
En 2013, cet acteur connu depuis longtemps pour ses rôles avec de grands réalisateurs américains, découvre qu’il est devenu « viral » : une vidéo mashup[1] de ses crises de colère explosives les plus célèbres dans ses films ont fait de lui un phénomène et l’ont dépassé.
Il raconte qu’il s’est senti dépouillé de sa propre identité en devenant un mème[2] et que cette image de « fou », transposée et remise en forme par le montage, était devenue une réalité pour les gens.
Les réseaux font circuler des informations auprès d’individus, mais peut-on considérer que partager les mêmes informations produit du lien social ? Quelles sont les articulations possibles entre partage virtuel et inconscient collectif ?
Une société composée d’individus de plus en plus différenciés et autonomes qui se rencontrent par l’intermédiaire d’applis et de réseaux est-elle encore une société ?
Dream scenario tricote finalement de nombreux thèmes : le rêve, l’inconscient collectif, la célébrité, les réseaux sociaux et ce qu’ils produisent comme effet sur les interactions sociales.
De cette pelote, je vais suivre deux fils : celui du lien social et de la reconnaissance et celui de l’inconscient collectif, bien que j’aie très peu lu Jung pendant mes années universitaires.
Je me suis intéressée à Serge Paugam parce que c’est un sociologue qui s’appuie sur la théorie de l’attachement de Bowlby pour construire une théorie du lien d’attachement social.
Bowlby et ses successeurs ont décrit comment, à partir du lien précoce qui s’instaure entre la mère et le bébé, se dégage une figure d’attachement qui laisse une empreinte durable dans la construction de la personnalité de l’individu et de ses liens avec le monde.
Or il existe une résonance possible entre l’empreinte des éthologues et l’habitus des sociologues, qui est défini comme une prédisposition à agir à partir de l’intériorisation de normes et pratiques dans lesquelles on est socialisé.
Il existe aussi un lien important entre attachement social, protection et besoin de reconnaissance : « Les sociologues savent que la vie en société place tout être humain dès sa naissance dans une relation d’interdépendance avec les autres et que la solidarité constitue à tous les stades de la socialisation le socle de ce que l’on pourrait appeler l’homo sociologicus, l’homme lié aux autres et à la société, non seulement pour assurer sa protection face aux aléas de la vie, mais aussi pour satisfaire son besoin vital de reconnaissance, source de son identité et de son existence en tant qu’homme »[3].
Restons concentrés sur ce que Serge Paugam dit de la reconnaissance : « Elle oblige les individus à une construction identitaire qui passe par la quête d’une valorisation personnelle perpétuellement soumise au regard d’autrui.
La reconnaissance naît de la participation aux échanges de la vie sociale. Moins automatique que dans les sociétés où l’individu appartient avant tout à un cercle étroit, elle est aujourd’hui, dans les sociétés où les multiples liens sociaux s’entrecroisent, un objet de conquêtes et donc de luttes »[4].
A l’heure des réseaux sociaux et des interactions virtuelles, la reconnaissance naît tout autant des échanges fabriqués pour être postés et partagés sur Internet que de ceux vécus dans la réalité.
Serge Paugam s’appuie sur les observations de Georg Simmel pour dire que l’élargissement quantitatif du groupe produit une différenciation accrue de ses membres et se traduit par une individualisation plus poussée. Mais l’homme reste « un être de liaison » : « les individus sont liés par des influences et des déterminations éprouvées réciproquement ». La société est ainsi une construction fonctionnelle, que les individus font et subissent à la fois.
Serge Paugam cite aussi George Herbert Mead qui est considéré comme l’un des pères fondateurs de la psychologie sociale moderne pour avoir démontré la primauté de la perception de l’autre sur le développement de la conscience de soi : selon lui, un sujet ne prend conscience de lui-même que dans la mesure où il apprend à considérer ses actions à travers les échanges qu’il établit avec des personnes elles-mêmes engagées et orientées les unes envers les autres.
L’investissement affectif dans un « nous » est d’autant plus fort que ce « nous » correspond à une entité, réelle ou abstraite, sur laquelle et pour laquelle la personne sait pouvoir compter.
L’individu cherche aussi bien à compter sur les autres qu’à compter pour eux. Par conséquent, le « nous » est constitutif du « moi ». Les liens qui assurent à l’individu protection et reconnaissance possèdent une dimension affective qui renforce les interdépendances humaines. Il existe différentes formes de reconnaissance en fonction de la nature des liens : la reconnaissance affective en famille, la reconnaissance affective et par similitude entre amis et proches que l’on choisit, la reconnaissance par le travail et l’estime sociale qui en découle.
Ainsi je découvre (car il n’est jamais trop tard) que la sociologie et la psychologie sociale empruntent à la théorie de l’attachement de Bowlby : il existe un lien étroit entre la qualité des attachements vécus dans la prime enfance (liens d’attachement primaires) et la capacité à établir ultérieurement des relations intimes, équilibrées et satisfaisantes (liens d’attachement secondaires).
Selon Serge Paugam, la socialisation et la trame construite par les institutions sociales permettent à l’individu de tricoter des attachements multiples qui vont lui assurer protection et reconnaissance.
Passons maintenant à l’autre fil associatif : L’inconscient collectif est un concept développé par Jung[5], psychologue suisse et camarade intellectuel de Freud avant que leurs chemins théoriques divergent et les conduisent à la rupture.
L’inconscient collectif est une couche de l’inconscient partagée par tous les êtres humains, indépendamment de leur culture, de leur éducation ou de leur expérience personnelle. Il est composé de symboles, d’archétypes et de motifs universels qui sont présents dans les mythes, les légendes, les contes, les religions de toutes les cultures et qui sont des représentations de nos instincts les plus profonds, de nos peurs et de nos désirs les plus primaires.
Jung a décrit 12 archétypes, qui sont comme 12 personnages que l’on peut rencontrer dans toutes les trames narratives : le héros, le sage, l’amoureux, l’innocent, le hors-la-loi ou rebelle, le bouffon, le magicien, l’explorateur, le leader, le créateur, l’orphelin. Pour Jung, ces archétypes représentent des forces universelles et intemporelles qui influencent nos émotions et nos comportements.
L’ajout de cette dimension collective à l’inconscient individuel a permis de mettre en évidence l’idée que nous faisons partie d’un tout dans lequel nous sommes tous liés.
Malgré nos différences, nous partageons tous un socle commun et des influences qui nous rassemblent et pourraient permettre de mieux définir notre place dans le monde et notre place les uns par rapport aux autres, c’est-à-dire notre place dans le lien social.
A lire Jung, longtemps après mes études et après de nombreuses expériences cliniques, je me dis que ses concepts sont avant tout intéressants pour construire ou décoder des histoires, davantage que dans le travail d’introspection psychanalytique, mais cela n’engage que moi !
Dans le film Dream scenario, on voit bien comment les concepts jungiens sont convoqués pour mettre en scène des sujets de société et qui touchent au lien social.
Un personnage bien réel s’immisce dans le rêve des autres sans l’avoir souhaité, il se promène comme si l’inconscient était un réservoir collectif dans lequel chaque dormeur puise les personnages de ses scénarios nocturnes.
Sa présence dans les rêves se propage sur toute la planète à la manière d’une épidémie. Il devient célèbre malgré lui parce qu’il s’impose dans le psychisme des gens de la même manière que certaines images s’imposent à nous dans le fil proposé par les réseaux sociaux.
Sa célébrité comble immédiatement son besoin de reconnaissance, car ni ses proches, ni ses collègues n’ont eu l’occasion de lui porter l’intérêt et l’admiration qu’il attendait. Parce qu’il devient un personnage monstrueux, son apparition transforme les rêves en cauchemars.
Sa célébrité prend alors une valeur négative. La distinction entre ce qu’il est en réalité et le rôle qu’il incarne dans les cauchemars s’efface rapidement. Il est confondu avec son avatar et il est considéré comme responsable des actes terribles qu’il commet virtuellement dans les cauchemars. Comme sur les réseaux sociaux, la frontière entre le réel et la réalité refaçonnée ou mise en scène est progressivement gommée.
Finalement, je comprends l’inconscient collectif comme un réservoir de représentations qui traversent les générations, qui nous sont transmises depuis le début de la vie par notre environnement à travers toutes sortes de contenus dont le support évolue dans le temps grâce aux progrès technologiques (depuis les peintures rupestres, la transmission orale, les débuts de l’imprimerie jusqu’aux réseaux sociaux).
Parce que ce réservoir immatériel existe et que chacun peut s’y connecter, individuellement ou collectivement, le partage se produit et participe certainement d’une certaine forme de lien social.
Ce dont je pourrais discuter avec Charlie, la prochaine fois que je le croise au bar, c’est que le film Dream scenario m’a procuré une bonne dose de frustration car il ne donne aucun élément pour comprendre pourquoi le personnage principal apparaît dans les rêves de millions de personnes à travers le monde.
Ce qu’il promet par ailleurs, sans davantage d’explications, c’est que les rêves deviennent le prochain espace de rencontres virtuelles : de cette idée imaginaire qui pourrait devenir réalité, j’aimerais savoir ce que Freud et Jung auraient pensé…
[1] Le mashup est un genre musical hybride, une chanson créée à partir d’une ou deux autres chansons pré-enregistrées, habituellement en superposant la partie vocale d’une chanson sur la partie instrumentale d’une autre.
[2] Un mème Internet est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet. Il prend souvent la forme d’une photo avec ou sans légende, d’une vidéo, d’une phrase, d’un mot, d’un gif animé, d’un son, d’un personnage fictif ou réel ou d’une communauté.
[3] Serge Paugam, Le lien social, Puf, 2022
[4] Serge Paugam, Le lien social, Puf, 2022
[5] C.G. Jung, Psychologie de l’inconscient, 1952, 1986, 1989, 1993, Georg éditeur
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO d’avril 2024