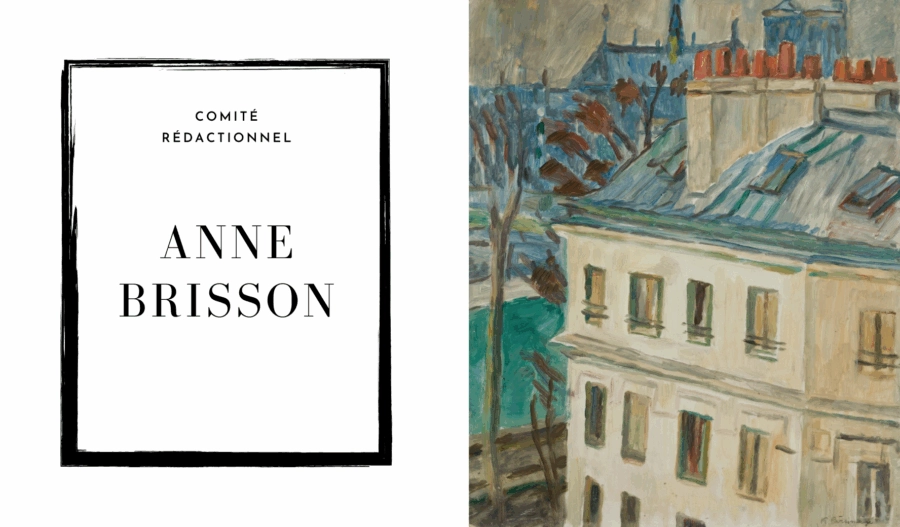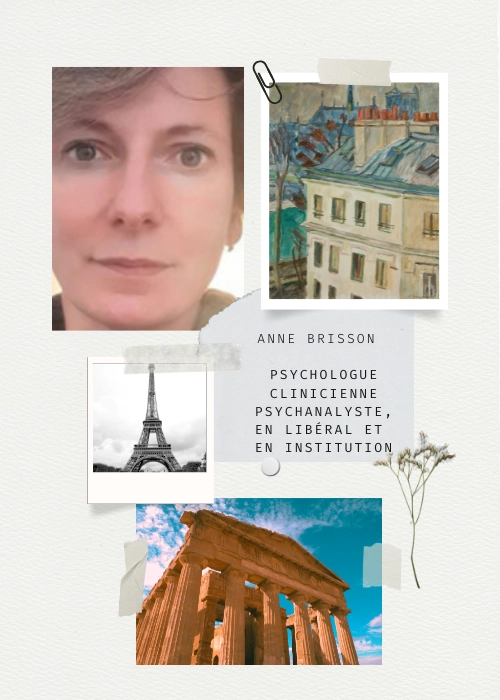A chaque fois que je rencontre un bébé, je ne peux m’empêcher de m’identifier à ses parties les plus vulnérables. Je suis immédiatement attentive à ce que la passivité inhérente à son stade de développement psychomoteur lui impose. Très souvent, je souffre (je sais que ce mot est excessif, mais c’est avec cette intensité que je l’éprouve) de le voir manipulé par un adulte qui essaie plus ou moins de deviner ses besoins, avec tous les tâtonnements que cela implique. Sans doute, que le contact avec un bébé me ramène à mes propres expériences de nourrisson, celles qui précèdent l’acquisition du langage, celles que je ne pourrai jamais mettre en récit, mais que mon corps ressent à nouveau, en s’appuyant sur les traces mnésiques les plus anciennes.
Un article d’Erika Parlato-Oliveira, psychanalyste et docteure en sciences cognitives et psycholinguistique, relance mes réflexions sur ce que les bébés parviennent à exprimer de leurs pensées : « L’intentionnalité des bébés est un sujet très sensible dans différents domaines de connaissance. Elle crée des difficultés pour plusieurs disciplines qui ont construit leurs fondements conceptuels et leurs pratiques cliniques et pédagogiques sur la base d’un bébé qui n’avait aucune condition pour interagir avec les autres, sauf lorsqu’il était provoqué par autrui. Le processus interactionnel partait toujours de l’extérieur, de l’autre, et le bébé attendait alors, attendait d’être encouragé par cet autre qui le cherchait »[1].
Il faut se souvenir du bébé comparé à de « la cire molle » comme le fait Descartes en son temps. Dans la Lettre à Chanut du 1re février 1647, il écrit : « Les âmes des enfants sont comme une cire molle propre à recevoir toutes sortes de figures, mais incapable d’en former aucune par soi-même ». Tout comme une matière totalement malléable prend la forme du moule qui l’imprime, l’esprit de l’enfant serait façonné par son environnement, son éducation et ses perceptions. Cette idée est reprise par les penseurs qui souhaitent justifier la nécessité d’une éducation rigoureuse puisque ce serait l’instruction qui pourrait principalement modeler l’intellect et orienter l’individu vers la vérité.
Erika Parlato-Oliveira poursuit son développement sur l’intentionnalité des bébés et explique qu’ils ne s’engagent pas dans l’imitation de l’adulte de manière automatique, mais que l’imitation est le signe de leur désir d’être en relation et de communiquer : « les bébés ne peuvent plus être vus comme des êtres passifs attendant les autres, mais plutôt comme des agents actifs et provocateurs, qui recherchent les autres non seulement pour les avoir à proximité, pour leur sécurité et leur confort, mais aussi pour comprendre comment cette autre personne agit et se rapporte à lui ».
Ce retour sur l’histoire de la psychologie du bébé, sur tout ce qui de ses intentions a été ignoré si longtemps, me donne quelques frissons. Je me souviens alors d’un cours à l’université qui évoquait les travaux de René Spitz[2]. Ce psychiatre psychanalyste américain d’origine hongroise (1887-1974) a étudié le développement de l’enfant, de la naissance à deux ans. Il a mis en évidence le diagnostic d’hospitalisme et la dépression anaclitique à partir des carences affectives qu’il observe chez les nourrissons séparés de leur mère. Pionnier dans l’utilisation de documents filmés, bien avant l’essor de la vidéo dans les années 60, Spitz a travaillé à partir de l’observation directe, à l’aide de films projetés au ralenti. J’ai en tête une séquence où l’on voit un bébé installé dans une chaise haute et qui détourne la tête devant la cuillère qu’un adulte porte à sa bouche. Ce geste de refus, je l’avais perçu comme la seule manifestation disponible pour que ce bébé exprime à ce moment-là son intention, et par identification primaire instantanée j’avais ressenti une bouffée de liberté !
Ce lien entre intentionnalité et expression du refus dans l’organisation psychoaffective de l’enfant me rappelle une autre phrase qui, par sa condensation, sonne de manière provocante : « l’objet naît dans la haine ». Attribuée à Freud, cette phrase ne semble pas figurer littéralement dans ses écrits, mais elle a le mérite de rassembler en quelques mots certaines de ses idées sur les relations entre haine, amour et constitution de l’objet dans le psychisme de l’enfant. Dans son ouvrage Pulsions et destins des pulsions (1915), Freud explique que la haine précède l’amour dans le développement psychique : l’objet est d’abord perçu comme un obstacle ou une source de déplaisir avant d’être investi positivement. La haine serait donc première dans la constitution de l’objet, parce qu’elle permet la différenciation et la reconnaissance de l’autre comme distinct de soi. Dans son texte « La haine dans le contre-transfert » (1947), Winnicott reprend cette idée freudienne et la prolonge d’une manière particulièrement intéressante pour les soignants qui s’occupent des enfants : la mère, en supportant la haine du nourrisson sans disparaître ni se venger, permet au bébé de la reconnaître comme une personne distincte et fiable. Ainsi, l’objet ne naît pas simplement dans la haine, mais dans la capacité de l’objet (la mère) à survivre à cette haine et à la transformer pour que se construise un lien authentique.
A la suite de Winnicott, dont il reprend l’idée que le développement du self repose sur les interactions précoces avec l’environnement, se présente un autre chercheur très attentif au bébé. Daniel Stern est un psychiatre américain qui adopte une approche empirique fondée sur l’observation en temps réel des interactions précoces entre le nourrisson et ses parents. Il a écrit le Journal d’un bébé pour essayer de répondre aux questions que l’on se pose sur la vie intérieure d’un petit enfant en essayant d’imaginer et de reconstruire son point de vue. Il place les intentions et leurs interprétations au cœur du développement psychologique tout au long de la vie : « Nous en sommes arrivés à considérer l’intention comme la principale caractéristique de l’activité humaine que nous cherchons à identifier. Pour comprendre ce que font les gens, nous analysons leur comportement en termes d’intentions, telles que nous les déduisons. Les bébés en font autant. Comme les parents avec leurs bébés »[3]. Interpréter les intentions et la vie psychique d’un bébé est un travail très délicat, car l’adulte s’appuie sur ses propres ressentis réactivés par l’identification au bébé, ce qui peut susciter la confusion entre soi et l’autre : « La réponse de l’adulte dépend en grande partie de la façon dont lui-même était traité dans son enfance, c’est-à-dire de la manière dont ses propres parents interprétaient ses sentiments et son comportement ».
Stern raconte que le bébé progresse dans son développement à travers 5 mondes successifs : le monde des sensations, le monde social, celui des paysages psychiques, celui des mots, puis celui des histoires.
Dans le monde social, à partir de 4 mois, le bébé manifeste des prémisses de ses intentions. Une vidéo présentée par Stern à un congrès de la Waimh montrait un bébé qui détourne le regard pour se désengager d’une interaction trop intense à soutenir pour lui. En regardant ailleurs, le bébé indique qu’il a besoin de faire des pauses au cours d’une interaction qui lui est proposée mais aussi imposée par un adulte qui a la liberté de mouvement tandis que le bébé n’a pas la capacité motrice de s’enfuir ! Pour Stern, détourner le regard est le signal d’un besoin de régulation : le bébé ne cherche pas à rejeter l’interaction, mais à gérer la « surcharge émotionnelle ». Dès ces premiers temps de vie et d’interaction, le bébé doit faire face à des erreurs d’interprétation…
C’est dans le monde suivant, celui des paysages psychiques, au bout de la première année de vie, qu’émergent les intentions du bébé. Le bébé découvre qu’il a ses propres paysages qui ne sont pas visibles aux autres à moins qu’il n’essaie de les leur révéler. Puis il comprend qu’il est possible de partager un paysage personnel avec quelqu’un d’autre. Ce moment de découverte de l’intersubjectivité permet à l’enfant de saisir que lui et ses parents ont des paysages psychiques différents. Et c’est là que les difficultés peuvent surgir dans le développement du bébé, car la « concordance possible entre les paysages psychiques de différentes personnes implique un risque égal d’erreurs d’interprétation, voire d’échec à établir toute concordance ».
Lire ou écouter les chercheurs qui ont beaucoup observé les bébés est fascinant… on est loin de la cire molle que décrit Descartes. Celui-ci n’était pas marié mais avait eu une fille, prénommée Francine, avec une servante hollandaise, un bébé qu’il n’avait pas dû prendre le temps de regarder. S’il l’avait soigneusement observée, cette petite fille l’aurait peut-être détourné de ses recherches visant à démontrer la primauté de la raison sur les émotions…
Observer un bébé est tellement précieux que cela devrait être obligatoire ! Pour devenir parent ou soignant ! C’est la seule expérience qui permet de faire surgir à l’intérieur de soi les traces mnésiques de son moi bébé, celui d’avant le langage et la narration, celui qui ne peut se raconter lui-même mais qui pourtant vit et éprouve les premiers événements qui nous constituent.
[1] Erika Parlato-Oliveira, « Bébés provocans : l’intentionnalité dès le début », in Spirale 108
[2] René Spitz, Le Non et le Oui, Puf
[3] Daniel Stern, Journal d’un bébé, 2004, Odile Jacob
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de mars 2025