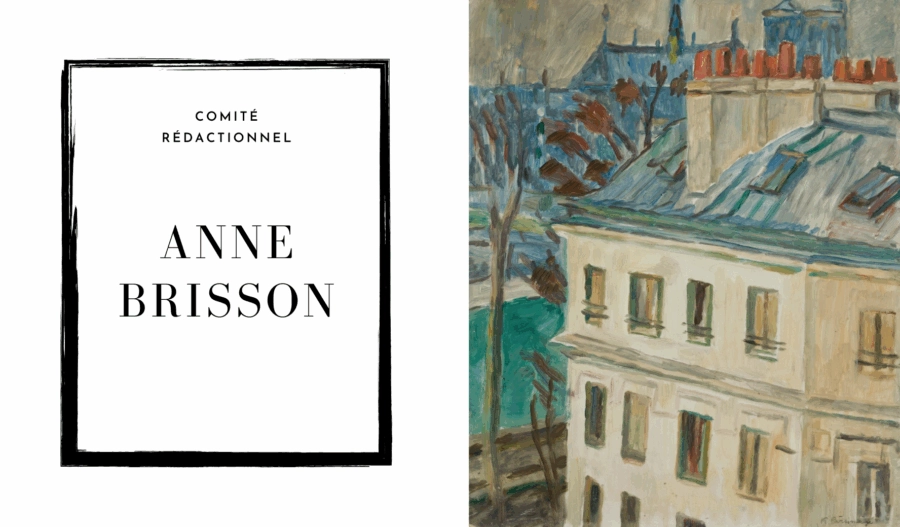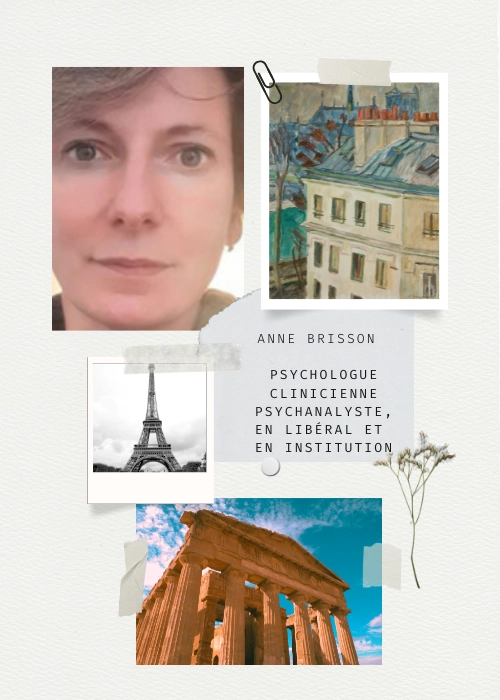Alors que je travaillais dans un service de pédopsychiatrie qui traversait des turbulences internes graves, j’étais tombée sur une phrase écrite par deux psychiatres et chercheurs américains.
Sameroff et Emde avaient réuni plusieurs collègues pour construire ensemble un corpus théorique sur les relations précoces. Rassembler des chercheurs d’horizons différents implique, pour chacun, une volonté de s’écouter puis de s’accorder pour constituer une œuvre collective.
Il faut éviter deux écueils : le consensus qui noie les différents points de vue et la juxtaposition d’idées qui rend l’ensemble hétérogène. Sameroff et Emde décrivent la façon dont ils ont navigué : « Notre stratégie de consensus nous a procuré certains avantages, mais elle comportait aussi des inconvénients parmi lesquels l’influence potentielle et excessive de la pression sociale en faveur d’un accord.
Pour contrer cette tendance, nous avons été très attentifs à ne pas passer sous silence nos divergences d’opinion » (Les troubles des relations précoces, Paris, PUF, 1993).
Cette façon de procéder me paraît essentielle quand on travaille à plusieurs et que l’on souhaite se donner un socle théorique et technique partagé. Il ne faut pas avoir peur du débat, il ne faut pas éviter d’exposer des idées opposées ou contrastées. Ce qui se construit entre deux rives, par sa nouveauté, par l’effort de créativité que cela représente, a tout son intérêt.
Dans le dictionnaire, le mot débat renvoie aussi bien au conflit intérieur qu’aux querelles interpersonnelles. Depuis les découvertes de Freud, le conflit intérieur a pris un autre visage qu’un simple tiraillement entre différentes idées. Avec la notion d’inconscient un nouveau personnage s’est invité sur la scène psychique, et cela conduit à un remaniement des rôles. Il y a maintenant le Moi, le lutin diabolique et le petit gendarme.
A ce propos, Lacan considère la découverte freudienne comme une révolution : l’inconscient refoulé et qui fait retour déloge le Moi qui n’est plus le maître dans sa maison : « le sujet inconscient est excentrique au moi ».
Cette idée est reprise dans les travaux de Stephen Jay Gould, paléontologue, biologiste de l’évolution et écrivain américain, un des scientifiques les plus influents et populaires du 20e siècle grâce à sa capacité à vulgariser la science avec clarté, humour et profondeur.
Il estime que trois grandes figures ont profondément transformé notre compréhension de l’homme et de sa place dans l’univers. Pour commencer, la révolution de Copernic a remis en question la vision géocentrique de l’univers, puisqu’il a démontré que la terre tournait autour du soleil et non l’inverse.
Ensuite la révolution de Darwin a transformé nos représentions de l’évolution et de l’origine des espèces : l’homme n’est plus un être à part, créé à l’image de Dieu, il partage un ancêtre commun avec d’autres espèces, notamment les singes.
La révolution freudienne, pour finir, bouleverse les conceptions de la psychologie humaine et menace les illusions confortables de la société de l’époque avec des vérités qui dérangent comme les pulsions et les désirs sexuels refoulés.
Voyons ce que les émergences de l’inconscient impliquent quand on travaille ensemble.
Dans une institution de soins psychiques, on trouve plusieurs enveloppes : il y a l’équipe des soignants, le groupe des enfants, les interactions entre ces deux ensembles.
Dans l’hôpital de jour pour enfants où je travaille, l’action thérapeutique est diffuse, elle se déploie à tout moment, à l’intérieur des ateliers à médiation, mais aussi dans la cour, pendant les repas, sur le chemin vers les activités extérieures, pendant les temps de transition et tous les autres cadres informels.
Les relations transférentielles et contre-transférentielles sont comme des flux qui circulent plus ou moins rapidement, qui se croisent, qui bifurquent de manière imprévisible, qui entrent parfois en collision.
Je vous en propose une illustration clinique.
Un goûter d’anniversaire est organisé pour un enfant qui fête ses 8 ans. C’est un jeune garçon habituellement discret, timide, inhibé, mais qui accepte volontiers qu’on le mette à cette occasion en valeur. Et c’est déjà une petite victoire thérapeutique !
Dans le groupe des enfants ce jour-là, il y en a un plus jeune, âgé de 5 ans, qui a l’habitude d’attirer l’attention, de capter le regard des adultes, qui sait déployer son charme et user de son langage pour obtenir des soignants un maximum de bienveillance.
Ce jeune garçon ne supporte pas que la lumière soit portée sur le plus âgé. Il s’agite, pleure, réclame une part de gâteau avant les autres, refuse la part qu’on lui offre parce que le gâteau n’est pas au chocolat, devient tyrannique et dévoile ainsi de manière projective l’état de détresse dans lequel il se trouve. Sa capacité à exister dépend de ce que lui renvoie le regard des adultes.
Deux soignantes vont être particulièrement touchées par la scène qui se déroule autour du gâteau d’anniversaire.
L’une s’identifie à l’enfant aîné qui bénéficie de manière exceptionnelle de l’attention de tout le groupe, enfants et soignants réunis.
L’autre s’identifie au plus jeune qui s’agite pour éviter l’effondrement dépressif ponctuel puisqu’il n’est plus tenu par le regard contenant des adultes. Prises dans leurs identifications, les deux soignantes s’opposent et une situation conflictuelle s’installe.
La soignante qui protège l’aîné et celle qui cherche à réconforter le cadet ne parviennent plus à prendre du recul, leurs interventions vont l’une à l’encontre de l’autre et engendrent contrariété et ressentiment.
L’enfant le plus jeune est écarté pour qu’il se calme tandis que le goûter d’anniversaire se poursuit… Les deux soignantes se chargent de colère et de tristesse. Cette scène pleine d’émotions pénibles et douloureuses est reprise un peu plus tard, lors du temps clinique, et très vite l’équipe comprend la résonance entre la concurrence des deux enfants et les traces de rivalité fraternelle que cela a réveillé chez les soignantes.
Chacun travaille avec tout ce qui le constitue : le bébé qu’il a été, sa place dans la fratrie, les valeurs qu’il a reçues et qu’il veut transmettre, celles dont il a cherché à se débarrasser, les blessures qui sont restées ouvertes, le lutin qui cherche à satisfaire ses pulsions, le petit gendarme qui lui montre les limites à ne pas transgresser, ce qui le valorise, ce qui l’humilie, ce qui le remet en question, ce qui bouscule ses habitudes, ses routines, ses repères… Cela fait beaucoup de monde !
Pour comprendre les ressorts d’une telle situation clinique, reprenons la notion de transfert (et contre-transfert), telle qu’elle est définie dans le Vocabulaire de la psychanalyse[1] de Laplanche et Pontalis : « le processus par lequel les désirs inconscients s’actualisent sur certains objets dans le cadre d’un certain type de relation établi avec eux et éminemment dans le cadre de la relation analytique.
Il s’agit là d’une répétition de prototypes infantiles vécue avec un sentiment d’actualité marqué ». C’est d’ailleurs pour cela que le transfert, qui surgit dans les interactions entre soignants et patients, a souvent un caractère surprenant, gênant et incongru.
Le transfert ne se manifeste pas uniquement dans la cure analytique. Il intervient dans les groupes, dans les relations entre collègues, dans les situations d’apprentissage, dans les consultations de médecine somatique, dans la relation maître-élève, etc.
Il s’agit de la rencontre et du dialogue entre deux inconscients, comme la mise en circuit de deux générateurs : « Quelqu’un en moi entre en communication avec quelqu’un en l’autre, à propos de quelque chose qui ne pouvait pas se faire entendre jusque-là »[2]. Transfert et contre-transfert vont forcément de pair, la relation thérapeutique induit des résonances passées inconscientes chez les deux partenaires. Prêter attention au transfert, c’est écouter un discours à deux voix.
Pour que les mouvements transférentiels et contre-transférentiels qui se croisent dans une institution ne deviennent pas des entraves aux processus thérapeutiques, il est nécessaire de reprendre les situations cliniques à distance, pour mettre en commun les récits et les réflexions qu’elles ont déclenchées.
Il faut du temps, de la liberté de parole et le désir de penser ensemble. Comme l’écrit Michel Neyraut, « le transfert est un quiproquo à contre-temps. Son dépassement consiste à le renvoyer à qui de droit et à sa place »[3].
Transfert, identification, projection sont des mécanismes puissants : passés sous silence ils rongent les enveloppes institutionnelles, mis en lumière ils enrichissent les élaborations et la créativité de toute une équipe, élaborés ils soutiennent l’action thérapeutique auprès des patients.
[1] Laplanche et Pontalis, Le vocabulaire de la psychanalyse.
[2] Gérard Bonnet, Le transfert dans la clinique psychanalytique, Puf.
[3] Michel Neyraut, Le transfert : Etude psychanalytique, Puf.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO d’avril 2025