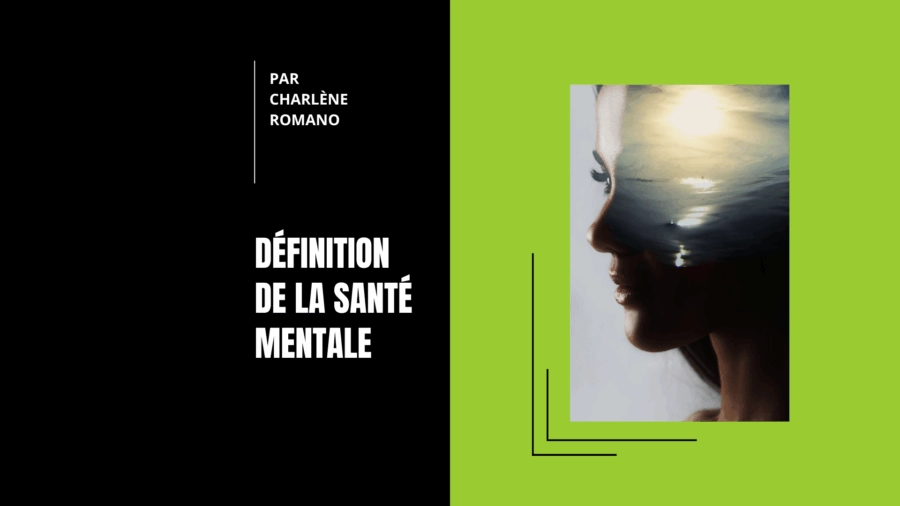La santé mentale, un enjeu de société
Première pensée : la folie. Seconde pensée : montagneux
Survolant les Alpes à l’instant même où j’écris, ma plume est biaisée par ce contexte. Néanmoins, cette pensée reste intéressante par sa dimension métaphorique. À la fois puissante et imposante mais aussi fragile et tangible, la montagne se singularise par sa contorsion physique qui dessine l’horizon. Après une analyse poétique et énigmatique, faisons un flashback vers une définition plus théorique.
Montagne : nom féminin. L’écorce terrestre se plisse lorsqu’une plaque océanique, constituée de matière dense, entre en collision avec une plaque continentale constituée de matière moins dense.
Une signification pouvant s’appliquer sur l’état psychique d’un individu. Deux états, ou pôles, mentaux qui s’entrechoquent et créent une collision irrémédiable. Une singularité.
Mais une réflexion hypothétique, telle que celle-ci, ne me permet pas de répondre précisément à ma question. Face à cette impuissance, je pose une réflexion sur cette incapacité à laquelle je fais face. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à définir ce terme ?
Nous sommes en capacité de détailler une période historique, d’expliquer un courant philosophique, ou encore de résoudre une équation mathématicienne. Mais ce qui peut nous sembler évident ne l’est plus tout autant lorsqu’il s’agit d’expliquer ce qu’est la santé mentale. Nous ne trouvons pas plus d’aide auprès d’Internet qui n’attribue pas de définition précise à cette notion. Désigné comme un « terme relativement récent et polysémique », nous lui aurions attribué un nom et une valeur depuis peu.
Apparaissant comme contemporain à notre société, on peut s’interroger sur le positionnement du grand public à son égard.
Vérifiez alors par vous-même et demandez à votre entourage : « Comment définissez-vous la psychiatrie ? Et la santé mentale ? ».
En général, les individus, externes à ce secteur, dressent un portrait cliché et réducteur de la psychiatrie. Gaëlle, infirmière médiante à l’hôpital psychiatrique de Melun, dénonce quant à elle cet « aspect négatif du domaine qui est toujours montré. L’image de la psychiatrie est très faussée par les médias, par ce que les gens en disent et en pensent.
Les films véhiculent cette image, allant d’Hannibal Lecter à Jeffrey Dahmer. ». En effet, la première réponse est majoritairement : la folie. Puis s’ensuit une liste de stéréotypes médiatisés sur l’écran ou sur le papier : la chambre d’isolement, les couloirs blancs et froids, la camisole, la « maison de fous ».
À dire vrai, la « maison de fous » est une réponse qui se légitime. Jusqu’au XIXe siècle, les infrastructures accueillant les malades étaient des « asiles de fous ». Exclus de la ville, ils étaient marginalisés et cachés de la société. Cette exclusion a créé des changements irréversibles selon certains du personnels soignants : « Toutes ces personnes-là sont mises de côté par la société et cela justifie la mise à l’écart de l’hôpital psychiatrique, on est comme le petit pauvre de la médecine. ».
Cette vision est importante pour comprendre l’évolution de notre relation avec la psychiatrie et les personnels soignants. Nous avons un héritage idéologique qui nous est transmis et qui influe quotidiennement sur la perception de notre monde. Comme le démontre Pierre Bourdieu : « C’est faute d’apercevoir l’action des mécanismes profonds, tels que ceux qui fondent l’accord des structures cognitives et des structures sociales et, par là, l’expérience toxique du monde social ».
De fait, la « logique reproductrice du système » influe conséquemment sur la représentation de la psychiatrie, une « représentation plus ou moins consciente et intentionnelle ». Cette distanciation, avec le milieu psychiatrique, se fait dès l’organisation structurelle de l’hôpital.
Pour atteindre le pôle psychiatrique, cela ne se fait pas par l’entrée principale mais par une ouverture située à l’arrière du bâtiment central. Positionnés à un niveau inférieur, les blocs psychiatriques semblent cachés du grand public, comme exclus du domaine de la santé. En fait-il partie ou uniquement de manière partielle ?
Néanmoins, dès mon entrée, je fais une rencontre qui brise tous ces préjugés. Un jeune homme, autiste, vient vers moi. Considéré comme l’enfant de l’hôpital, David me salue de façon singulière. En se rapprochant de mon corps, il attrape délicatement mon lobe de l’oreille dans le but d’approcher mon visage du sien.
Surprise par ce contact, je me raidis en appréhendant une réaction violente de sa part. Gaëlle, à mes côtés, me rassure et me conseille de me laisser faire. Front contre front, son regard plonge et perce le mien. Ces quelques secondes sont une forme d’entendement entre nous, la confiance et le respect mutuel. Cet instant unique où, pour la première fois, je me sens si connectée à un individu.
C’est intéressant comme la maladie peut, parfois, renvoyer un individu à sa simplicité. En sortant du bloc, je jette un dernier regard et je perçois David derrière la vitre. Quelle beauté. Ce regard.
Finalement, gardons-nous de tous préjugés et soyons à l’écoute de chacun pour parvenir à comprendre l’individu et sa maladie. Apprenons à ne plus avoir cette peur de l’extérieur, cette appréhension, ancrée par notre héritage éducatif, qui nous ronge face aux personnes sans abris, aux handicapés, aux alcooliques.
Ces êtres, ou dangers, sont stigmatisés par nos agissements. Derrière nos différences se cache une quête à la fois singulière et commune, celle que chacun de nous mène en vue de donner sens à sa propre existence. J’achève cette réflexion sur les mots d’Hervé Mazurel : « Le corps est dans le monde social mais le monde social est aussi dans les corps. »[1].
[1] Arte, « Comment l’histoire façonne-t-elle notre inconscient ? »