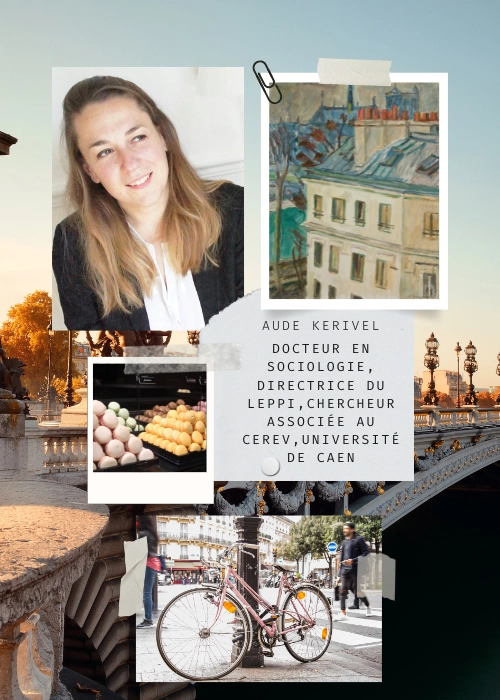Performance, autonomie, efficacité, expertise, « individu acteur de sa vie » : ces mots ont progressivement pris une place prépondérante dans les médias, dans le monde de l’entreprise, mais aussi à l’école, dans les institutions de la petite enfance, de la protection de l’enfance, dans le service public.
Ce champ lexical n’est pourtant pas neutre, il appartient au registre de l’idéologie individualiste et néolibérale.
Dans les années 1990, Alain Ehrenberg, à l’instar de nombreux sociologues et philosophes, pose un regard critique sur l’idéologie individualiste, la généralisation de la norme d’autonomie, de compétition entre les individus et « le culte de la performance ».
Dans l’introduction de son essai : Le Culte de la performance, paru en 1991, Alain Ehrenberg décrit la modification de la société française où « les mouvements sociaux semblent avoir fait la place aux gagneurs, le confort à la suractivité et les passions politiques aux charmes rudes de la concurrence ». « Épanouissement personnel et initiative individuelle sont les deux facettes de cette nouvelle règle du jeu social ».
La performance est liée à la compétition, et le fait qu’idéalement « tous peuvent a priori entrer en compétition avec tous »[1] en faisant donc fi de l’inégalité des conditions, de santé, et l’inégale répartition des capitaux économiques culturelles et sociaux et symboliques. La réussite est également celle d’un individu plutôt que celle d’une équipe ou d’un collectif.
Dans ses ouvrages successifs : Le culte de la performance (1991), L’individu incertain (1995) et La fatigue d’être soi (1998) Alain Ehrenberg s’intéresse à ce que cette idéologie fait à l’individu, soit le prix de l’autonomie : « une exigence accrue de responsabilité ».
En d’autres termes, si la réussite est le fait d’un individu « plus performant que les autres », l’échec est également imputable à l’individu lui-même.
Dans ce nouveau contexte idéologique, décrit par Ehrenberg dans les années 1990, les figures du sportif et de l’entrepreneur sont l’illustration parfaite de cette réussite individuelle.
C’est d’ailleurs le dépassement de soi, la réussite liée au mérite, qui est mis en lumière dans les récits, laissant dans l’ombre l’effet des collectifs, de l’histoire familiale, des groupes sociaux et des transmissions de capitaux.
Même les mots pour décrire les mouvements ne sont plus les mêmes, la lutte des places viendrait remplacer la lutte des classes, effaçant ainsi la notion de classe sociale, de groupe social, de syndicat et de collectif.
Bien sûr, cette idéologie nie l’ensemble des travaux qui prouvent que les inégalités existent et se reproduisent, voir même qu’elles se creusent depuis Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron[1], jusqu’à Camille Peugny[2], en passant par Bernard Lahire[3] ou Thomas Piketty[4] et qu’elles permettent d’expliquer le déterminisme social et ses conséquences.
Pourtant presque 20 ans après les travaux d’Ehrenberg, Edgar Cabanas et Eval Ilouz dans leur ouvrage Happycratie, comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, montrent que cette pensée a non seulement pris de l’ampleur, mais est devenue une norme.
Ainsi selon les auteurs : « le travail est devenu une affaire de projets personnels, de créativité et d’entreprenariat ; l’éducation une affaire de compétence individuelles et de talents personnels ; la santé une affaire d’habitudes de vie et de modes de vies (…) les conséquences en ont été l’effondrement de la dimension sociale au profit de la dimension psychologique.[5]
Ainsi, on semble oublier qu’en 2023, 64,2 % des élèves des catégories favorisées entreprennent, sept ans après leur entrée en 6e, des études supérieures. Alors que ce n’est le cas que de 27,5 % des enfants de catégories modestes.[6]
On semble également oublier que « Les hommes diplômés du supérieur vivent 8 ans de plus que les hommes non diplômés du supérieur », et que « Pour les hommes, il existe une gradation : plus le diplôme est élevé, plus l’espérance de vie l’est » [7].
Alors que « Pour les femmes, l’écart d’espérance de vie est net entre celles qui ont un diplôme et celles qui n’en ont pas, mais la gradation est peu marquée parmi les diplômées. »[8] Ces chiffres viennent rappeler la nécessité de ne pas oublier ces structures sociales déterminantes que la norme néolibérale tente de gommer.
Autour de cette norme, un nouveau récit : celui de l’accès de chacun au bonheur, qui serait la marche la plus haute de l’accomplissement personnel, accessible à chacun pour peu qu’il ou elle déploie la stratégie adéquate, fondée sur le développement des émotions positives et le travail sur soi [9].
La recherche du bonheur individuel comme idéal à atteindre, supplante des ambitions telles que la réussite du collectif, la justice, la liberté. Une rhétorique difficilement critiquable puisqu’elle est devenu la norme. Une norme qui oublie les rapports de domination, de race, de classe, de genre, les inégalités et les contextes sociaux.
Bibliographie
[1] Alain Ehrenberg, 1991, le culte de la performance, 1991, Edition Pluriel.
[2] Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers, Les étudiants et la culture, Paris, les Éditions de minuit, coll. Le Sens commun, 1964 et Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La Reproduction, Éléments d’une théorie du système d’enseignement, collection Le sens commun, 1970
[3] Camille Peugny, Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, Seuil, coll. « La république des idées », 2013.
[4] Bernard Lahire (2019). Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants. Seuil.
[5] Thomas Piketty, (2019) Capital et idéologie, Edition du seuil.
[6] Cabanas Edgar, Illiouz Eva, Happycratie, comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Premier Parallèle, p. 77.
7] France Stratégie, Scolarités, le poids des héritages, Johanna Barasz, Peggy Furic et Bénédicte Galtier, Septembre 2023.
[8] INSEE, Les écarts d’espérance de vie entre cadre et ouvrier, Insee Première n°2005, juillet 2024.
[9] INSEE, Les écarts d’espérance de vie entre cadre et ouvrier, Insee Première n°2005, juillet 2024.
[10] Edgar Cabanas, Eva Illiouz, Happycratie, comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Premier Parallèle, p. 77.
♣ Un article de Aude Kerivel et Chloé Michaud économiste au LEPPI
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de novembre 2024