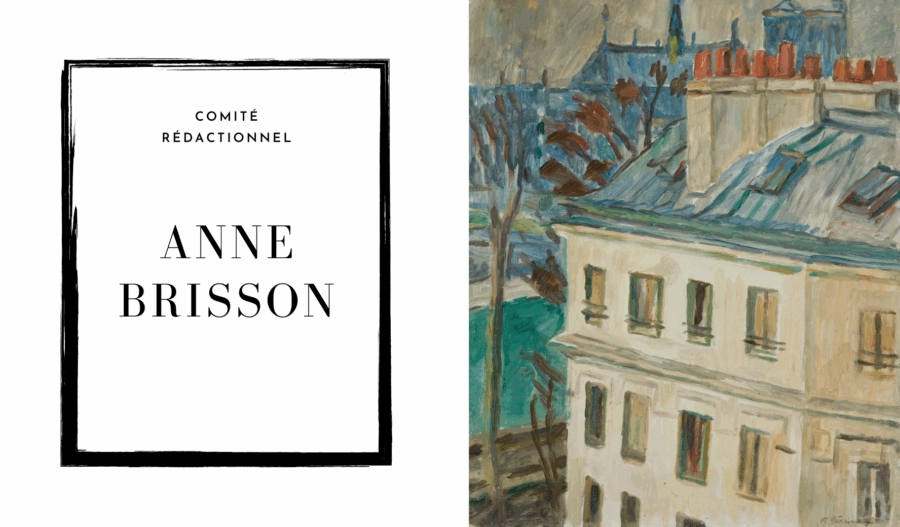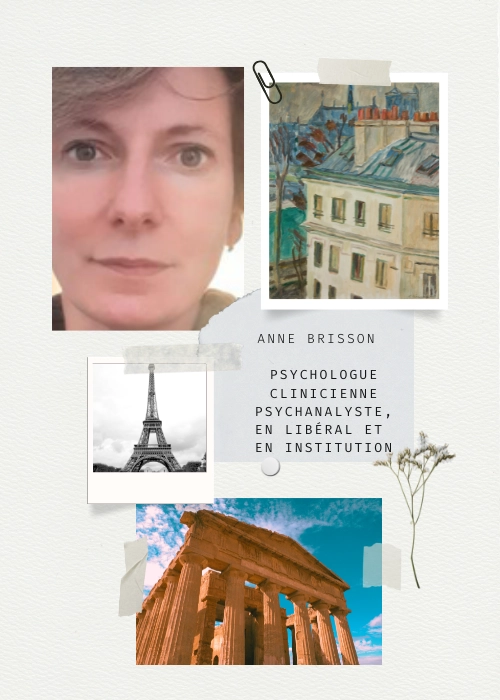Ainsi les services de psychiatrie, comme l’hôpital de jour pour enfants dans lequel je travaille, ont été fermés, avec une seule alternative pour assurer la continuité des prises en charge, la mise en place de consultation par téléphone ou par zoom : un aménagement impossible à anticiper puisque cette pratique était totalement inconnue à cette époque dans notre secteur.
On sait aujourd’hui à quel point cette rupture dans la continuité des soins en présentiel a été dommageable pour tous les patients et usagers aux prises avec leur souffrance psychique et contraints à un confinement qui a lourdement fragilisé leurs liens avec le monde.
Dans l’après-coup du premier, les confinements suivants, à géométrie variable, ont fait apparaître que certaines activités considérées comme non essentielles étaient finalement nécessaires à la santé mentale : ainsi les coiffeurs et les libraires ont pu défendre les effets thérapeutiques de leurs activités, et les services de soins psychiques sont restés ouverts.
Les soignants dans leur ensemble ont été considérés comme des héros, alors même que l’héroïsme, la force ou le pouvoir n’est pas le moteur principal de leur trajectoire.
J’ai souvent pensé que si la France connaissait une grave crise économique, mon métier de psychologue-psychanalyste disparaîtrait car offrir ou s’offrir du soin psychique n’est possible que lorsque les conditions nécessaires à la survie sont remplies voire dépassées.
Un travail psychothérapeutique est un produit de luxe, un cadeau que l’on peut se faire quand toutes les préoccupations matérielles de la vie quotidienne sont maîtrisées. Je me souviens d’une collègue pédopsychiatre qui disait aux parents réticents à accepter une psychothérapie pour leur enfant que c’était pourtant un « cadeau précieux » qu’ils pouvaient lui faire.
Ni super-héros, ni produit de luxe…
Les métiers de soignant ont des vocations diverses et qui prennent parfois des chemins détournés, mais tous véhiculent une certaine énergie qui part du soignant, l’anime, le traverse et lui revient…
Pour exemple, une histoire où l’on fait sortir la vocation par la porte et elle revient par la fenêtre : une amie ingénieure du son, musicienne et concertiste, spécialiste de la viole de gambe, me raconte : sa mère, qui n’avait pas eu l’occasion d’aller au-delà du certificat d’études, est devenue infirmière.
Elle a consacré une grande partie de sa vie à soigner de nombreux patients dans différents services hospitaliers, avant de devenir cadre et formatrice. Cette femme élève ses deux filles en espérant pour elles un autre métier que le sien, moins pénible, plus créatif, mieux rémunéré sans doute.
Mon amie obtient son bac scientifique, s’inscrit en classes préparatoires, fait une école d’ingénieur. Comme elle trouve ses années de formation « ennuyeuses » sur le plan du contenu, elle reprend sa pratique de la musique, suspendue car il n’était pas possible de faire entrer son violoncelle dans sa chambre de l’internat.
Elle choisit la viole de gambe, puis devient ingénieur du son et concertiste. Alors qu’elle a dépassé l’âge de 40 ans, cette amie commence à se rendre compte que l’attitude de son public devient de plus en plus « snob », que les gens sont présents parce que cela leur donne l’occasion d’en parler, qu’il n’est plus vraiment question de partager le plaisir de la musique.
A ce point de la discussion, mon amie s’agite et commence à parler avec ses mains, je sens qu’elle cherche à faire passer un message qui la surprend elle-même : à quoi bon faire des concerts devant un public vieillissant, rétréci comme une peau de chagrin et qui surjoue les mondanités, être infirmière est certainement beaucoup plus utile !
Et voilà comment cette fille d’infirmière, détournée par sa mère de ce métier, formule le désir d’y revenir…
Revenons à la peau de chagrin, cette expression qui m’est venue et qui réactualise une lecture de jeunesse. Le roman de Balzac a pour thème central le conflit entre désir (tout brûler dans l’instant) et longévité (donner du sens à sa vie jusqu’à son terme) et pour personnage principal un jeune aristocrate ruiné par sa passion du jeu, qui court après les femmes et le luxe : un autre style de vie et de vocation !
La peau de chagrin magique représente le réservoir de force vitale de son propriétaire, elle se rétracte et le réservoir se vide à chaque satisfaction de son désir, d’autant plus s’il vise à l’accroissement de sa puissance. Le jeune héros ne tient pas compte de la mise en garde de l’antiquaire qui lui offre cette peau, il formule le souhait de recevoir de l’argent et de passer des soirées orgiaques, et ses vœux sont exaucés.
A mesure qu’il s’enrichit et qu’il accumule les plaisirs, la peau de chagrin rétrécit et sa santé se détériore. Il consulte de nombreux médecins qui ne peuvent rien pour lui. Il comprend que sa vie n’a aucun sens et que sa fin est proche. Envahi par la crainte de mourir, il se réfugie dans le sommeil à l’aide d’opiacés dans l’espoir de ne plus ressentir de désirs.
Il végète, ne se réveille qu’une fois par jour pour manger, tient la femme qu’il aime à distance. Cette dernière insiste et lui rend visite. A sa vue, le jeune homme la désire avec une telle intensité qu’il en meurt, il est alors âgé de 27 ans… Il aura compris trop tard la leçon que Balzac condense en quelques mots : « Vouloir nous brûle et Pouvoir nous détruit mais Savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. […]
La pensée est la clef de tous les trésors, elle procure les joies de l’avare sans donner ses soucis »[i].
Le soignant est un personnage qui prend appui sur sa pensée et qui s’enrichit de l’accumulation de ses expériences. Elles finissent par constituer un socle solide lui permettant de comprendre mieux et plus vite les patients.
Sa puissance (thérapeutique) s’appuie sur un réservoir qui se remplit de connaissances cliniques et théoriques grâce à des atouts simples et précieux : le temps et le plaisir à penser (et un salaire honorable avec lequel on peut vivre, et non pas seulement survivre, même si le luxe reste difficile à atteindre sur ce chemin professionnel).
Par conséquent, le culte de la performance[ii] n’a pas beaucoup de sens pour un soignant, en tout cas tel qu’il est défini par Alain Ehrenberg, incarné par « un individu-trajectoire à la conquête de son identité personnelle et de sa réussite sociale, sommé de se dépasser dans une aventure entrepreneuriale ».
Une conquête qui s’accompagne de souffrances psychiques, car l’autonomie exacerbée a un prix : « Enjoint de décider et d’agir en permanence dans sa vie privée comme professionnelle, l’individu conquérant est en même temps un fardeau pour lui-même. Tendu entre conquête et souffrance, l’individualisme présente ainsi un double visage ».
Alain Ehrenberg explique comment le culte de la performance se développe dans les années 80, à partir de trois déplacements. Pour commencer, les champions sportifs deviennent des symboles d’excellence sociale alors qu’ils étaient auparavant « signe de l’arriération populaire ».
Puis la consommation représente une forme de réalisation personnelle alors qu’elle était assimilée le plus souvent à de l’aliénation et de la passivité. Enfin, le chef d’entreprise est considéré comme un modèle de conduite, alors qu’il était avant tout l’incarnation de la domination du patron sur l’ouvrier.
Pour Ehrenberg, « ce culte inaugurait ainsi de nouvelles mythologies permettant à chacun de s’adapter à une transformation majeure : le déclin de la discipline au profit de l’autonomie. Epanouissement personnel et initiative individuelle sont les deux facettes de cette nouvelle règle du jeu social ».
Après Le culte de la performance, Ehrenberg écrit La Fatigue d’être soi[iii]. Le titre pourrait se suffire à lui-même. Il s’agit d’une remise en perspective historique de la dépression. Un nouveau déplacement s’opère, de la culpabilité à la responsabilité.
La dépression n’est plus la conséquence de désirs interdits, mais se propage sous « le poids du possible », la confrontation entre « tout est possible » mais « rien n’est maîtrisable ». Elle est la contrepartie de l’énergie que chacun doit mobiliser pour devenir soi-même. La fatigue dépressive a remplacé l’angoisse névrotique.
Avec un objectif tel que le culte de la performance individuelle, la dépression est assurée et c’est sans doute cette menace que le soignant contourne, lui dont la réussite n’est pas de se dépasser seul contre les autres, mais d’avancer en maturité et en autonomie dans le champ broussailleux de la clinique, avec les patients et les collègues.
Bibliographie
[i] Honoré de Balzac, La peau de chagrin, 1831
[ii] Alain Ehrenberg, Le culte de la performance, 1991
[iii] Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi, 1998
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de novembre 2024