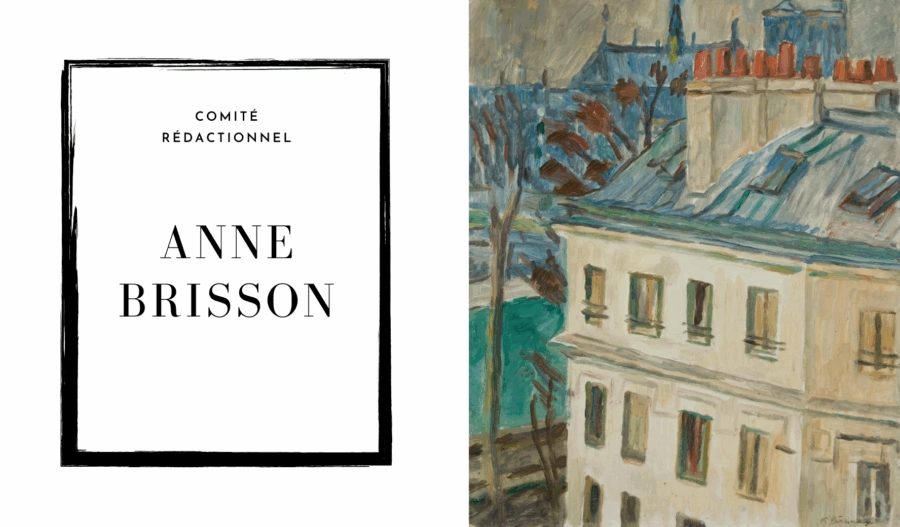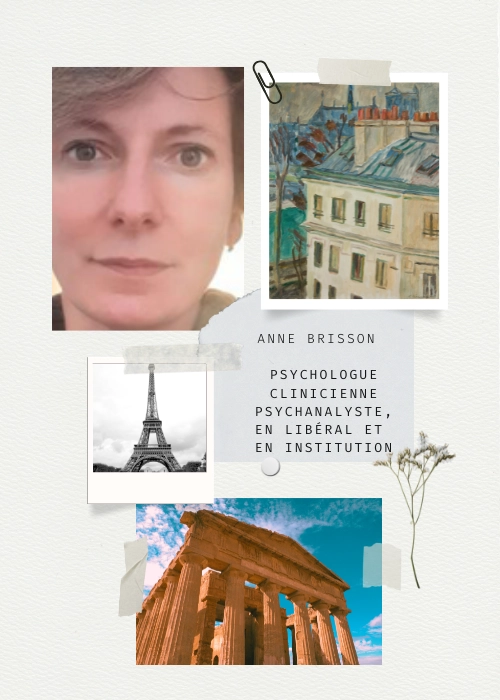Ainsi votre téléphone vous « impose » le souvenir !!! Et cette obligation à se souvenir est proportionnelle au nombre de photos que vous accumulez jour après jour, de sorte que vous êtes quand même à l’origine de l’intensité du flux.
Je soupçonne l’humain responsable de ce lien de remémoration quotidien et obligatoire entre le Cloud et votre smartphone d’être un immense admirateur de Marcel Proust… ou alors un nostalgique volontaire comme le décrit Amélie Nothomb. Dans son livre L’impossible retour[1], elle distingue la nostalgie préventive de la nostalgie rétrospective : « Il me prend un vertige à l’idée d’avoir vécu si longtemps.
Ces dates sont si lointaines. En 1972 déjà, donnant la main à mon père, j’avais visité le temple des cloches. C’était lui, le modèle initial du voyage. Pire : je m’en souvenais. Plus grave encore : en 1972 déjà, j’étais en proie à la nostalgie, non pas d’une venue précédente, mais du présent d’alors. J’avais cinq ans et je savais que j’allais quitter le Japon et j’en avais d’avance le cœur déchiré. Et mon père également.
Nous avions lui et moi inventé la nostalgie préventive : idée romantiquement funeste, vaccin inspirant, se contentant d’agrandir dans l’âme la région dévolue à la nostalgie rétrospective ».
Que le souvenir soit bon ou mauvais, associé à une tonalité positive ou négative, il provoque souvent un ressenti de nostalgie, parce qu’il souligne l’écart dans le temps comme dans l’espace entre l’événement et sa remémoration. La nostalgie est le regret mélancolique d’une chose, d’un état, d’une existence que l’on a connus et le désir d’un retour dans le passé.
Je ne résiste pas au plaisir de citer Proust et son fameux passage sur la madeleine qu’il mange à l’âge adulte et qui le renvoie instantanément à ses souvenirs d’enfant : « Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir »[2].
Dans son travail d’écriture, Proust distingue la mémoire volontaire qui permet de restituer le passé et la mémoire affective involontaire qui autorise de le revivre à l’occasion de rencontres sensorielles : la coïncidence entre une sensation actuelle et le souvenir de cette même sensation, éprouvée longtemps auparavant, provoque la résurrection de tout un monde oublié.
Autre artisan de la mémoire, Georges Perec a écrit un livre intitulé Je me souviens, qui illustre page après page le jeu de remémoration dans laquelle on peut se lancer à partir de cette phrase qui invite les souvenirs à remonter à la surface. Il écrit 480 souvenirs soigneusement numérotés : « 297- Je me souviens des billes en terre qui se cassaient en deux dès que le choc était un peu fort, et des agates, et des gros calots de verre dans lesquels il y avait parfois des bulles. 298- Je me souviens du gang des tractions avant. 299- Je me souviens de la Baie des Cochons ». Derrière ce jeu de mémoire, se cache un projet inspiré d’un artiste plasticien américain, Joe Brainard, qui a publié sous le titre I remember[3] une litanie de 1497 souvenirs personnels, familiaux, sexuels, et fantasmés.
De cette manière kaléidoscopique, Joe Brainard (né en 1941 et publié en 1970) crée et façonne la mémoire d’une génération. Sur ce modèle, Perec cherche à décrire « ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infraordinaire, le bruit de fond, l’habituel ».
Ce recueil écrit pour « essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose » devient un livre-culte, témoin d’un goût très largement partagé pour la saveur des souvenirs. Il laisse son empreinte chez les artistes contemporains, comme Christian Boltanski et Sophie Calle, qui placent au cœur de leurs œuvres l’infraordinaire et le mémoriel.
On pourrait dire que la psychanalyse est une clinique du souvenir. Au tout début de ses constructions théoriques, alors qu’il écoute ses patientes, Freud avance que « les hystériques souffrent de réminiscence »[4] : elles subissent leurs remémorations, leurs symptômes sont les symboles d’événements traumatiques réactualisés.
Nous savons aujourd’hui que les événements, qu’ils soient réels, fantasmés ou transformés par le souvenir, produisent des effets traumatiques et fabriquent des symptômes.
Longtemps après Freud qui attendait beaucoup des découvertes scientifiques ultérieures à son travail, voici ce que nous racontent les neurosciences : les souvenirs ne sont pas des enregistrements fixes, mais des reconstructions dynamiques qui évoluent avec le temps. Il existe 3 types de mémoire, celle des événements personnels (mémoire épisodique), celle des connaissances générales et des faits (mémoire sémantique), celle des apprentissages moteurs (mémoire procédurale).
Les souvenirs sont stockés dans différentes zones du cortex en fonction de leur nature, à chaque rappel le souvenir est reconstruit, ce qui peut le modifier. Ainsi les souvenirs peuvent être renforcés ou affaiblis avec le temps, d’autant que les émotions influencent leur force et leur précision.
C’est ce que les neurosciences appellent la plasticité et la réécriture possible de la mémoire qui est donc sujette aux erreurs et aux faux souvenirs, car soumise à l’influence d’autrui, à la suggestion ou au stress.
Le vocabulaire des neurosciences peut tout à fait servir à décrire le processus psychothérapeutique et psychanalytique : il s’agit bien de rappeler les souvenirs, de les mettre en forme par le récit, de mieux saisir leurs ingrédients inconscients, de contenir les émotions qui sont liées aux représentations, et donc de les modifier et les reconstruire afin qu’ils ne participent plus à la répétition d’expériences anciennes dans le présent, une répétition dont le sujet a perdu la trace et qui s’exerce à son insu.
Pour Freud, le but est de combler les lacunes de la mémoire et de vaincre les résistances du refoulement, car ce qui est oublié et refoulé ne reparaît pas sous la forme de souvenir mais sous la forme d’acte. Freud décrit le travail analytique comme un champ de bataille : « il n’est pas possible de tuer un ennemi qui est absent ou qui n’est pas suffisamment proche »[5] et l’on ne peut pas traiter les difficultés du sujet « comme une affaire d’ordre historique mais comme une puissance actuelle »[6].
Il s’agit de réveiller les souvenirs à partir des répétitions qui se manifestent dans la relation transférentielle, de surmonter les résistances de sorte que les souvenirs surgissent ensuite par eux-mêmes. Ramené dans le champ de la conscience, un souvenir peut être reconstruit, consolidé ou affaibli, puis réinscrit dans une trame narrative.
Mais tous les souvenirs n’ont pas la saveur de miettes d’une madeleine moelleuse dans une tasse de thé délicat. Les guerres et conflits armés du 20e siècle ont conduit à la reconnaissance des séquelles psychologiques graves des soldats qui une fois revenus chez eux souffrent de troubles persistants, comme l’insomnie, les angoisses, la dépression, la violence, la toxicomanie. Ils sont en proie, depuis la situation traumatique qui a déclenché surprise et effroi, à des images terrifiantes qui envahissent leurs pensées.
EN 1980, le DSM-III introduit officiellement la notion de stress post-traumatique qui va s’élargir au-delà du contexte militaire et concerner les violences physiques et sexuelles, les catastrophes naturelles, les attentats terroristes et les accidents graves. Pour essayer de comprendre la compulsion de répétition dans les états traumatiques, Freud développe le concept de pulsion de mort, une spéculation qu’il ne peut valider de manière scientifique, mais qui reste très utile pour penser la clinique !
Les personnes qui hésitent à s’engager dans une psychanalyse ou une psychothérapie craignent souvent de réveiller des souvenirs douloureux comme s’il s’agissait d’un ogre endormi, un ogre qu’il ne faut pas déranger au risque de se faire croquer en retour.
Mais laisser le monstre dormir en marchant sur la pointe des pieds et en chuchotant a aussi des effets secondaires indésirables : se contenir, réprimer ses pensées et ses mouvements pulsionnels, tarir l’élan vital, limiter le déploiement de la vie.
On peut essayer d’enfouir les souvenir douloureux dans l’ombre des sillons cérébraux, en espérant qu’ils ne se libèrent pas d’eux-mêmes. Envoyés aux oubliettes, leur potentialité négative peut cependant s’exhaler, se propager et participer à des choix malheureux à l’insu même du sujet qui essaie pourtant de les neutraliser.
Alors se souvenir, à quoi bon ? La réponse de la psychanalyse, c’est d’offrir un cadre calfeutré et sécurisant pour accueillir les souvenirs pénibles et donner les moyens de faire du déplaisir un objet de remémoration et d’élaboration psychique.
Pour reconstruire le passé refoulé avec Freud ou devenir maître du temps avec Proust.
[1] Amélie Nothomb, L’impossible retour, Albin Michel, 2024.
[2] Marcel Proust, Du côté de chez Swann, GF Flammarion, 1987.
[3] Joe Brainard, I remember, 1970, traduit en français en 1997.
[4] Sigmund Freud, Etudes sur l’hystérie, PUF.
[5] Sigmund Freud, « Remémoration, répétition, perlaboration », dans La technique psychanalytique, Œuvres complètes, PUF.
[6] Sigmund Freud, « Remémoration, répétition, perlaboration », dans La technique psychanalytique, Œuvres complètes, PUF.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de février 2025