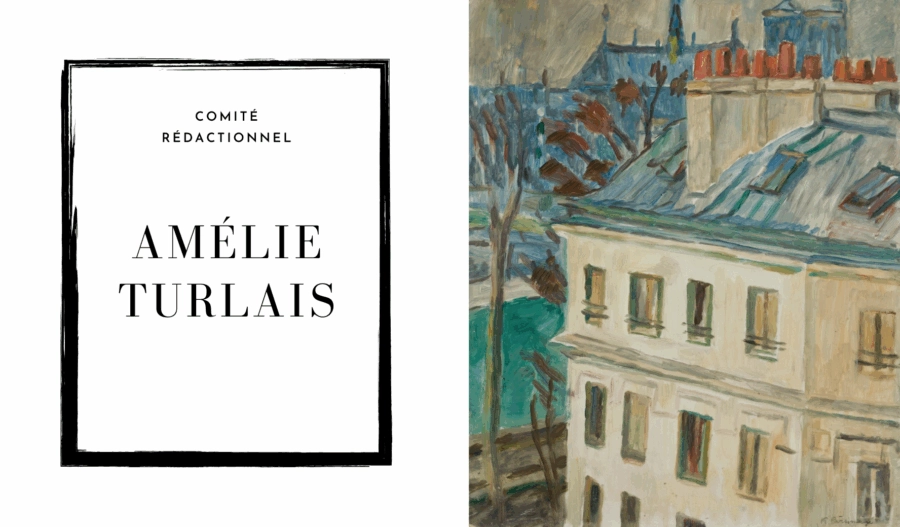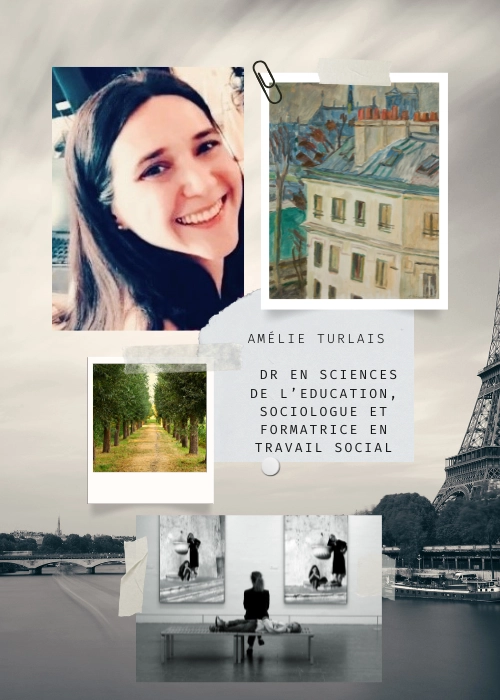Lors de cette chauffe du cerveau… Je ne sais pas comment opère le vôtre, mais le mieux est un bon vieux diesel (enfin je l’espère moins polluant) il a besoin d’être émulsionné pour fonctionner à pleine puissance, mais là je m’égare.
Je disais donc lors de cette chauffe du cerveau, certainement par association libre, j’ai revécu deux expériences : l’une lors d’une recherche-action en AEMO, l’autre lors d’une animation de groupe d’analyse des pratiques en crèche.
Alors quand il a fallu se mettre à l’écriture de ce billet, je suis passée par plusieurs entrées en matière. Voyez-vous j’avais mon fil rouge, je savais l’idée que je voulais vous présenter ; mais malgré de nombreuses marches méditatives, ce fil restait une belle pelote que je n’arrivais pas à tricoter.
Aussi, j’ai suivi le conseil que je peux donner à mes étudiant·es quand ils/elles déboulent angoisé·es dans mon bureau parce que : « vraiment, mais vraiment, Amélie, vous ne comprenez pas, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas comment l’écrire, je suis devant mon ordinateur, mais rien ne sort. ».
J’ai pris une feuille et un stylo et j’ai décrit ces deux expériences passées peut-être sans être trop fidèle à une certaine réalité. Depuis le comité rédactionnel, elle me collait à la peau, il fallait que je m’en détache pour pouvoir tricoter de manière intelligible ma pensée par la suite. Je vous les livre ici:
Réminiscence d’expérience 1 :
Nous sommes en 2010. Je participe à ma première recherche-action, au sein d’un service d’Aide Educative en Milieu Ouvert. La commande a été faite par la direction générale. Face à un service surchargé, plus de 32 mesures par travailleurs sociaux, l’objectif est de pouvoir mieux comprendre cette surcharge de travail. La première hypothèse est que les situations sont de plus en plus complexes ; qu’au-delà de la prise en charge sociale, les jeunes, les enfants ont de plus en plus de troubles psy. En plus, nous expliquera un éducateur spécialisé, on a plus de moyens, on ne peut plus faire de « sortie resto ». Sortie resto présentée comme un outil essentiel pour construire le lien de confiance qui permettra de travailler : avec le jeune ?, sur le jeune ? Avec ou sur, ma mémoire vacille.
Réminiscence d’expérience 2
Nous sommes post-Covid, je m’en souviens bien, nous n’avons pas de masque pour ce temps d’analyse des pratiques alors que nous avions commencé avec ce groupe avec un masque. Cela doit faire une petite année que nous élaborerons ensemble. Ce jour-là nous parlons de la routine en crèche. Une lassitude de la routine qui est présentée comme psychiquement épuisante par l’équipe.
Le cerveau s’endort, et le corps ne réagit pas bien : mal aux articulations, douleur dans le dos. « Et vous comprenez en plus, nous n’avons pas encore le budget pour acheter d’autres jouets, d’autres jeux. Ça ne nous aide pas à pouvoir mettre en place des activités » m’explique une professionnelle de la crèche.
À l’écriture de ces réminiscences, ma pelote commence à se dérouler. Pourquoi avoir besoin de consommer pour exercer correctement ses missions ? Pourquoi les éducateurs en protection de l’enfance valorisent-ils tant la sortie resto ? Pourquoi les professionnels de crèche ont besoin de nouveaux jouets ?
À cette mise en question, je rigole de moi-même : pourquoi ai-je besoin de m’acheter tant de « jolis » stylos et cahiers pour l’animation des GAPs et pour écrire mes observations de recherche ? Parce que le temps que je passe à chercher, choisir, et à acheter cahiers et stylos, je ne le passe pas à réfléchir.
Et même si trop souvent on m’a dit que je réfléchissais trop, je ne vais pas vous mentir, c’est quand même bien plus simple de faire le tour des papeteries parisiennes, que de s’asseoir à une terrasse de café ou à mon bureau pour reprendre à froid les temps d’échange en GAP ou analyser les données collectées en recherche.
Serait-ce donc cela « sortir au resto », « acheter des nouveaux jeux » donnerait l’illusion d’être dans l’action. Je fais alors le lien « faire sur » et « faire avec ». La première fois où je conscientise une transformation dans la structuration des pratiques psycho-socio-éducatives je suis en plein échange avec une amie qui comme moi à ce moment est en pleine écriture de thèse.
Elle me parle alors de Saül Karz et de sa distinction entre : faire pour les personnes, faire sur les personnes, faire avec les personnes. Aussitôt je pars me replonger dans quelques-uns de ces écrits. Je fais alors du lien avec un enseignant-chercheur qui a eu beaucoup d’influence dans mon parcours : Dominique Fablet.
Dans un article écrit en 2009 intitulé : Quels modèles de référence pour les travailleurs sociaux ?, Fablet présente une typologie « chronologique » des valeurs et références qui orientent les pratiques des intervenants socio-éducatifs. Dans un premier temps, il présente le modèle de référence de : La vocation et sa tendance moralisatrice.
Dans un second temps, le modèle de référence de : La technique relationnelle et sa tendance psychologisante, auquel pourrait s’ajouter même si cela n’apparait qu’en filigrane dans son écrit le modèle de référence : La médiation sociale et sa tendance contractuelle. Cette modélisation rejoint ce que d’autres chercheurs ont pu mettre en avant. Castel (2003) argumente le passage d’un État providence et d’une logique statutaire ou tout individu à accès à des prestations sociales dans une intention de prévention des risques à un État actif et d’une logique contractuelle ou l’individu doit se saisir des moyens à sa disposition pour agir sur ses difficultés.
Astier, Duvoux (2009) développent l’idée que dans nos sociétés actuelles si l’individu n’est pas maître de son sort, il doit être maître de son de sa vie. Ehrenberg (2001) identifie l’autonomie comme nouvelle norme de nos sociétés et lors de la journée institutionnelle de Cerep-Phymentin (entre autres) en 2017 explique le passage rhétorique du vocable : maladie mentale à celui de : santé mentale.
Pour Ehrenberg se dessine alors la figure d’un nouveau patient en psychiatrie avec qui les intervenants doivent « agir avec lui » plus qu’« agir sur lui ». Au fil des ans, et au fil de mes lectures, recherches, analyses de pratique, j’ai cherché à modéliser les choses à partir du schéma que je vous présente ci-dessous.
Je vous demande toute votre indulgence à sa lecture, il est en cours de construction et loin d’être complet. Je vous en souhaitais quand même la découverte puisqu’il va me permettre après avoir déroulé ma pelote de tricoter ma pensée.
Si nos sociétés sont en constante évolution, loin de moi de vouloir affirmer que l’« avènement » d’une société en chasse une autre. Cependant, force est de constater que de plus en plus les valeurs et normes de la société hypermoderne s’imposent à nous.
Prenons le bel étendard que l’on sort pour briller en société celui du pouvoir d’agir et de l’empowerment. Ok ok peut-être que je m’enflamme un peu ici, le pouvoir d’agir permet de redonner la parole à des personnes qui longtemps ont été niées, occultées, invisibilisées. Pourtant, quoi faire avec les personnes qui n’ont pas cette capacité à mobiliser le pouvoir d’agir qu’on leur donne.
Dans cette perspective et j’espère avoir l’occasion de le développer plus dans un autre billet pour Tempo, oui la santé mentale nous a vendu du rêve. Qui ne voudrait pas que cesse cette cacophonie entre le champ du social, du médico-social et du sanitaire? Quel doux rêve d’envisager pouvoir penser l’individu dans sa globalité, penser sa prise en charge par une complémentarité des intervenants de ces différents champs.
Pourtant, de plus en plus je suis dubitative, cette injonction à rendre l’individu actif ne fait-elle pas de lui un consommateur des dispositifs qui lui sont proposés ? Consommer des dispositifs ne serait-ce pas être dans cette fameuse illusion de l’action ? Ne serait-ce pas avec une illusion d’agir sur les difficultés rencontrées ? Peut-être ai-je tort ? Peut-être et je le souhaite le futur me donnera tort ? Pourtant, pour l’instant, je préfère toujours dérouler ma pelote pour tricoter ma pensée, qu’aller consommer x ou y outils pour être dans l’action.
Alors me direz-vous, j’ai été formée à la psychothérapie institutionnelle au Cerep-Phymentin donc même en tant que « sociologue », je reste avant tout clinicienne et je préfère l’idée de participer à la transformation des éprouvés des personnes accompagnées que celle de devoir leur apprendre à être actif pour s’adapter.
D’ailleurs, être actif pour s’adapter, ce ne serait pas un retour à une société traditionnelle qui attendait que l’individu se conforme ? Sous couvert de pouvoir d’agir par la consommation, peut-être pour maladroitement paraphraser Donzelot (1977), n’y a-t-il pas un risque de créer une nouvelle police des individus ? À force de vouloir voler trop proche du soleil, comme Icare, nous prenons le risque de nous brûler les ailes.
Bibliographie
Astier, I., Duvoux, N. (2006). La société biographique: une injonction à vivre dignement. Paris : L’Harmattan.
Castel, R. (2003). L’insécurité sociale. Qu’est-ce que protéger ? Paris : Le Seuil.
Donzelot, J. (1977). La police des familles. Paris : Éditions de Minuit.
Ehrenberg, A., Lovell, A. (dir.) (2001). La Maladie mentale en mutation. Psychiatrie et société. Paris : Odile Jacob
Fablet, D. (2009). Quels modèles de référence pour les travailleurs sociaux ? Empan, 75 (3), 72-79
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de juin 2024