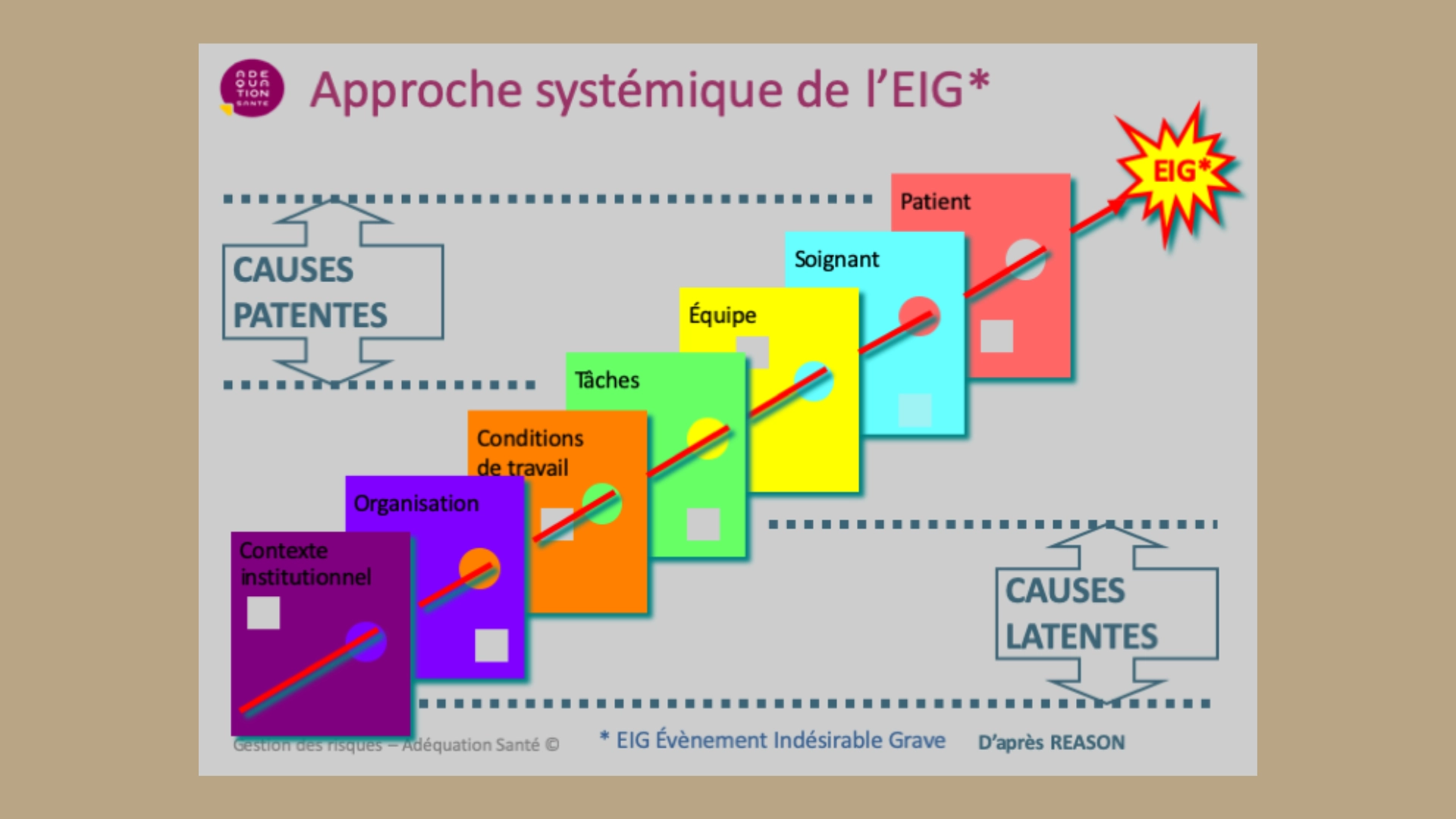Un outil qu’on connaît déjà : le DUERP
Avant même de parler du référentiel HAS, la plupart d’entre nous connaît le DUERP : Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels. Si ce n’était pas le cas, voilà chose faite à présent !
Le DUERP recense les risques liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail des professionnels, dans toutes les organisations y compris les nôtres à Ce n’est pas la HAS, c’est le Code du Travail. Une obligation légale, un outil de prévention, et un point d’appui.
Mais mon propos de ce mois est une invitation à aller plus loin et de porter notre attention au-delà, sur les risques qui nous concernent en tant que salariés ; en s’intéressant aussi à ceux qui peuvent affecter les personnes que nous accompagnons : enfants, adolescents, familles, ainsi que les stagiaires et les formateurs. C’est une culture du discernement, pas une procédure de plus.
Ce qu’on appelle « risque » dans la démarche qualité
Dans le cadre de la qualité, un risque est défini par la HAS comme :
« Un événement potentiellement indésirable, lié aux activités d’un établissement, pouvant affecter la santé, la sécurité ou les droits des personnes accompagnées. »
Cela peut être un danger visible (chute, fugue, tension physique), ou plus insidieux (désorientation, défaut d’information, etc.). C’est donc tout ce qui pourrait compromettre notre capacité à bien remplir nos missions.
Et si cette définition s’applique d’abord aux établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (c’est-à-dire du point de vue des personnes accompagnées), le principe général peut être étendue à l’activité de formation.
Comment on les évalue ? Comprendre la cotation d’un risque
Un risque n’est pas une intuition : c’est une situation qu’on peut analyser objectivement, selon trois dimensions :
|
Élément |
Question à se poser |
Échelle |
|
Sa gravité |
Si cela se produisait, à quel point les conséquences seraient-elles graves ? |
de 1 (peu grave) à 5 (très grave) |
|
Sa vraisemblance (fréquence) |
Quelle est la probabilité que cela se produise, dans notre contexte actuel ? |
de 1 (peu probable) à 5 (très probable) |
|
Notre maîtrise |
Est-ce qu’on a des barrières efficaces en place pour éviter que ça arrive ? |
de 1 (bien maîtrisé) à 5 (non maîtrisé) |
C’est en mettant en rapport ces trois dimensions, qu’on obtient un score appelé criticité : Gravité x Fréquence x Maîtrise. Plus le score est élevé, plus le risque est prioritaire à traiter.
À noter : on parle ici de risques, dès qu’un événement s’est réellement produit, on parle d’événement indésirable – et là, on analysera la fréquence observée, les causes, les impacts et les leviers correctifs.
Et chez nous, ça pourrait être quoi ?
A la crèche (secteur social)
Un parent non identifié qui récupère l’enfant, un allergène non signalé, un enfant invisible qui s’efface dans le groupe…
Ce ne sont pas des incidents imaginaires. Ce sont des risques environnementaux, relationnels, organisationnels, bien réels, que l’on évite grâce :
- à la vigilance collective,
- à des règles claires et partagées,
- et surtout, à une présence attentive.
Dans une crèche, la sécurité repose autant sur les gestes que sur les regards.
Dans les structures de soins : CMPP, IME, CMP et hôpitaux du jour
Dans nos structures de soins, qu’elles relèvent du champ médico-social ou sanitaire, certains risques sont parfois perçus comme des évidences : « C’est notre quotidien », « C’est la pathologie », « C’est inhérent à notre public ». Mais c’est justement là que le piège commence.
Les référentiels HAS, tout comme notre cartographie, nous invite à prendre en considération le risque, peu importe sa nature.
Voici quelques situations issues de notre cartographie des risques, qui montrent bien que ce « faire avec » mérite d’être pensé collectivement :
- Une fugue d’un enfant ou adolescent, sans déclenchement immédiat du protocole d’alerte,
- Une discussion tenue dans un lieu non confidentiel (ex. : couloir, salle d’attente),
- Une absence de coordination dans les transmissions entre professionnels en cas d’absence ou de relais,
- Un projet personnalisé figé, rédigé sans la famille ou non actualisé depuis plus d’un an,
Ces situations sont précises. Documentées. Et elles ne sont ni exceptionnelles, ni intentionnelles. Elles nous montrent que la maîtrise du risque ne dépend pas seulement d’une compétence individuelle, mais bien d’une organisation partagée, d’un cadre pensé, d’une lecture d’équipe.
C’est cela que nous cherchons à consolider.
Comment aujourd’hui on s’organise pour faire avec et questionner les situations en équipe ?
Au COPES (secteur formation)
En formation, les risques ne se voient pas toujours. Et pourtant :
- Un formateur non prévenu d’un changement de date d’intervention
- Des documents de matériel clinique non anonymisé
- Un intervenant mal préparé ou un contenu non adapté au public.
En conclusion
La gestion des risques, ce n’est ni un contrôle, ni une chasse aux erreurs. Elle fait partie de notre culture, de nos pratiques professionnelles et de ce qui fait sens dans nos métiers et à ce titre, il est nécessaire de se reposer la question de ce que je pourrais attendre en tant qu’usager ?
Ainsi, ce que nous espérons tous en tant qu’usagers est aussi ce que nous devons garantir en tant que professionnels. Nous sommes tous responsables de la sécurité des personnes et des biens ; nous sommes aussi garants du soin.