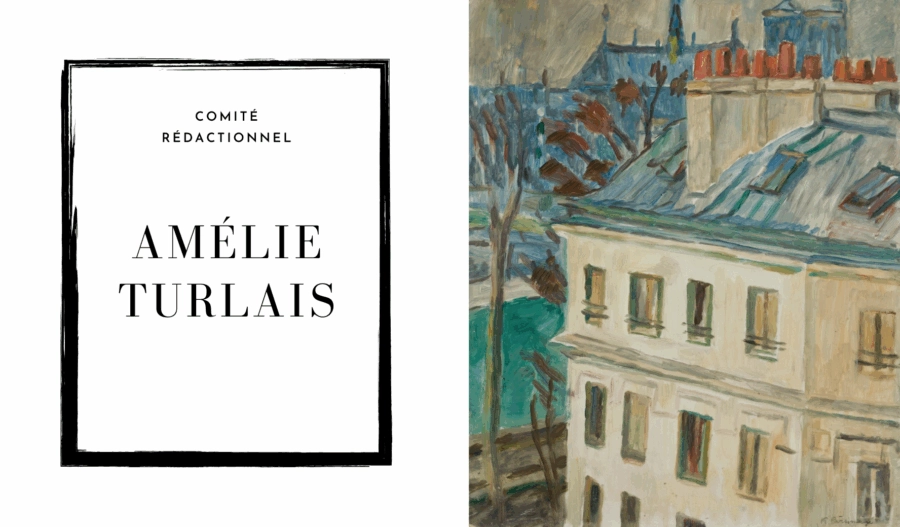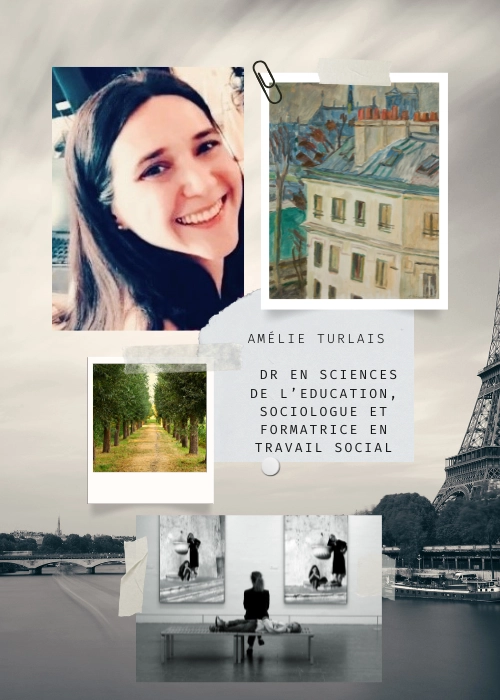Lors de mes recherches, tout particulièrement mes premières, j’ai placé la focale sur la volonté de comprendre : comment les différents acteurs du social, du médico-social et du sanitaire, travaillaient ensemble? Par exemple : comment des soignants avec une approche psycho-dynamique de l’enfant travaillaient avec des éducateurs spécialisés dans le champ de la protection de l’enfance ? Chemin faisant, je me suis vite rendue compte que la question que je devais me poser en tant que sociologue n’était pas : comment tout ce beau monde travaillait ensemble? ; mais pourquoi avec un même objectif commun, est-il si compliqué de travailler collectivement ?
En tant que sociologue-clinicienne, questionner le « travail d’équipe », le partenariat, la collaboration, la coopération, m’a placée dans une position que j’oserais qualifier de confortable, un pied dedans, un pied dehors ; sans vraiment être prise dans les tensions institutionnelles qui agitent les beaux idéaux d’un travail ensemble. Devenir sociologue, c’est en même temps recevoir un « enchantement » et un « mauvais sort ». Tout du moins, c’est ainsi que je le vis.
Mes études m’ont permis d’acquérir des pouvoirs d’observation du non-verbal, de l’écoute-active, de compréhension des non-dits, du repérage des secrets. Tous ces pouvoirs amènent à acquérir un superpouvoir celui d’une acuité fine d’identification des tensions institutionnelles. Mais quand, j’essaye de trouver ma place en équipe ce super-pouvoir peut devenir malédiction.
Combien de fois dans mes postes de formatrices et même dans ma vie personnelle quotidienne, ai-je pu entendre : « Amélie, arrête de te placer à l’extérieur du groupe ». Mais moi je n’y arrive pas et je n’ai pas envie d’y arriver. Parce que cette place de tiers, elle manque de plus en plus souvent aux équipes du social, du médico-social, du sanitaire, et de la petite enfance.
Une fois cela couché sur le papier, je me suis dit qu’écrire sur le « faire ensemble » aurait plus de sens et de résonnance en invitant une collègue : Caroline, avec une expérience de terrain, en tant qu’éducatrice de jeunes enfants (EJE), à écrire avec moi. Aussi, sous forme de dialogue, je vous propose une vision croisée des enjeux que je qualifierais de socio-culturels du travail d’équipe.
Caroline : J’ai longtemps cherché la mélodie secrète du « travailler ensemble ». Pour débuter cet échange je voudrais raconter une expérience que j’ai vécue en crèche. J’étais responsable d’une structure, supérieure hiérarchique de mes collègues (la formulation de cette phrase laisse entrevoir la contradiction) et éducatrice de jeunes enfants. J’avais fait le choix de vouvoyer mes collègues qui, entre elles, se tutoyaient. Pour moi, c’était probablement un enjeu de statut qui devait être perçu par tous mais aussi un moyen pour moi de me penser légitime à ce poste.
Un soir, un père m’interroge : « Mais Caroline, pourquoi vous vouvoyez les autres professionnelles ? Vous êtes bien toutes collègues ? Vous êtes toutes auprès des enfants ? » Me voilà bien embêtée: comment justifier mon choix (et ma posture ?) auprès du parent ? En effet, nous sommes trois dans l’équipe à cette période, à première vue, nous faisons toutes la même chose auprès des enfants. Nous les accompagnons durant la journée, à travers le jeu, les repas, les temps de soin. Mais chacune à notre manière.
Roxanne, auxiliaire de puériculture, change les couches des enfants en étant très consciencieuse, elle suit le protocole à la lettre, gants, serviette propre qu’elle met à laver après chaque change de couche. Zaïda, professionnelle titulaire d’un CAP petite enfance, apprécie les journées lorsqu’elle est en cuisine. Tout comme Roxanne, elle respecte les protocoles à la lettre et est ravie de retrouver les enfants pour le moment du repas ensuite. Elle a eu un temps à part, dans l’office, un peu à l’écart du bruit et de l’agitation d’avant repas et elle retrouve les enfants lorsqu’ils sont en train de manger. Quant à moi, lorsque je change la couche d’un enfant, je n’ai pas la même technique que Roxanne. Je ne mets pas forcément de gants, j’oublie de mettre la serviette à laver.
Par contre, j’observe les gestes que fait l’enfant durant le temps de soin, ce temps privilégié que je passe avec lui. J’essaye de suivre son regard, de voir ce que lui- même observe et de commenter ou d’expliquer tout ce que je fais. Je ne dis pas là que mes collègues ne le font pas mais qu’elles ne le font pas de la même manière.
Amélie : Il me semble que ce n’est pas seulement une différence de formation ou de sensibilité. C’est une différence culturelle profonde : entre une approche technique de la tâche et une approche clinique de la relation. Entre une vision gestionnaire du travail et une vision engagée du soin. Et aujourd’hui, ce décalage tend à être gommé par une novlangue avec des mots-valises : « interprofessionnalité », « partenariat », « synergie ». Dans ce que j’observe, dans ce que je vis, beaucoup d’institutions demandent l’harmonie sans accueillir les divergences. Elles ordonnent l’équipe comme une évidence, sans organiser les conditions de sa construction.
Caroline : Oui parce qu’entre changer une couche selon le protocole et changer la couche d’un enfant en suivant son regard, il y a une différence de monde. J’ai observé des auxiliaires de puériculture ajuster leur geste à la consigne, des éducatrices de jeunes enfants endosser des postures de soin, des soignants déplier avec une infinie patience la souffrance muette des enfants. J’ai vu les tables de réunion se couvrir de protocoles, de projets, de feuilles de route où était écrit, à chaque page : « en coopération ». Mais la coopération est un art rude. Elle ne naît pas de l’injonction à coopérer. Elle surgit à travers les tensions, les ratés, les écarts. Elle suppose une écoute patiente de ce qui fait défaut : la reconnaissance réciproque, le sens partagé, la confiance éprouvée.
Amélie : Dans les équipes de crèches, dans les services de protection de l’enfance, dans les unités de soin psychique, je retrouve un même paradoxe : chacun travaille auprès du même public, avec des objectifs apparemment similaires et pourtant, j’ai toujours le même sentiment, quand toutes et tous communiquent ensemble en français, chacun semble parler une autre langue.
Caroline : Dans la solitude silencieuse des directrices de crèches, dans les regards fuyants des réunions d’équipe, dans la fatigue nerveuse des éducateurs en protection de l’enfance, je lis toujours la même fatigue : celle de devoir paraître « unis » quand on ne peut pas s’entendre.
Amélie : Alors qu’en vrai est-ce que travailler ensemble, ce ne serait pas accepter que nos façons de faire, nos représentations, nos héritages sociaux, soient différents, parfois inconciliables ? C’est oser dire qu’une auxiliaire de puériculture, une éducatrice de jeunes enfants, un psychologue ne font pas « la même chose » – et que c’est précieux. Ce qui manque aux équipes du social, du médico-social et de la petite enfance, ce n’est pas la bonne volonté. C’est l’espace pour penser la différence. L’espace pour dire que coopérer, ce n’est pas faire semblant d’être d’accord ; c’est tenir ensemble, dans un même projet, nos désaccords, nos doutes, nos pratiques multiples.
Caroline : Oui, si nous acceptions de parler de ce qui nous sépare, de ce qui nous trouble, peut-être alors naîtrait le véritable « travail d’équipe » : celui qui n’efface pas la diversité des regards, mais l’institue.
Amélie : En tant que sociologue-clinicienne, j’ai appris, au fil des équipes traversées, à ne plus craindre la position de tiers. Être à la fois dedans et dehors, à la fois avec et à côté. Même si paradoxalement parfois ce que cela me permet de voir, c’est-à-dire ce que l’équipe elle-même ne voit plus ; met en difficulté mon propre travail avec cette équipe.
Caroline : J’ai l’impression que la fonction de tiers, aujourd’hui, est en voie de disparition dans nos institutions. Sans tiers, les tensions s’aggravent jusqu’à l’épuisement, la fuite, le conflit ouvert. Dans les équipes de soin psychique, dans les crèches, dans les services sociaux, il faudrait s’autoriser à exprimer les désaccords. Il faudrait des temps pour dire ce qui ne va pas.
Amélie : Travailler ensemble serait alors un art de la dispute créatrice, un engagement à tenir la complexité du monde plutôt que de la nier. Ainsi, derrière les protocoles et les conventions, subsiste une tâche discrète, mais essentielle : faire exister, à l’endroit des équipes, une éthique du dissensus, une clarté sur nos différences, une hospitalité à la complexité humaine.
Si vous lisez, mes billets régulièrement, vous savez peut-être que je me sens funambule, alors pour conclure je vais reprendre cette image, de mes expériences de ce dialogue, il me semble que travailler ensemble, c’est danser sur un fil tendu entre nos différences, nos maladresses et nos envies communes. Parfois, le fil distendu peut nous faire trébucher, parfois il nous permet de nous accorder et d’avancer ensemble le pas peut être un peu bancal, mais toujours empreint de notre humanité et de nos singularités.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO d’avril 2025