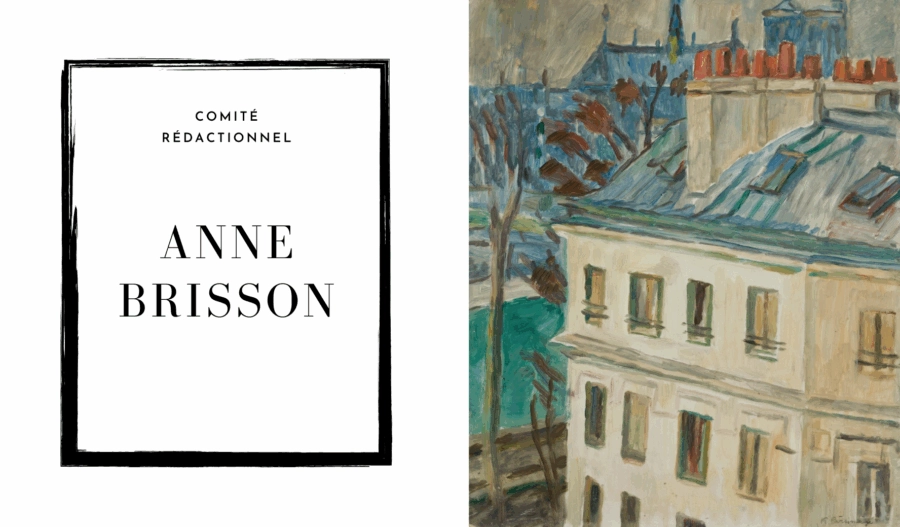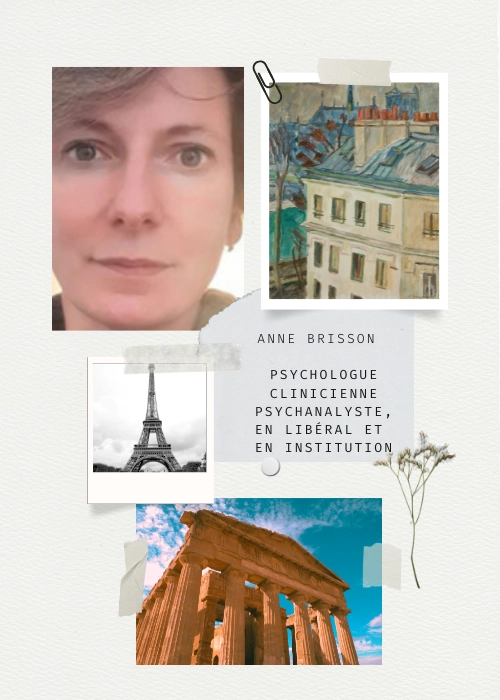Pour être tout à fait honnête, je n’ai jamais été complètement convaincue par ce dispositif qui consiste à proposer aux stagiaires d’observer la clinique qui se déploie dans la salle d’attente. Souvent, il s’agit de leur trouver un objet d’étude parce que le cadre des psychothérapies et de certaines consultations ne peut leur être accessible, et pour donner une validité à cette proposition, on souligne l’intérêt nosographique de tout ce qui peut être observé dans la salle d’attente : l’attitude des adultes, la façon dont les enfants découvrent et explorent l’environnement, la distance qu’ils prennent à l’égard de leurs parents, les interactions entre eux. C’est à la fois vrai et pas tout à fait sincère…
En effectuant quelques recherches sur ce thème, je redécouvre le travail de Michel Soulé, fondateur et chef de service de la Guidance infantile, ce fameux pédopsychiatre de la 1re génération, avec Serge Lebovici et René Diatkine.
J’en profite et je fais un petit détour : Michel Soulé est redevenu stagiaire, à la fin de sa carrière, en assistant en tant qu’observateur aux consultations d’échographie, parce qu’il s’intéressait à la question de l’annonce du diagnostic anténatal. Pionnier de la psychiatrie fœtale, il observe les interactions entre les praticiens et les parents et aborde avec le mélange d’humour et de finesse dont il était capable la violence fantasmatique en jeu dans ces moments chargés en émotions. Pour Michel Soulé, l’échographie[1] est un outil de connaissance du fœtus vivant et ouvre un espace symbolique où s’articulent les aspects somatiques et psychiques, dès la vie intra-utérine.
C’est une expérience fondatrice de la parentalité parce que l’échographie marque « la première rencontre » avec l’enfant à venir, celui que la stagiaire psychologue observera peut-être par la suite dans la salle d’attente de la Guidance ! Pourrait-on dire que la consultation échographique est la salle d’attente de la parentalité ?
Revenons à la salle d’attente dont Michel Soulé a fait le thème de la 12e journée scientifique du centre de Guidance infantile de l’Institut de Puériculture de Paris, en 1985, car il souhaitait décrire une clinique « dont l’importance est toujours pressentie mais jamais prise en compte ». Toutes les interventions ont été rassemblées dans un livre aux éditions ESF, La salle d’attente, « clinique » et espace méconnus.
Le premier article fait référence à Freud qui, dans une lettre à son ami Fliess, se dit « hanté par le désir » de son voyage à Rome « au milieu de la dépression matérielle et morale de ce temps » et qui explique que l’attente prolongée use la force du rêve : « Toutes les réalisations de ce genre sont toujours un peu décevantes quand on les a trop longtemps attendues ».
Puis la lumière est mise sur l’architecture de la salle d’attente à travers l’histoire, avec une très belle analyse de la fonction du cloître des abbayes : « Son enjeu est essentiellement symbolique, en ce qu’il vaut autrement que dans son usage, il procède d’une partition des lieux, chose bien différente d’un découpage en unités autonomes, cloisonnées, atomisées ; on le découvre parmi d’autres lieux quand bien même s’y déroulent des activités, elles, très codifiées ; il est en partie protégé, en partie à l’air libre. Enfin il accueille la nature, laquelle n’était pas pensée comme nature, au sens où nous la comprenons aujourd’hui, séparée de l’homme »[2].
A l’époque romaine, comme à la Renaissance, l’attente n’est pas conçue comme statique, elle est dynamique et déambulatoire. A l’opposé, la salle d’attente à l’hôpital, dans les institutions, entrave la déambulation, « elle est un point de fixité obligé », elle est « une pratique de corps assis, immobiles ». La présence de bébés et de jeunes enfants dans la salle d’attente réintroduit les notions de mouvements et de déplacements.
De manière plus attendue (pour une journée scientifique de pédopsychiatrie), les articles qui suivent explorent cet espace dédié à l’attente pour comprendre ce qui s’y joue en fonction de ce que les patients viennent y chercher. Les développements théoriques et cliniques nous apportent un éclairage sur les liens entre salle d’attente et aire de transition, les processus d’attente avant qu’une place en institution se libère, les enjeux de l’attente avant une consultation pour IVG, la salle d’attente qui se transforme en espace de paroles sur la féminité pour les adolescentes qui consultent en gynécologie et contraception, les fantasmes qui émergent dans l’attente de la première échographie de la grossesse, la salle d’attente de PMI qui reste un lieu d’accueil ouvert aux enfants et à leurs parents en dehors même des temps de consultation, la mise en œuvre de la séparation quand les parents attendent leur enfant pendant sa séance, etc.
Il y a le cadre concret et puis tout ce qu’il contient comme élaborations intrapsychiques et interindividuelles. Je reprends ici le développement de Bernard Brusset[3] qui passe de l’espace réel à la scène psychique : « Ainsi, délaissant maintenant le cadre limité de la salle d’attente, des événements et des discours qui s’y produisent, des activités et des attitudes que l’on y observe, j’envisagerai l’attente en tant qu’elle donne lieu à des opérations psychiques, en tant qu’elle fait penser, réagir et éventuellement changer, non plus la topographie en tant que figuration de la topique subjective, mais la temporalité en tant que facteur de changement ».
Il est difficile de réfléchir à la salle d’attente sans mentionner Beckett et sa pièce de théâtre intitulée En attendant Godot que l’on peut résumer ainsi : deux curieux personnages à l’allure de clochards, Vladimir et Estragon, se rencontrent dans un lieu imprécis, au pied d’un arbre squelettique.
Leur projet est d’attendre Godot, un énigmatique personnage dont on ne saura jamais rien. De fait, ils ne savent pas quand il viendra, ni même s’il viendra vraiment. L’attente est alors une métaphore de la condition humaine : les hommes attendent souvent un sens, un salut, une réponse (Dieu, la mort, le bonheur ou une révélation) sans jamais l’obtenir vraiment. Finalement, seule compte l’attente, avec son espoir d’issue et de lendemain sans ennui, car elle donne un éprouvé de vie (« On trouve toujours quelque chose, hein, Didi, pour nous donner l’impression d’exister »). Dans cette pièce de théâtre, l’attente s’organise comme un cycle absurde et répétitif, chaque jour le même déroulement se produit : Vladimir et Estragon arrivent, attendent, discutent, espèrent et repartent. Et si l’attente paraît vaine, elle donne un sens provisoire à leur vie.
La plupart du temps en pédopsychiatrie, l’attente n’est pas sans aboutissement. La rencontre entre un patient et un psy est rarement sans effet, anodine, elle offre souvent de nombreuses opportunités : comprendre le sens des symptômes, formuler un diagnostic, construire un projet de soin, consolider l’alliance, mesurer les effets du soin, ponctuer le processus. Parfois, la salle d’attente est alors l’incubateur d’un phénomène très particulier et fécond, ce que Winnicott appelle « le moment sacré »[4] et qu’il décrit comme une véritable coïncidence psychique et affective entre le patient et le soignant, un instant d’authentique rencontre entre deux subjectivités.
C’est un moment de communication non verbale, d’accordage profond, pendant lequel le thérapeute devient un « objet subjectif », c’est à-dire une figure investie de la même manière que la mère l’était dans la toute petite enfance. Il survient le plus souvent lors d’un moment de jeu symbolique partagé, où l’enfant exprime soudain quelque chose d’intime et de refoulé. Ce moment sacré réactive le cadre sécurisant du holding et ouvre sur la possibilité d’une transformation créative de ce qui est vécu. Il marque aussi la naissance d’une représentation nouvelle grâce au passage de l’informulé au symbolique. L’enfant et le thérapeute deviennent simultanément conscients de la nature exacte de la situation émotionnelle ou psychique à l’origine de la souffrance de l’enfant.
Si l’on peut toucher ainsi la grâce relationnelle, ce lien de résonance entre la subjectivité du patient et celle du thérapeute, et conforter par là même la continuité de l’être, alors cela valait vraiment le coup d’attendre !!!
[1] Michel Soulé, Luc Gourand, Sylvain Missonnier, L’échographie de la grossesse, coffret multimédia, 2000, Érès.
[2] Vincent Lelièvre et Jean-Sébastien Soulé, « Architecture et attente », in La salle d’attente, « clinique » et espace méconnus, sous la direction de Michel Soulé, 1985, ESF.
[3] Bernard Brusset, « L’attendu et l’inattendu lors du deuxième rendez-vous », in La salle d’attente, « clinique » et espace méconnus, sous la direction de Michel Soulé, 1985, ESF.
[4] D.W. Winnicott, La consultation thérapeutique et l’enfant, 1971, Gallimard.