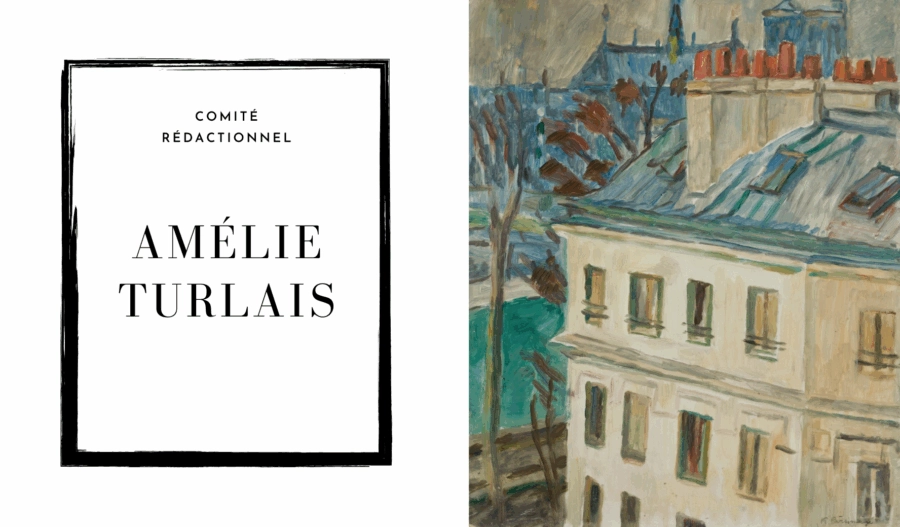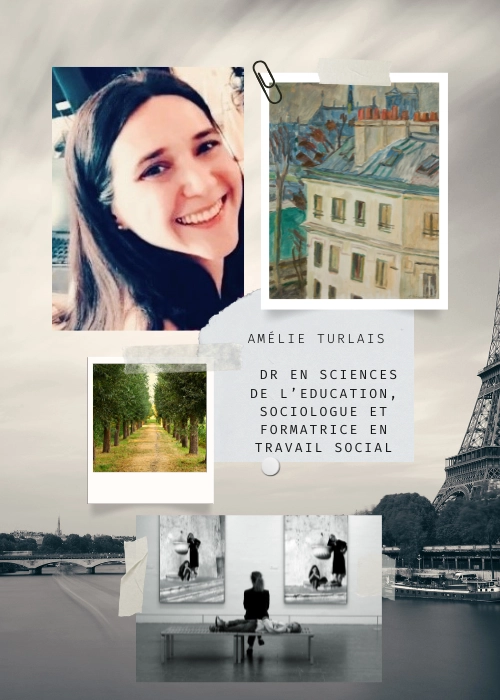Prologue
En 2002, étudiante en première année de sociologie, il m’est demandé un travail d’observation. Je ne sais pas pourquoi je choisis : les urgences. Peut-être pour voir, peut-être pour comprendre, peut-être simplement pour être là où ça bouge. Je me retrouve alors dans une salle d’attente, à observer tout et rien à la fois : les gestes, les soupirs, les mains qui se tordent, les regards qui s’accrochent. Le temps, lui, me semble étrangement accéléré… tendu comme un rideau prêt à se lever.
Si on avait dit à la gamine de dix-huit ans que le soin deviendrait une part de son métier, elle en aurait sans doute ri. Et pourtant, plus de vingt ans plus tard, me voilà à écrire sur la salle d’attente… qui ressemble, malgré moi, il me semble à un mauvais vaudeville.
Acte I — La scène du soin
En 2010, je suis entrée dans le monde de la psychothérapie institutionnelle. Mes premiers pas ont consisté à m’asseoir dans une salle d’attente pour y étudier le soin. Dans les institutions de soin, la salle d’attente est un personnage à part entière. Elle prépare, elle temporise, elle contient. Les corps s’y déposent, les pensées s’y ajustent, les angoisses s’y apprivoisent. Elle précède la scène clinique comme un lever de rideau silencieux :
Je me souviens d’un de mes premiers terrains. J’arrive dans un bâtiment qui appartient à la mairie de Paris. Un tableau m’indique que l’hôpital de jour est au quatrième étage. Je prends l’ascenseur, je sonne. On vient m’ouvrir. On m’informe que la direction est dans son bureau, on me demande d’attendre dans une grande salle ouverte, un espace qui fait le lien entre la cuisine, les salles de groupe et les bureaux administratifs.
Il est 17h30. Je comprends que les activités avec les enfants ont commencé. Je vois un adulte sortir d’une salle, refermer la porte à clef.
Quelques minutes plus tard, il ré-ouvre : un enfant tente de s’échapper, il le retient, entre de nouveau, et j’entends la serrure se refermer, enfermant à l’intérieur les occupants. Dans une autre salle, un autre adulte essaye de sortir, mais cette fois, l’enfant est plus rapide. Il s’échappe. (Turlais, 2016)
Scène brève, anodine peut-être, mais qui dit déjà tout : la tension entre le dedans et le dehors, le contrôle et la liberté, le soin et l’enfermement. Ici, la salle d’attente n’est pas seulement un lieu d’attente : elle devient une scène, un espace de passage, d’observation, de confrontation. C’est là que j’ai commencé à comprendre que, dans le soin institutionnel, le moindre geste : ouvrir, fermer, attendre, retenir, fait partie du texte. L’attente est pensée comme un espace réel, mais non physique : un lieu d’adresse, une temporalité symbolique qui autorise la rencontre. Une salle d’attente n’a pas besoin de murs : il suffit qu’elle soit pensée, instituée, hospitalière. Elle marque le passage du fonctionnel au relationnel, du protocole au soin. Elle donne forme à ce que l’on appelle, dans le lexique institutionnel, le travail du tiers — celui qui prépare, qui lie, qui met du sens là où le dispositif administratif, lui, ne fait que séquencer.
Acte II — Le vaudeville du social
En 2019, je commence une recherche sur les mesures en attentes en AEMO. L’attente, ici, n’est pas pensée : elle est subie. En protection de l’enfance, ce tiers a disparu. Pas de scène, pas de décor, pas de rideau. Juste un couloir où circulent des décisions orphelines. Le juge rend son ordonnance : rideau ouvert. Le service reçoit le texte, mais n’a pas encore trouvé son acteur principal. L’éducateur tarde à entrer, faute de décor ou de souffle. L’enfant, lui, grandit hors champ.
Je feuillette les entretiens de mon enquête, et les voix surgissent comme des répliques éparses.
Des bribes de théâtre administratif. Penchée sur mes notes (Turlais,2021), je me découvre dramaturge malgré moi.
Le juge : « C’est quand même problématique… On ordonne une mesure, mais on sait qu’elle ne sera pas mise en œuvre avant huit mois. »
L’éducateur : « Quand j’arrive un an après, les parents sont épuisés. Ils ont composé seuls avec leurs difficultés. Et nous, on entre comme si de rien n’était : bonjour, on va commencer le travail éducatif… »
Le parent : « Ce n’est pas maintenant qu’il faut s’occuper de moi, c’était avant ! Aujourd’hui, c’est trop tard. »
Le juge encore : « On en vient parfois à des décisions de placement qu’on n’aurait pas prises s’il n’y avait pas eu tant d’attente. »
L’éducateur : « La protection de l’enfance, parfois, perd tout son sens. Qui protège-t-on vraiment quand on laisse des enfants en danger faute de bras ? »
Chacun parle dans son temps. Personne ne répond à l’autre. Les dialogues deviennent monologues parallèles. Le théâtre du social tourne à vide : les acteurs se croisent sans se rencontrer. La salle d’attente, ici, est virtuelle, sans lieu, sans scène. C’est un vide institutionnel où se dissout la légitimité du soin et de protection. Le juge perd la crédibilité de sa parole, l’éducateur celle de son acte, le parent celle de sa confiance. Le public : les enfants, restent seuls devant un rideau fermé. Je relis mes notes et j’ai la sensation d’assister à une répétition sans fin. Un vaudeville tragique, où chaque personnage joue juste, mais dans une pièce désaccordée.
Acte III — La scène manquante
Dans la recherche sur les mesures en attente, les voix se sont entremêlées : celle du juge, inquiet de sa légitimité ; celle de l’éducateur, désolé d’arriver trop tard ; celle du parent, épuisé d’attendre un lien qui ne vient pas. Tous disaient, sans le nommer : il manque une scène.
Les personnages du rapport se sont tus, mais leurs ombres demeurent. Alors, en dramaturge malgré moi, je me mets à imaginer leurs voix. Je rêve les dialogues qui manquent à la pièce :
L’éducatrice, d’abord, dans un murmure fatigué : « Et si on commençait avant la rencontre ? Si on imaginait un lieu pour préparer le lien, un espace où le parent pourrait comprendre, attendre, respirer ? »
Le chef de service, penché sur ses plannings : « L’attente, on ne la supprimera pas. Mais on peut la penser, l’habiter. Ce temps pourrait être un temps de lien plutôt qu’un vide administratif. »
Une psychologue, attentive, ajoute : « Peut-être qu’il faudrait une place intermédiaire,pas encore la mesure, pas encore le travail éducatif, un lieu de pré-rencontre, une salle d’attente symbolique où le lien, le soin commence à se tisser. »
Je les entends, alors j’écris. Je les fais parler comme on place des chaises sur une scène encore nue.
Et peu à peu, une forme apparaît : celle d’un théâtre institutionnel réinventé, où l’attente devient un acte de soin. Ce troisième acte n’existe pas encore dans les pratiques, mais il existe déjà dans l’écriture, comme une hypothèse vivante, une manière de dire : nous pourrions faire autrement. Penser la salle d’attente du social, ce serait créer un espace de pré-rencontre, où l’on traduit la décision du juge, où l’on accompagne l’effroi du parent, où l’on prépare la venue de l’éducateur. Un lieu pour réintroduire du symbolique dans le temps.
Alors oui, je mets en scène ce qui n’a pas eu lieu. J’invente les dialogues qui manquent pour que l’institution retrouve sa voix. Et peut-être que dans cette fiction, plus vraie que le réel, se rejoue enfin le cœur du soin : celui d’attendre avec, et non sans.
Épilogue — Ce qui se joue hors scène
À force de traverser ces interstices, je crois que le cœur du travail social se joue justement là : dans les marges, les attentes, les lieux non pensés. C’est dans ce vide que se loge la possibilité du soin, ou son effacement. Le soin institutionnel nous enseigne que penser la scène, c’est déjà soigner. Ne pas la penser, c’est laisser l’acte social se dissoudre dans l’ombre des procédures. Alors, si j’écris encore, c’est pour rejouer la pièce autrement : donner à voir la salle d’attente comme un espace de scène partagée, où le temps redevient vivant, où l’institution réapprend à accueillir, et où le rideau peut enfin se lever : lentement, ensemble.
Bibliographie :
Turlais, A. (2016). Pratiques psychothérapeutiques et protection de l’enfant : la décision difficile d’engager un processus de séparation. Approches plurielles du processus décisionnel au sein d’une unité de psychothérapie infantile [Thèse de doctorat, Université Paris Nanterre].
Turlais, A. (2021). Les effets de l’attente lors d’une intervention d’Aide Éducative en Milieu Ouvert (AEMO). Rapport de recherche-action. La Sauvegarde de Seine-Saint-Denis, avec la participation de l’AVVEJ et de Jean Cotxet.
Turlais, A. (2017). Pour une production de connaissances scientifiques mobilisables dans la pratique de terrain : quels types de dynamiques relationnelles entre chercheurs et praticiens ? Éducation et socialisation, (45). https://doi.org/10.4000/edso.2616