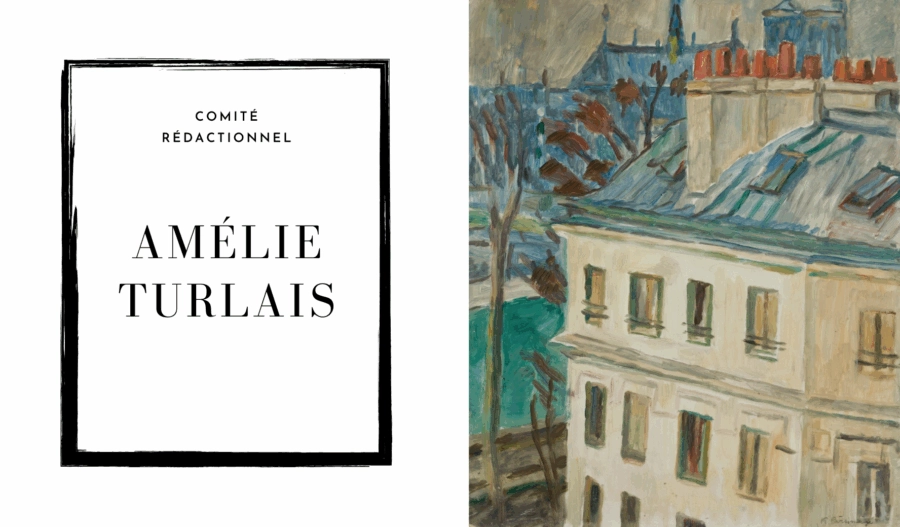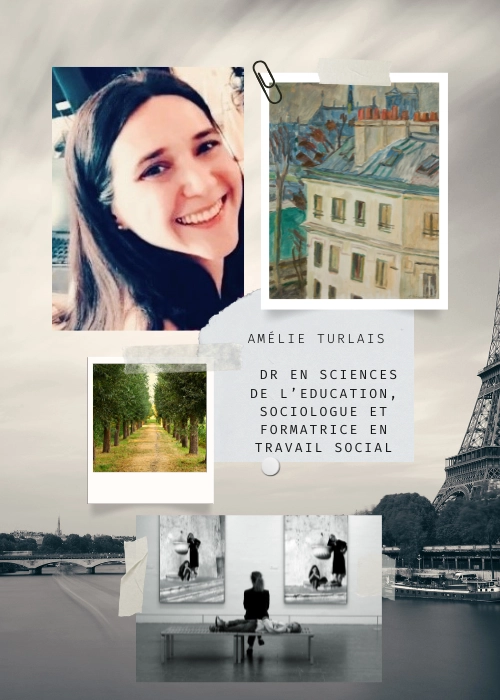Pourtant, que ce soit à partir de mes lectures bourdieusiennes (Bourdieu, 1979, 1993) sur le déterminisme social, ou de mes confrontations à l’individualisme méthodologique de Boudon (1973,2007), j’avais l’impression que lors de mon temps passé sur les bancs de la fac, j’avais déjà noirci beaucoup, voire trop de pages sur cette thématique.
Qu’allais-je bien pouvoir partager avec vous chers lecteurs et chères lectrices ce mois-ci. J’avais dans ma tête différentes idées mais toutes étaient floues. Quand j’avais l’impression d’en saisir une, celle-ci s’évaporait.
J’ai alors mis en place mon rituel de lutte contre la page blanche : la marche méditative. Par chance, le soleil était présent ce jour-là, fait assez rare en ce mois de septembre. J’ai donc été arpenter, pendant plusieurs heures, les rues de Paris. Sans but précis, sans pensée construite.
De retour à mon domicile, j’ai pris une feuille et un stylo et pendant dix minutes sans lever le stylo de ma feuille, j’ai écrit tout ce qui me venait en tête. Dix minutes sans lever, ni poser le stylo, si vous n’en avez jamais fait l’expérience, je vous invite à essayer, vous verrez ça chauffe le poignet.
A la relecture de ce texte sans grand intérêt littéraire et sans réel fil conducteur, j’ai dégagé plusieurs réflexions sans au premier abord de lien, mais j’ai eu envie d’en partager une avec vous.
Quelques années passées, j’ai collaboré à un travail de recherche intitulé le Sens de l’Agitation chez l’Enfant, avec comme acronyme : SAGE (Beliard, et al., 2015) ! L’objectif central de cette recherche (n’oubliez pas je suis sociologue) était d’analyser les usages sociaux des catégories : « troubles ». Pour le dire autrement, de comprendre la manière dont parents, enfants et professionnels se saisissent d’une catégorie « psy » dans l’organisation et le parcours de vie de l’enfant.
Lors de la phase de collecte de données, j’étais en observation distanciée au sein d’une consultation pédopsychiatrique. Pendant plusieurs mois, une fois par semaine, j’ai eu l’opportunité d’assister aux consultations parents/enfants et de prendre le temps, à la fin des temps de consultations, d’échanger avec les parents. Précisons bien ici que parents et enfants ont toujours été informés des raisons de ma présence et ont eu le choix de l’accepter ou non.
Tout au long de ces mois, grâce à une prise de note intense, il m’a par la suite été possible de mettre à l’écrit une description du déroulement des séances, une explicitation et une analyse critique des outils utilisés par la pédopsychiatre pour construire un diagnostic.
Il m’a aussi été possible de mettre en lumière la place et le rôle qui était donné par le médecin aux parents et aux enfants dans les décisions à prendre par rapport au diagnostic et aux possibles prescriptions faites.
Sans être une experte sur les concepts de capacités, capabilités, pouvoir d’agir et empowerment, ce que moi j’avais beaucoup apprécié dans la pratique de ce médecin était sa manière d’exposer les faits et les possibilités de soins aux parents et aux enfants, pour les amener à choisir à partir de leurs attentes et de leurs pratiques parentales.
Arrivant des sciences de l’éducation, j’avais en tête les travaux de Kellerhals et Montandon (1992) et tout particulièrement le concept de pratique éducative démocratique. Je m’en sens proche dans mes pratiques de pédagogue. J’aime l’idée de construire à partir des besoins et des envies de chacun, sans qu’un détenteur d’une autorité descendante impose sa propre vision. Alors, ce médecin qui présentait la palette de soins possibles aux parents et aux enfants pour qu’ils soient acteurs dans ces décisions, ça m’a tout de suite emballée.
Mais comme toujours, ce sont les concernés : parents et enfants, qui m’ont conduit à remettre en question mes idées et ma pensée. A la fin d’une consultation, une mère me parle. Sa voix résonne encore en moi comme égarée.
J’ai l’impression qu’elle est peut-être plus perdue à la fin de la consultation qu’au tout début. Je comprends que quelque chose m’échappe. Peut-être a-t-elle vu, à son tour dans mes yeux, dans mon corps, ma confusion ; en tout cas elle me dira dans ces termes à peu près :
« Vous comprenez nous ne sommes pas médecin, nous n’avons pas fait d’études pour tout bien comprendre ce qui arrive à notre enfant, alors quand on nous demande ce qu’on pense être le mieux pour lui, nous nous ne savons. C’est pour ça qu’on vient voir un médecin, parce que lui il sait, lui il peut dire ce qu’il faut faire. »
Je me souviens bien de cette journée, de cet échange, des mots de cette mère, je les ai cogités pendant de longues soirées. Ce n’est pas anodin, si sur la thématique du mois, j’ai eu envie de la partager avec vous. Se voir donner le choix, avoir la possibilité de participer au processus de décision a toujours été pour moi une étape vers la liberté de chacun et chacune.
Pouvoir choisir, pouvoir décider c’est pour moi se défaire, se libérer des chaînes de notre origine sociale et culturelle. Pourtant, aux paroles de cette maman, j’ai pris pleinement conscience que nous n’avions pas toutes et tous la capacité de faire un choix pour ensuite le porter, et l’assumer.
Le partage de cette réalisation me conduira certainement une autre fois à vous partager les raisons pour lesquelles j’ai une croyance inconditionnelle en la recherche, ou au tout du moins en la méthodologique de la recherche scientifique.
Bibliographie
- Béliard, A., Borelle, C., Eideliman, J.S., Fansten, M., Mougel, S., Planche, M., Tibi-Lévy, Y., Stettinger, V., Turlais, A. (2015). Les sens de l’agitation chez l’enfant. Parcours individuels, dynamiques familiales, pratiques professionnelles. Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP), AAR 2015 “ Handicap et Perte d’autonomie ”
- Boudon, R. (1973). L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles. Paris : Armand Colin.
- Boudon, R., (2007). Essai sur la théorie générale de la rationalité. Paris : Presses Universitaires de France.
- Bourdieu, P. (1979). La distinction : Critique sociale du jugement. Paris : Éditions de Minuit.
- Bourdieu, P. (1993). (Dir.). La misère du monde. Paris : Éditions du Seuil.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de septembre 2024