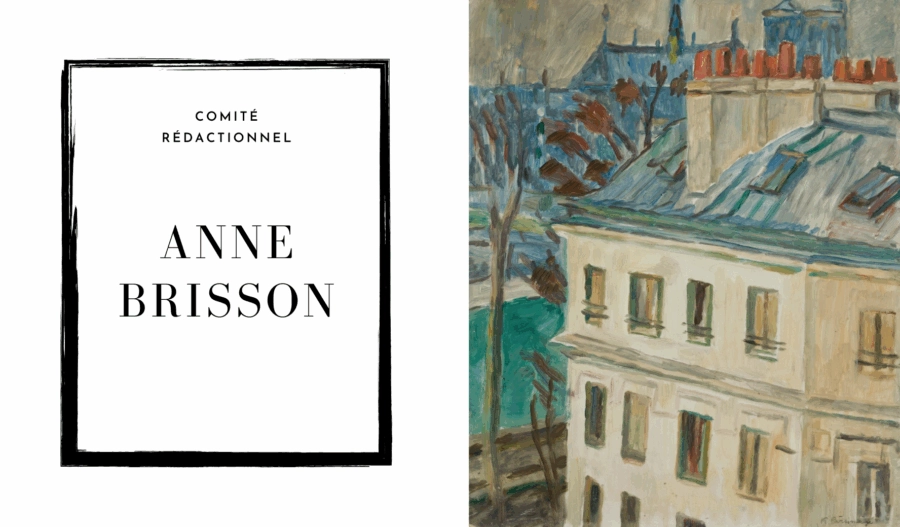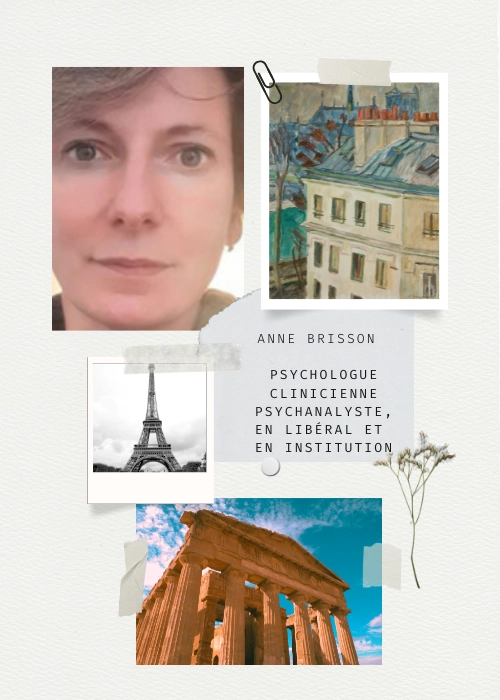Il me semble que le premier rythme vivant est celui du cœur, celui que l’on entend à l’échographie et qui confirme le début de la création d’un nouvel être. Le rythme cardiaque est le grand témoin de l’existence humaine.
Cela me fait penser au travail de Christian Boltanski, en particulier à deux œuvres qui s’intéressent à ce rythme qui témoigne aussi bien de la vie que de son déroulement jusqu’à la mort.
« Le cœur » est une installation qui plonge le visiteur dans la pénombre où il découvre une lampe qui s’allume et s’éteint au son du battement du cœur de l’artiste.
Depuis 2005, Boltanski a lancé une collecte d’enregistrements de battements de cœur à travers le monde. « Les archives du cœur » sont conservées, depuis 2010, à l’abri du temps qui passe dans l’île japonaise de Teshima, dans la mer intérieure de Seto, mise à disposition par un mécène.
Bravant la fuite du temps et le bruit des foules d’individus solitaires, ces archives tirent une multitude de personnes de l’anonymat par la force de l’évocation symbolique et artistique. Les enregistrements constituent une « petite mémoire » de la singularité fragile de chacun à la différence de la grande mémoire conservée dans les livres.
Je commence à écrire sur le rythme dans un café qui diffuse à tue-tête « Bad Girls » de Donna Summer, le genre de musique et de pulsations que ton corps ne peut ignorer très longtemps et, donc, je danse (discrètement) sur ma chaise et devant mon ordinateur.
Pour me justifier de travailler de cette façon, j’invoque Platon[1], ce penseur antique qui a décrit le rythme comme « un principe d’ordre » et l’a mis au cœur de la formation éthique et de l’éducation de l’âme.
Il considère le rythme et l’harmonie comme des puissances capables de façonner l’âme en profondeur. Il estime que le rythme, parce qu’il est la division régulière de la durée sensible, touche le fond de l’âme et instaure un ordre perceptible.
L’éducation musicale est « souveraine » car elle structure la sensibilité, permet l’expression ordonnée des émotions et prépare l’âme à accueillir tout ce qui est lié à la raison. L’enfant ne commence pas par raisonner, mais par ressentir et aimer : le rythme dans la musique et la danse constituent ainsi le socle de la formation intellectuelle.
L’intervention du rythme, considéré comme ce qui organise le mouvement, fait passer l’individu du désordre de l’enfance à un état plus harmonieux. Parce qu’il s’intéresse à ses effets organisateurs, Platon désigne le bercement comme un rythme qui possède des pouvoirs apaisants et régulateurs sur l’âme et le corps, parce que le mouvement régulé est un remède à l’agitation.
Ainsi il décrit le bercement comme une technique thérapeutique utile pour les enfants, mais aussi pour les malades ou les « esprits troublés ». Précurseur des théoriciens du développement psychomoteur, affectif et cognitif de l’enfant, Platon explique comment le bercement, par son rythme répétitif, prépare l’âme à la réception de l’harmonie et favorise la transformation du désordre intérieur à l’ordre.
Le rythme éprouvé par le corps est le socle d’un développement psychique équilibré. Il existe d’ailleurs dans l’œuvre de Platon un personnage qui incarne parfaitement le modèle idéal de l’adulte sécure pour un enfant : il ne s’agit pas d’une mère ou d’un père, mais d’une femme qui nourrit, soigne, berce, veille et élève l’enfant au quotidien. La « trophos » (qui se distingue de la nourrice, du pédagogue et de toute autre figure éducative) veille à calmer l’agitation de l’enfant par la combinaison du bercement, du mouvement et du chant. Elle apporte une stabilité affective essentielle à la croissance de l’enfant, et l’accompagne parfois jusqu’à l’âge adulte en gardant un lien privilégié avec lui.
Quand on lit ensuite Daniel Stern[2], il nous paraît étonnamment proche de Platon. Ses travaux sur le rythme dans les interactions mettent en avant le caractère musical, fluctuant et expressif des échanges précoces, notamment entre la mère et le bébé, et lui donne un rôle fondamental dans le développement de l’intersubjectivité et du sentiment d’être soi.
Les interactions précoces entre un bébé et un adulte sont comme des « proto-conversations » pendant lesquelles la synchronisation rythmique (variations, pauses et reprises) façonne la relation.
Stern compare les interactions à un duo d’improvisation musicale, dans lequel le dialogue est organisé par les ajustements du rythme, de l’intensité et de la forme expressive du comportement. La notion d’accordage affectif désigne la capacité des partenaires à s’ajuster mutuellement sur le plan rythmique et expressif, favorisant la résonance émotionnelle.
Cette coordination se fait parfois avec des irrégularités, des syncopations[3] et des réparations dans le flux des échanges. Stern a été l’un des premiers à associer la dimension rythmique à la notion d’« affects de vitalité » qui se distinguent des émotions catégorielles comme la joie ou la tristesse.
Les affects de vitalité sont des expériences sensibles et dynamiques liées à la manière dont les états internes se modifient en durée, intensité et forme. Stern explique que ces affects sont perçus très tôt chez le nourrisson et lui permettent de faire la différence entre l’animé et l’inanimé, de ressentir l’énergie, les aspects toniques ou doux d’une interaction, bien avant de pouvoir penser puis nommer des émotions précises.
Ainsi, la vitalité s’exprime par des formes dynamiques diversifiées (mouvement, force, rythme et variation) qui colorent toutes les expériences subjectives, qui imprègnent les relations et qui permettent au bébé d’éprouver la continuité du lien et l’émergence du soi.
La théorie du rythme de Daniel Stern a de nombreuses applications cliniques, auprès des bébés, des adultes et des personnes vieillissantes, car le rythme concerne tous les âges de la vie : elle permet de mieux comprendre et de transformer l’accordage affectif entre le bébé et ses parents ; elle donne au clinicien la capacité de saisir et de moduler les rythmes émotionnels implicites dans la séance, pour restaurer ou réinventer des capacités relationnelles fragilisées avec les adultes ; elle favorise la communication non verbale chez le sujet âgé souffrant de troubles cognitifs, grâce à l’utilisation de stimulations rythmiques (musique, mouvements et rituels).
Avec Platon et Stern, nous avons là un plaidoyer formidable pour les effets thérapeutiques du rythme, à la fois vivant et créatif, efficace tout au long de la vie, de la naissance jusqu’à la mort ! Mais que dire des rythmes qui n’ont pas les mêmes effets positifs et dynamiques ?
Me vient en tête la théorie des procédés autocalmants de Gérard Szwec[4]. Il décrit les « galériens volontaires », ces personnes qui rament, courent, nagent jusqu’aux limites de leurs forces, non pas poussés par le goût de l’aventure et la quête de l’exploit, mais par la contrainte de répétition automatique d’un comportement à l’identique.
Ils cherchent à apaiser une excitation qui déborde leurs défenses psychiques par le recours à une autre excitation motrice ou sensorielle. Les procédés autocalmants utilisent le corps, le mouvement et la perception, sous la forme de gestes ou d’actions rythmées et stéréotypées pour retrouver une forme de calme temporaire.
Dans ces conduites répétitives, le rythme occupe une place centrale car il engendre une régularité sensorielle qui tente de contenir l’excitation ou l’angoisse et qui offre un dérivatif à la pensée, pour empêcher la montée de la tension traumatique ou anxieuse.
Au moyen du rythme invariable, la régularité procure une accalmie tant que le procédé se poursuit, c’est pour cela qu’il fait l’objet d’une tendance à la répétition infinie et c’est ce que l’on appelle « la contrainte de répétition ».
Malheureusement, cette régularité n’offre aucune satisfaction durable. Le rythme des procédés autocalmants donne une structure temporelle à l’expérience émotionnelle, ainsi que des limites à l’envahissement et aux effets de sidération, mais c’est au détriment d’un travail psychique car il annule les ébauches de liaison dans l’activité représentative concernant le trauma.
Ainsi le rythme peut devenir soutien ou empêchement de la pensée, bâtisseur psychique ou répétition à vide, selon ses variations ou sa monotonie, selon qu’il touche l’individu seul ou bien les interactions. Dans le fond, en dehors des galériens volontaires qui sont souvent solitaires avec leur cadence répétitive, le rythme a essentiellement une dimension relationnelle.
Depuis le fœtus qui entend le rythme cardiaque de sa mère en même temps que le sien, un rythme est l’évocation d’un autre. C’est ce que décrit très finement l’écrivaine Chantal Thomas dans son livre Journal de nage[5] : « Je commence ma saison des bains avec la plage fréquentée par ma mère. Avec elle, donc. Avec son corps de jeune fille, la rapidité de ses gestes, sa spontanéité. Elle me pousse à écrire plus vite, d’un seul jet. A me jeter dans le langage comme elle se jetait dans l’eau ».
Le rythme est le premier outil du bébé pour découvrir le monde, puis dans l’écriture, la mémoire et le mouvement, il relie le passé au présent et fait œuvre de transmission.
Le clapotis des vagues s’atténue, c’est la rentrée : renoncer au rythme de l’été, reprendre le rythme de la vie professionnelle, inventer un autre rythme ? Mon cœur balance… et cherche le bon rythme !
[1] Platon, Les Lois (livre VII), traduction et édition de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, 2006, Flammarion.
[2] Daniel Stern, Le Monde interpersonnel du nourrisson, 1989, Puf.
[3] La syncopation est une déformation rythmique qui place l’emphase sur les temps faibles plutôt que sur les temps forts.
[4] Gérard Szwzec, Les galériens volontaires, 1998, Puf.
[5] Chantal Thomas, Le journal de nage, 2022, Seuil.