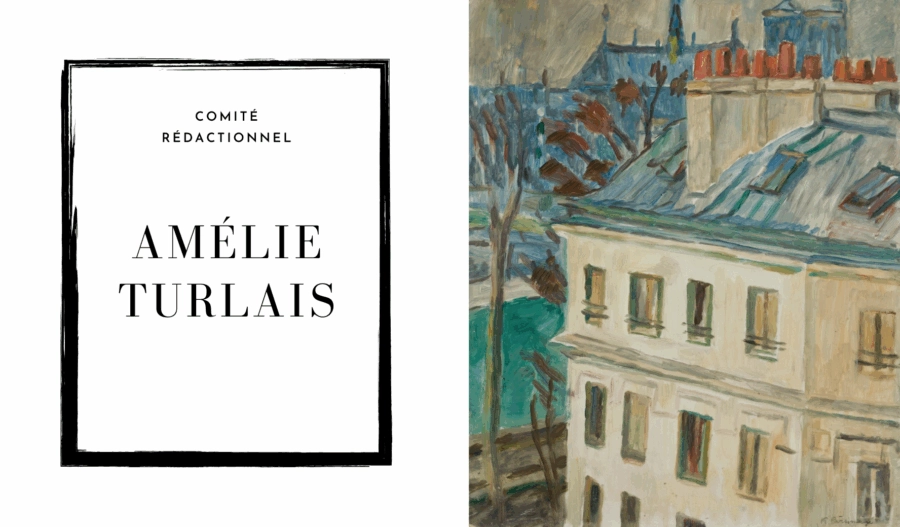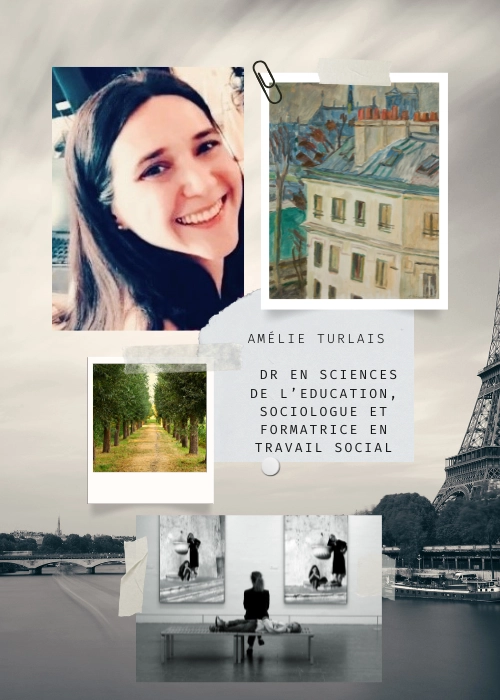Elle représente plus une fête de la consommation, mais je m’égare… donc pour ces fêtes de fin d’année, d’hiver, de Noël…, pour ces vacances qui approchent à grands pas, avec le comité de rédaction, nous avons fait le choix de mettre en avant des activités, lectures qui pourraient occuper vos journées dans la ville ou au coin du feu.
Personnellement, j’ai décidé de partager avec vous l’exposition photo de Tina Barney, qui est au Jeu de Paume jusqu’à la fin du mois de janvier.
L’affiche promotionnelle : une photo de famille sur laquelle une jeune femme porte autour du cou un vrai boa m’a fascinée et donné envie de découvrir l’univers de cette artiste.
Pour me rendre au Jeu de Paume, dans le jardin des Tuileries, j’ai pris la ligne de métro 12. En sortant du sous-terrain métropolitain, j’ai été plongée dans le monde féérique qui lors de ma première venue à Paris, à 5 ans m’avait rendue amoureuse de cette ville. La Concorde et la Tour Eiffel avaient l’air de prendre le thé, autour d’une table qui n’était autre que l’Assemblée Nationale.
Peut-être est-ce parce que sur cette même période du mois de décembre, je suis allée voir deux concerts des films de Tim Burton : un premier, au MPAA, à Saint-Germain-des-Près, avec un quartette puis un second au Zenith avec un orchestre philharmonique, et au chant : Danny Elfman, l’auteur des musiques des films de Tim Burton ; qu’en voyant la dame de fer et la pharaonique colonne, je me suis sentie Alice qui pour un après-midi plongeait dans un monde merveilleux. Je me voyais déjà faire le chemin inverse d’Alice : me replonger dans un monde enfantin, quitter pour un bref instant ma vie adulte.
N’est-ce pas pour cela que nous aimons les activités culturelles, lire pour découvrir l’ailleurs, écouter la musique pour se laisser emporter vers d’autres cieux, danser pour que le corps nous transporte hors de notre esprit ?
Mais, parfois, souvent, toujours, la culture nous rappelle aussi qu’elle a une dimension sociale, qu’elle revêt un caractère sociologique, qu’elle donne à voir notre monde comme nous aurions préféré le refouler. Alors oui en me rendant à l’exposition de Tina Barney, j’ai fait le chemin inverse, je me suis replongée dans un monde normé qui de loin avait bercé mon enfance.
L’exposition présente un travail photographique de 40 ans. Tina Barney a photographié, des années quatre-vingts à nos jours, le monde auquel elle appartient. Certaines photos sont celles de sa famille, de sa sœur, d’elle-même. Au fil du temps, les personnes qui étaient enfants sur les premières photos sont devenues des épouses, des époux, ont eu des enfants, voire des petits enfants. Elle présente son travail comme plaçant la focale sur la Famille, les positions de chacun et chacune. D’une photo à l’autre, on distingue les relations de pouvoirs : qui est assis sur le fauteuil Louis XV ? (enfin ce qui ressemble à un fauteuil Louis XV dans mon imagination), qui est en arrière-plan ?, qui est certes sur la photo, mais dont l’image est floue ? En adoptant un regard de sociologue on pourrait repérer les rôles normés de chacun et chacun.e : des hommes qui lisent les journaux pendant le temps du déjeune r; une femme qui porte le bébé ; un homme assis, sa femme debout derrière lui.
Qu’est-ce que j’éprouve en regardant ces photos ? Je suis perplexe, je ne sais pas quoi en penser. L’art doit-il nous amener à penser, à réfléchir ?
Peut-être pas, quand j’arpente les musées, moi ce qui m’intéresse ce n’est pas d’étudier d’où vient la lumière, ce que l’artiste veut dire, mais ce que j’éprouve. Sur les quatre premières photos, je sens bien qu’elles réveillent quelque chose de la petite fille que j’ai été.
Je continue, maintenant je vois des enfants, des jeunes adolescentes. Je suis troublée, Tina Barney fige l’instant, les regards sont vides, parfois je vois les photographié.es comme des statues et en même temps j’ai l’impression de les entendre hurler pour que je vienne les libérer du carcan familial dans lequel elles sont enfermées.
Je pense alors à Alice et son pays des merveilles, courir, toujours courir, fuit-elle, cherche-t-elle son chemin ?
Deux adolescentes en maillot de bain sur un plongeoir, collées l’une à l’autre, elles posent pour la photo, sans extravagance, une pose naturelle, mais qui reste travaillée.
Vraiment comme Alice, je suis perdue, les émotions, les éprouvés s’entrechoquent à chaque photo. Tout va trop vite pour que j’arrive à y faire sens. Alors, je sors de mon intériorité pour écouter les conversations autour.
Les hommes… j’ai l’impression qu’ils voudraient être ailleurs, les femmes sont plongées dans la lecture du fascicule de l’exposition. J’entends : « Attends, je vais te montrer une photo », un mari sort son téléphone. « Tu vois c’est une photo de ma famille, il suffit que je l’imprime en grand et je pourrais être dans l’expo » affirme-t-il au mari numéro 2. Tous deux rigolent.
Plus loin, une guide du musée a fait s’asseoir un groupe de 5/6 enfants de 7/8 ans. Elle les questionne sur la photo : « Est-ce que la chambre de la photo, elle semble être la chambre de tout le monde ? » Quelques voix émettent des « oui », des « non », des « C’est en bazar », « Elle est grande ». La guide récupère la parole et se lance dans une explication sur le rayon de lumière qui place la focale sur le placard : « L’artiste : Tina Barney a mis un gros rétroprojecteur pour mettre le placard en évidence ». Oh là là, les hommes sont à leur place d’homme, ils ont accompagné leurs épouses à l’expo. Les enfants de 7/8 ans sont en train d’être éduqués à l’analyse objective des travaux d’art. Je me sentirais presque oppressée.
Et la subjectivité dans tout cela. Comme dans les photos de Tina Barney, elle me semble absente. Tina Barney s’est défendue de ne pas photographier la noblesse, la bourgeoisie américaine et européenne. Pourtant, elle photographie des familles qui sont des dynasties, ou chacun et chacune appartient à une lignée. Peut-être ne vivent-ils pas dans un château, emblème de la noblesse (Pinçon et Pinçon-Charlot, 2016), mais l’intérieur des maisons à ce côté ostentatoire des meubles parés d’or qui brillent et qui en imposent.
Je continue ma déambulation, et je m’arrête sur une photo, une jeune fille de 15/16 ans, jean, pull rayé blanc et rouge, elle pourrait faire la pub pour Ralph Lauren. Je ne sais pas si je bloque sur cette photo parce que je me revois, ou que je vois celle que certain.es auraient aimé que je sois dans ma jeunesse. Je repense à la parole d’un enfant quand j’étais soignante en hôpital de jour, même si cela fait plus de dix ans, elle est restée gravée dans ma mémoire : « « Et toi, la petite bourgeoise »… et il avait certainement du finir par un « ta gueule ».
Je ne sais pas si j’aime cette exposition, mais vraiment elle ne me laisse pas indifférente.
Quelques pas, je m’arrête de nouveau longuement devant une autre photo. Cette fois, la jeune femme est dans l’espace public, allongée, nue dans une baignoire, un piercing au sein droit, un tatouage sur le sein gauche et un autre sur le flanc droit. Toujours, ce regard vide et pourtant qui semble dire tellement. Là aussi je crois que je m’identifie. Je n’ai pas été cette jeune fille rangée au pull rayé rouge et blanc, mais suis-je devenue cette femme qui a bravé certains diktats en parant son corps de tatouages ? Les tatouages longtemps cela a été un signe d’appartenance à un clan ; maintenant est-ce qu’ils permettent d’exprimer sa singularité ? Je n’ai pas de réponse à ces questions, cependant devant cette photo j’imagine que cette jeune femme par cette réappropriation de son corps a voulu mettre à distance les attentes que sa famille bourgeoise avait pour elle.
L’exposition touche à sa fin, je ne mettais pas trompée, j’ai bien fait le chemin inverse d’Alice, je me suis plongée dans un Nouveau Monde, qui aurait pu être le mien. De cette visite, j’ai retracé mon histoire, repensé à mes choix de vie, à ces moments de bifurcation. Voilà pourquoi, j’aime tant l’art et la culture ; parce que personnellement cela me transporte, m’éclaire et me fait réfléchir. Je suis pressée de parler de cette exposition avec mes proches, de les entendre me dire que cela semblait bien loufoque, de pouvoir partir de certaines photos des photos que j’ai prises pour échanger avec les étudiant.es sur ce que l’on transmet et comment on transmet les choses aux enfants et à notre entourage. Je sais que pousser les portes des musées, ce n’est pas simple que cela dépend de notre éducation familiale, de nos codes sociaux ; pourtant je suis persuadée que nous, soignants, formateurs, éducateurs nous pouvons permettre à certain-es qui n’oseraient pas faire le grand saut, d’au moins faire le premier pas vers ce Nouveau Monde qui ouvre à l’introspection et à l’imaginaire.
Bibliographie
Pinçon, M. et Pinçon-Charlot, M. (2016) . II. Noblesse et bourgeoisie : les enjeux du temps. Sociologie de la bourgeoisie. ( p. 27 -45 ). La Découverte.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de décembre 2024