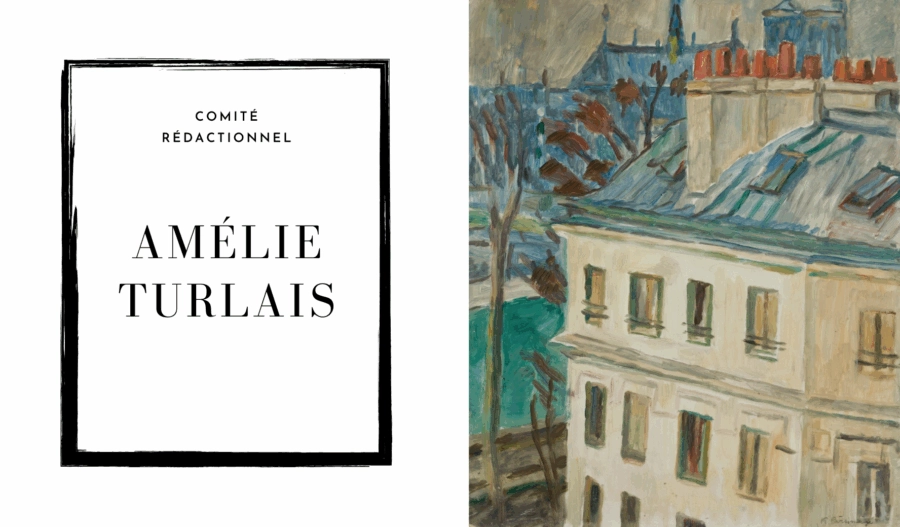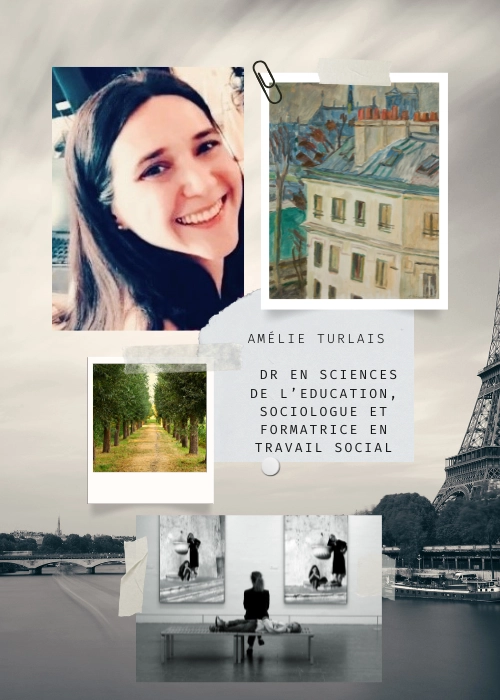Dès la lecture du programme, j’étais impatiente de découvrir le travail de l’équipe du Babylab coordonnée par Erika Parlato, et de me plonger dans les échanges avec les participant·es et des penseurs comme Bernard Golse, et Catherine Peyrot. Une présentation en particulier avait retenu mon attention : celle de Thierry Laffont consacrée à l’intentionnalité de danser chez les bébés.
La danse, voyez-vous, exerce sur moi un pouvoir singulier : celui de faire disparaître le monde alentour, de suspendre le temps. En tant que spectatrice, mon corps vibre, mon esprit s’apaise, se rend disponible, sans autre intention que de ressentir, se laisser traverser, se laisser porter. Des débats, autour de la danse – avec des ami·es danseur·ses, des passionné·es, des curieux·ses – sur la danse performative, la danse libératoire, j’en ai des souvenirs plein la tête.
Nombreuses sont les fois où je me suis interrogée : qu’est-ce que cela veut dire, « danser » ? Peut-on danser sans intention ? Ce 23 juin, ces questions ont trouvé un nouvel écho. J’ai repensé à toutes ces discussions où l’on me demandait : « Il voulait dire quoi, le chorégraphe ? » ou « Tu as compris quoi, toi, de cette représentation ? » Et mes réponses, qui tantôt déroutent, tantôt résonnent : « Je ne sais pas ce que le chorégraphe voulait transmettre. La seule chose dont je peux parler, c’est ce que j’ai ressenti. »
Et c’est peut-être là que cette journée m’a touchée le plus profondément : dans cette manière de rappeler que le mouvement, avant d’être performance, avant d’être art, est un langage. Un langage premier, brut, immédiat – que les bébés mobilisent bien avant les mots.
Je voudrais vous partager ici un de mes moments marquants de la journée, celui de la projection d’une vidéo issue de la pouponnière Lóczy, emblématique de l’approche d’Emmi Pikler. On y voit une travailleuse sociale habiller un bébé. Rien d’extraordinaire en apparence, et pourtant… tout y est.
Le geste n’est jamais précipité. Il suit un tempo singulier, doux, harmonieux. De droite à gauche, de bas en haut, les mouvements dessinent une chorégraphie du soin. Le regard est attentif, les mains annoncent, enveloppent, soutiennent. Le corps de l’adulte semble se faire guide, mais un guide discret, qui laisse place à l’autre. Et l’autre, ici, c’est ce tout-petit qui, dans la répétition de ce ballet quotidien, devient peu à peu partenaire. Le bébé entre dans la danse : il accompagne, propose, module.
Il devient sujet du rythme, créateur de nuances, capable d’imprimer une variation que la professionnelle capte, accueille, prolonge.
La professionnelle n’est plus dans un « faire à », « faire pour » mais un « faire avec ». Cette séquence donne à voir, au-delà du soin lui-même, l’émergence d’un langage partagé. Le mouvement devient médium de relation, d’ajustement, de reconnaissance mutuelle. Une forme d’intersubjectivité incarnée, bien avant les mots.
Un battement de doigt, un regard tourné, un balancement du corps : autant de gestes minuscules que nous, adultes, avons appris à ignorer ou à interpréter trop vite. Peut-être oublions-nous trop souvent que ces mouvements sont déjà porteurs de sens, de volonté, de lien. Pourtant, ne sont-ils pas une façon pour le tout-petit et le plus grand de dire je suis là, je te vois, je veux.
Cette journée m’a rappelé, que le mouvement précède la parole, qu’il crée de la relation, et qu’il parle peut-être plus fort encore que nos discours bien ficelés. Cela m’a interrogée sur nos manières d’entrer en relation dans nos métiers du soin, de l’éducation, de l’accompagnement.
Combien de fois oublions-nous que le corps parle, toujours, même en silence ? Que ce soit dans le bercement d’un bébé ou l’agitation d’un adolescent, dans le retrait d’un geste ou l’élan d’une main tendue, il y a des messages que seule une attention fine au mouvement permet d’entendre.
En quittant cette journée Babylab ce soir-là, je n’avais pas de réponses claires sur l’intentionnalité des bébés. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Mais j’avais avec moi cette sensation d’avoir été déplacée. D’avoir réappris à regarder autrement, à ralentir, à prêter attention à ce qui, d’ordinaire, échappe.
À ces gestes qui tissent du lien, à ces rythmes corporels qui précèdent les mots, à cette manière d’être ensemble par le mouvement, bien avant le langage articulé. Comprendre, apprendre, ré-apprendre – avec et par les bébés – la grammaire du geste, du regard, du rythme partagé.
Cette journée m’a rappelé que, dans nos métiers, il ne s’agirait pas seulement de « faire » ou de « dire ». Il s’agirait aussi – et peut-être d’abord – de sentir, de se laisser toucher, de se rendre disponible à l’inattendu de la relation.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de juin 2025