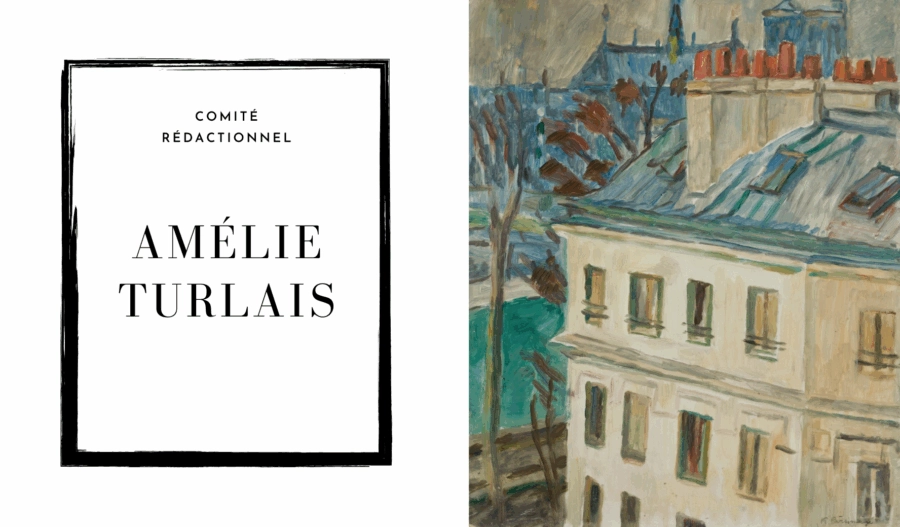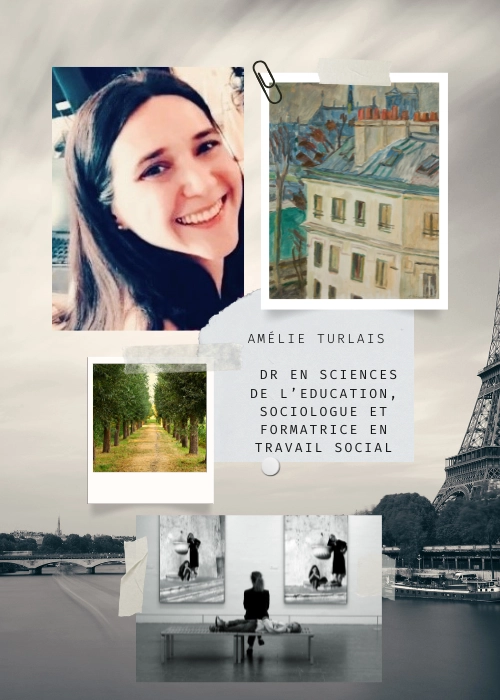Puis, j’entends résonner le métronome du piano de mon enfance, me rappelant avec insistance que l’échéance approche et qu’il est temps de m’asseoir pour écrire.
Je suis prise dans un tourbillon dansant, voyez-vous des pistes, je n’en manque pas. Je pourrais prendre l’angle du yoga pour les enfants, que j’ai la chance d’explorer en maternelle ; ou encore explorer le rythme de l’enfant lui-même, entre ses besoins, ses envies et ce que les adultes désirent pour ce dernier.
Mais cette valse d’idées me fait si vite tournoyer que je perds ma capacité à fixer une idée. Pourtant, en écrivant ces mots, certainement sous l’influence de travaux de recherche en cours – c’est un autre mouvement qui s’impose au rythme d’une partition dissonante, longuement étudiée dans mon travail de thèse, celui de la rencontre parfois heurtée entre soignants en santé mentale infantile et travailleurs sociaux en protection de l’enfance.
Sur quoi bute-t-on ? À coopérer, collaborer, élaborer ? Le choix du mot n’est pas anodin ; il condense déjà une part du nœud de cette difficulté. Peut-être pensez-vous que je m’éloigne de la thématique du rythme.
Pourtant, plus j’écris, plus je mesure combien la question des cadences et des temporalités partagées – ou dissonantes – en est le cœur battant.
Quand les travailleurs sociaux en protection de l’enfance parlent de « coopérer » pour mettre en place une mesure, les soignants, eux, préfèrent « élaborer » autour de la situation de l’enfant.
Deux tempos, deux respirations. Les soignants craignent parfois que le contact avec les services de protection n’altère la mélodie fragile du lien thérapeutique. Les travailleurs sociaux, eux, avancent souvent au rythme pressé des procédures, quand les soignants souhaitent ralentir pour laisser advenir la parole ou l’élaboration.
Deux temps, parfois incompatibles. À cela s’ajoute la polyrythmie des situations : un enfant aux difficultés multiples impose déjà une cadence exigeante, et la rencontre entre institutions vient redoubler la complexité.
Comment trouver un consensus quand l’un bat la mesure en pensant « protection », l’autre en pensant « soin » ? La réciprocité devient un exercice délicat : tantôt chacun se vit freiné, tantôt contraint d’accélérer.
Pourtant, il existe aussi des marges de liberté. Des interstices où le rythme cesse d’être imposé et devient négocié. Là, les désaccords se transforment parfois en contrepoints : la divergence ouvre un espace de pensée, un « pas de côté » qui permet de réentendre l’enfant autrement.
Car au fond, ce qui se joue, c’est moins une simple question de vocabulaire – coopérer, collaborer, élaborer – qu’une mise en musique des temporalités. Une danse hésitante où chacun cherche à ne pas écraser le pas de l’autre.
Et c’est peut-être là le véritable enjeu : parvenir à danser ensemble sans chercher à imposer sa mesure. Non pas aligner coûte que coûte, mais accepter les décalages, les reprises, les silences.
Le rythme, ce n’est pas seulement la régularité du métronome, c’est aussi la possibilité de respirer, d’improviser, de tenir compte des accents et des pauses.
Dans les pratiques cliniques comme dans l’intervention sociale, la question n’est donc pas seulement « que faire ? », mais « à quel tempo avancer ? ».
Les désaccords sont souvent vécus comme des obstacles, mais ils pourraient aussi être entendus comme des variations nécessaires. Permettre à chaque voix de se faire entendre et où l’ensemble de ces voix produit une harmonie – fragile, mouvante, mais réelle. Au bout du compte, c’est l’enfant qui nous ramène à l’essentiel.
Son rythme n’est ni celui des procédures ni celui des protocoles. Il est fait de tâtonnements, de jeux, de retards et d’élans. Le respecter, c’est accepter de ralentir quand il résiste, d’accélérer quand il s’élance, et surtout de ne jamais perdre de vue que c’est autour de lui que s’accorde – ou non – notre polyphonie institutionnelle.
Peut-être que le véritable art, pour les soignants comme pour les travailleurs sociaux, n’est pas de chercher à se mettre au même pas, mais de rester attentifs à ce qui se joue « à hauteur d’enfant ».
Là où chaque battement de cœur, chaque souffle, rappelle qu’avant toute coopération, collaboration ou élaboration, il s’agit avant tout d’accompagner une vie en devenir.