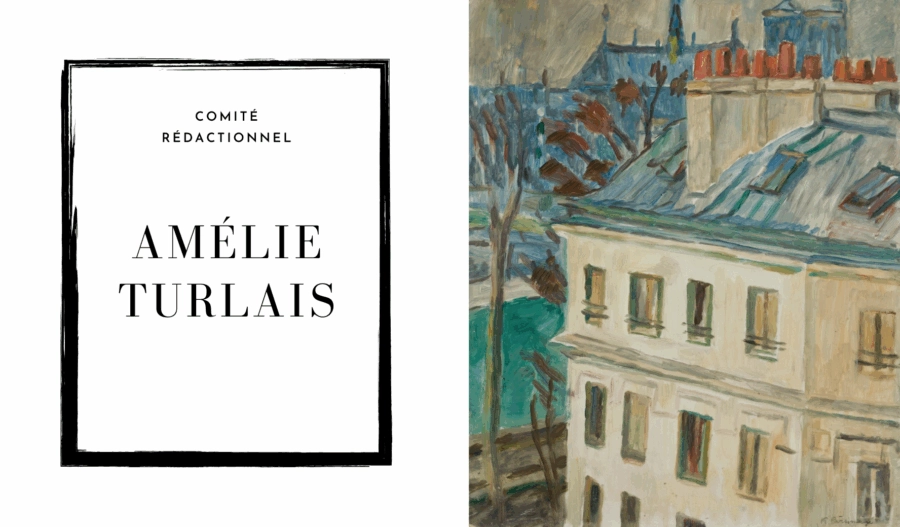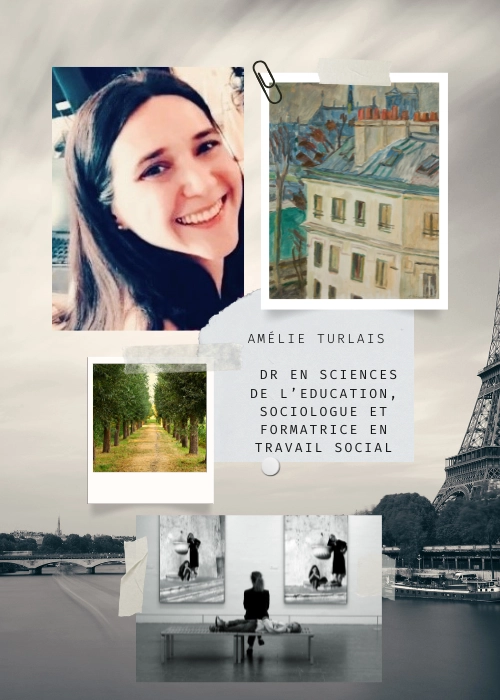Je pourrais vous parler pendant des heures de ma rencontre avec les tortues, de ma première plongée sous-marine, de ces instants suspendus dans les profondeurs de l’océan, à glisser en silence — si ce n’est le souffle de ma propre respiration — au milieu de la faune et de la flore marines.
Quelle sensation de liberté ! Mais ce n’est pas le sujet aujourd’hui. Je vais pourtant vous parler de liberté. Et aussi de contrainte, de régulation, à partir de mon expérience de formatrice, à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole.
Là encore, je pourrais vous décrire les cours en plein air, donnés assise au sol sur des nattes de paille, face à l’océan, entourée de cocotiers, et ces petits animaux, les makis, dont les grognements rappellent ceux du cochon. Mais je m’égare… Peut-être comme vous, suis-je déjà tournée vers les vacances d’été.
Revenons plutôt à ce qui m’amène.
L’un des modules que j’anime s’intitule : « Grandir au pluriel : de la diversité des modèles éducatifs à la coopération éducative ». J’y aborde les styles parentaux, les pratiques en protection de l’enfance, et surtout, la manière souvent inconsciente dont les travailleurs sociaux évaluent les familles à l’aune de normes éducatives implicites — des normes qui peuvent conduire à stigmatiser et marginaliser certaines familles, notamment celles issues de milieux populaires ou perçues comme « autres » (Gavarini, 2006; Martin, 2013).
Je vous dois de préciser que l’évaluation et la prise de décision en protection de l’enfance, c’est mon terrain, ma spécialité, mon « dada » (Turlais, 2016). Je pars de l’hypothèse suivante : si les professionnels prennent conscience de leurs biais dans l’évaluation, alors leurs décisions pourront devenir plus éthiques, plus justes, plus respectueuses des droits de l’enfant et de ceux des familles. Mais voyez-vous, ce jour-là à Mayotte, c’est moi qui me suis retrouvée confrontée à mes propres biais.
Mon propre regard de métropolitaine sur les pratiques parentales locales m’a rappelée à l’humilité. Une leçon vive sur la relativité des normes éducatives… et sur la nécessité de ne jamais cesser d’apprendre, même — et surtout — lorsqu’on est celle qui forme.
Ce matin-là, nous travaillions sur les styles parentaux. J’introduisais les travaux de Baumrind (1966), psychologue américaine qui, dans les années 1960, a proposé une typologie devenue classique.
Elle distingue trois grands styles éducatifs à partir de deux dimensions : le contrôle — c’est-à-dire la marge d’autonomie laissée à l’enfant — et la chaleur, soit la façon dont les parents réagissent face aux comportements de leur enfant, entre exigence et bienveillance.
Selon que ces deux dimensions sont élevées ou faibles, Baumrind identifie trois grandes catégories :
- Le style autoritaire, d’abord. Ici, le contrôle est fort, mais la chaleur est faible. Les parents imposent des règles strictes, attendent obéissance et conformité, valorisent le respect de l’autorité, des traditions. L’éducation repose sur un cadre ferme, souvent peu négociable.
- Le style permissif, à l’inverse, se caractérise par un contrôle faible et une chaleur élevée. Les parents font primer l’expression des désirs de l’enfant, évitent les sanctions, discutent, raisonnent, et cherchent à composer plutôt qu’à imposer. La règle, ici, c’est la souplesse.
- Et puis, il y a le style démocratique, ou autoritatif. C’est celui où les deux dimensions — contrôle et chaleur — sont élevées. Les parents expliquent, dialoguent, fixent un cadre mais laissent une marge de manœuvre. Ils soutiennent, accompagnent, responsabilisent. Ils reconnaissent les droits de l’enfant… sans pour autant s’effacer devant ses désirs.
Bien sûr, il s’agit de catégories, et elles ne rendent pas compte de la singularité de chaque famille. Mais j’apprécie cette classification car elle offre un cadre accessible. Elle permet non seulement d’interroger les pratiques parentales des familles que l’on accompagne, mais aussi de réfléchir au regard que nous portons, en tant que professionnels, sur ces parents.
Pour illustrer le style permissif, je m’appuie sur une observation faite durant le week-end.
Ce que je ne vous ai pas encore précisé, c’est que pendant ces trois semaines, je loge dans une maison en bord de plage — un véritable poste d’observation des dynamiques familiales, puisque les week-ends, les familles mahoraises viennent y pique-niquer en nombre, souvent pour la journée entière.
Juste en face de la maison, quelques arbres et arbustes forment une sorte de terrain de jeu improvisé. Et tout le week-end, j’ai vu — non sans une certaine angoisse — des enfants s’y aventurer : ils faisaient du surf, se balançaient sur des branches qui pliaient sous leur poids, grimpaient, sautaient, inventaient toutes sortes de jeux, entre six et quatorze ans, livrés à leur propre créativité.
À certains moments, cela ressemblait presque à une balançoire à bascule : deux enfants de chaque côté d’une branche, oscillant à plusieurs mètres du sol.
Alors, en formation, je raconte cette scène aux professionnels de la protection de l’enfance. Je leur dis mon inquiétude : tout le week-end, j’ai mentalement dressé la liste des conduites à tenir en cas de chute.
Que faire si l’un d’eux se blessait gravement ? La route était loin, l’hôpital de Mamoudzou à plus de deux heures, je n’avais sur place ni trousse d’urgence ni réseau fiable. Honnêtement, ces parents au style permissif ont été pour moi une source de stress intense. Aucun adulte ne surveillait vraiment.
Les enfants jouaient sur une aire qui n’en était pas une, sans la moindre norme de sécurité, dans une autonomie totale qui, pour moi, venue de métropole, relevait presque de l’imprudence. Et là, tous les stagiaires éclatent de rire. Un rire franc, chaleureux, qui ouvre la voie à un échange spontané, authentique.
Avec bienveillance, ils me partagent un autre point de vue. Ce que moi, avec mon regard de métropolitaine, j’interprète comme de l’imprudence ou un manque de contrôle parental, eux y voient tout autre chose : une manière de laisser l’enfant faire ses expériences, de se confronter au monde, à la gravité, au risque, à la liberté.
Ils me disent que non, les parents ne sont pas dans un « laisser-faire » absolu ou dans un désengagement éducatif. Simplement, les règles sont ailleurs. Elles ne passent pas nécessairement par la surveillance visuelle constante ou l’intervention adulte immédiate, mais s’expriment dans la confiance, la transmission implicite, l’expérience partagée. Beaucoup de ces parents ont eux-mêmes grandi dans les arbres, appris à jauger le danger avec leur corps, à écouter leurs sensations, à se relever seuls.
Ce moment d’échange m’a profondément marquée. Il m’a rappelé combien nos normes éducatives sont situées, culturelles, et combien il est facile — même en tant que formatrice, professionnel du social, du médico-social, du sanitaire — de projeter ses propres repères sans les interroger. Ce que les travailleurs sociaux m’ont appris ce jour-là, c’est à suspendre mon regard, à écouter ce que les pratiques parentales locales ont à dire, au-delà de mes catégories d’analyse. À accepter que d’autres formes de soin, d’éducation, de présence sont possibles… et pleinement légitimes.
Bibliographie :
- Baumrind, D. (1966). Effects of authoritative parental control on child behavior. Child Development, 37 (4), 887-904.
- Gavarini, L. (2006). Du contrôle social à la prédiction: évolution du regard sur l’enfance. dans Neyrand, G. et al., Familles et petite enfance. (pp. 93-108). Toulouse: ERES.
- Martin, C. (Dir.). (2013). Être un bon parent : une injonction contemporaine. Presses de l’EHESP.