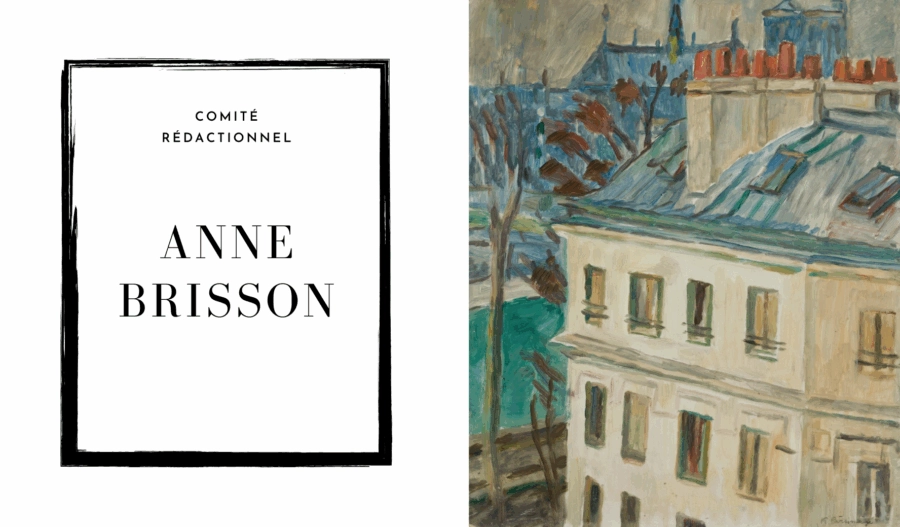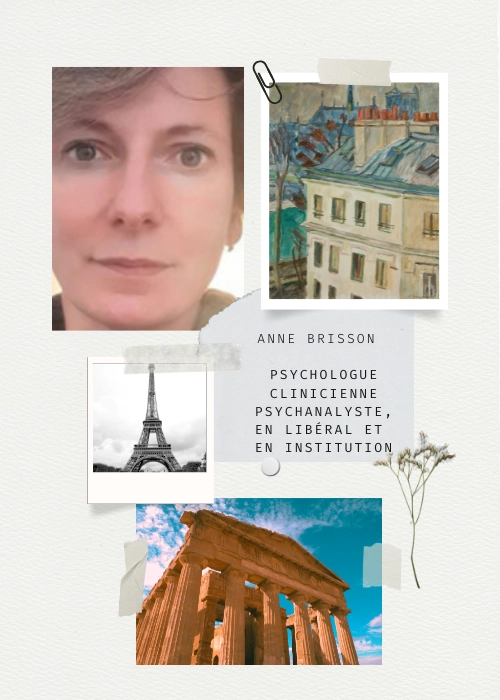Il me raconte qu’il est passé de consultant salarié à consultant indépendant. Il travaille parfois chez ses clients, mais le plus souvent à la maison. Il a profité de ces journées que l’on commence en pyjama dans la tiédeur du cocon, que l’on poursuit avec une sortie jogging après la première réunion du matin et avec la douche qu’on prend tranquillement à la pause déjeuner.
Mais il vient d’atteindre les limites du dispositif et il cherche un lieu de coworking : il ressent maintenant le besoin de sortir de chez lui pour mieux travailler et se sentir entouré d’autres êtres vivants… Je l’écoute et son récit fait émerger une chaîne associative de questions sur l’enfermement, l’isolement et l’aliénation dans la société en général et plus particulièrement en psychiatrie.
Le Covid et le confinement ont précipité l’extension du télétravail. Les entreprises se sont saisies de l’expérience sous la contrainte de l’épidémie pour construire de nouveaux cadres de travail. La bascule s’est faite de l’open-space à la chambre, sans transition ! Cette réorganisation des espaces de travail a donné l’impression de convenir à tout le monde. Les entreprises ont fait des économies sur leurs dépenses locatives. Les salariés ont gagné le temps qu’ils perdaient dans les transports, une souplesse d’organisation et une intimité douillette. Comme s’il n’était plus nécessaire de distinguer le privé et le professionnel, le dedans et le dehors.
Quelques jours plus tard, j’entends, une fois de plus, parler pour un enfant d’un « placement à domicile ». Je suis, une fois encore, saisie par le sentiment d’enfermement que me fait aussitôt ressentir cette formule. Le placement est à l’origine un mouvement vers l’extérieur, une démarche pour faire sortir un enfant d’un milieu familial qui est devenu une menace pour sa vie ou son développement. Avec le « placement à domicile », le dedans et le dehors se superposent : cette expérience, physiquement impossible, le serait-elle symboliquement ?
Je fais un détour rapide sur l’histoire du placement : après la seconde guerre mondiale, l’état remanie la protection de l’enfance. Les enfants qu’il faut protéger pouvaient être placés en institution, en famille d’accueil ou envoyés en colonie sanitaire au plein air. A l’époque, les séjours en plein air, encadrés par des religieuses, servaient à renforcer la santé des enfants les plus fragiles, offrir un cadre éducatif et moral, donner un moment de répit et de respiration loin de l’institution. Si le dedans est délétère pour un enfant, alors on le protège en le plaçant dehors, en le tenant loin de son milieu.
Réfléchir sur la question du placement met le pédopsychiatre Michel Soulé sur le devant de la scène. Il est l’un des premiers à intégrer une lecture psychanalytique des troubles psychopathologiques dans les dispositifs de protection de l’enfance, en soulignant l’intérêt de comprendre la souffrance psychique qui se manifeste à travers les comportements.
Il a permis de passer d’une approche simplement moralisante ou disciplinaire à une approche thérapeutique et compréhensive de l’enfant en danger. Il est connu pour avoir formé et influencé des juges pour enfants, des éducateurs, des assistantes sociales et des médecins pour les aider à repenser leur pratique à travers une approche plus humaine et psychodynamique. Le moins que l’on puisse dire c’est que Michel Soulé n’est jamais resté enfermé à l’intérieur des institutions de pédopsychiatrie, il s’est toujours intéressé à ce qui se passait à l’extérieur.
Son souci pour les enfants l’a fait traverser tous leurs cadres et lieux de vie. Il a travaillé sur les séquelles psychologiques induites sur l’enfant par des placements répétés, puis il a plaidé pour des placements les plus stables possibles même s’ils sont imparfaits, des adultes référents durables capables de tenir bon malgré l’intensité des troubles de l’enfant, une élaboration psychique du placement afin que l’enfant puisse comprendre et symboliser ce qu’il vit.
Revenons aux enfants qui sont actuellement « placés à domicile » : il s’agit un placement judiciaire ou administratif décidé par l’Aide Sociale à l’Enfance ou un juge des enfants, pour lequel l’enfant reste physiquement dans son domicile familial (psychiquement ailleurs… ?) tout en étant légalement confié à l’ASE, avec un suivi éducatif renforcé. Les raisons officielles sont les suivantes : le danger n’est pas immédiat ni majeur, le traumatisme de la séparation est évité, l’accent est mis sur le soutien à la parentalité. Ce qui ne se dit pas explicitement, c’est que le placement à domicile est sans doute moins un choix éducatif éclairé par les travaux attentifs à la construction psychoaffective des enfants d’un Michel Soulé qu’une réponse contrainte au manque de moyens.
Avec cette version récente du placement, c’est finalement la question du dedans/dehors dans le champ de la pédopsychiatrie qui m’intéresse le plus.
Sur ce thème, je vous propose une histoire institutionnelle : dans l’hôpital de jour où je travaille, nous accueillons des enfants de plus en plus jeunes qui présentent un fonctionnement psychique très immature.
Mes collègues « soignants du quotidien » sont plongés dans un bain clinique en deçà de ce que le langage permet comme structuration, largement dominé par les expériences sensorielles. Pour construire les projets de soins, je m’aperçois que les collègues évoquent de plus en plus souvent leur besoin d’extérieur : sortir pour aller à la bibliothèque, à la ludothèque, au judo, à la piscine…
Je dis bien leurs besoins car, même si les effets thérapeutiques des ateliers hors de l’institution sont indéniables pour les enfants, j’ai l’impression que les collègues anticipent collectivement et sans même le formuler la menace d’un enfermement en milieu archaïque.
Ils aménagent des temps et des espaces d’ouverture, de liberté, de mouvements dans le paysage. A la manière des anciens grecs qui commençaient leur journées de réflexions philosophiques en déambulant, les soignants du quotidien ont pensé et prévu le dosage entre le dedans et le dehors, aussi bien pour offrir différents cadres de soin aux enfants que pour garantir la survie de leurs compétences de soignants.
C’est pour moi le signe que l’équipe est en bonne santé psychique quand elle parvient à prendre soin de tous, les patients et les soignants, en tenant l’équilibre entre la contenance et l’ouverture.
Au temps des asiles, l’enfermement dans les institutions psychiatriques était une pratique dominante pour contenir les troubles mentaux, une stratégie qui reposait sur une logique de protection et de contrôle : il s’agissait de protéger la société des malades jugés dangereux mais aussi de protéger les malades de leur propre dimension autodestructive et donc d’eux-mêmes.
Des psychiatres comme François Tosquelles et Jean Oury et des penseurs comme Michel Foucault ont dénoncé les effets aliénants de l’enfermement parce qu’il déshumanisait les patients, réduisait leur autonomie, transformait la maladie en identité sociale (être enfermé parce que fou), renforçait la marginalisation à la place de soigner.
Jean Oury et Félix Guattari (collaborateurs à la clinique de La Borde à partir des années 50) utilisaient l’expression d’« asphyxie existentielle » pour décrire la souffrance psychique engendrée par la perte de sens et de possibilités d’être pour les patients enfermés dans un environnement aliénant. Il est bien difficile de respirer symboliquement dans des cadres, des institution ou des systèmes politiques rigides et contraignants qui imposent des normes, une obligation de productivité et qui produisent de l’isolement.
Née de cette remise en question, la psychothérapie institutionnelle a transformé les institutions de l’intérieur en les ouvrant sur l’extérieur. L’institution n’est plus un lieu d’enfermement, mais reste une base sécurisante et contenante à partir de laquelle les patients accompagnés par les soignants s’aventurent dans le monde. Comme une mère suffisamment bonne qui laisse son petit enfant s’éloigner en le tenant par le regard et qui l’accueille avec fierté quand il rentre de ses explorations et de ses conquêtes.
On pourrait croire que les nouveaux dispositifs de soins découlent de ce travail qui consistait à tricoter contenance, soin et ouverture. Malheureusement, de même que le télétravail est une expérience dont on revient parce qu’elle enferme et brouille les contours entre dedans et dehors, les soins ambulatoires, les placements à domicile, la fermeture des institutions au profit des interventions à l’école ou à domicile, sont autant de projets qui résultent davantage du manque de moyens que d’un bon équilibre entre les soins du dedans et du dehors.
Les enveloppes ne sont plus souples, ni aérées, elles sont bien au contraire trouées, déchirées, piétinées ou détruites.
Prendre soin de la souffrance psychique, que cela soit dedans ou dehors, peu importe si on peut se poser la question du sens et des effets de l’action psychothérapeutique indépendamment des injonctions économiques et sans faire semblant. Ce qui est nécessaire, c’est de garder vivant le besoin de création, d’ouverture et de nouvelles lignes de fuite. Ce qui compte c’est le possible, c’est ce qui ouvre un espace d’invention et de transformation. Comme le disait Gilles Deleuze, « Donnez-moi du possible, ou je suffoque » !