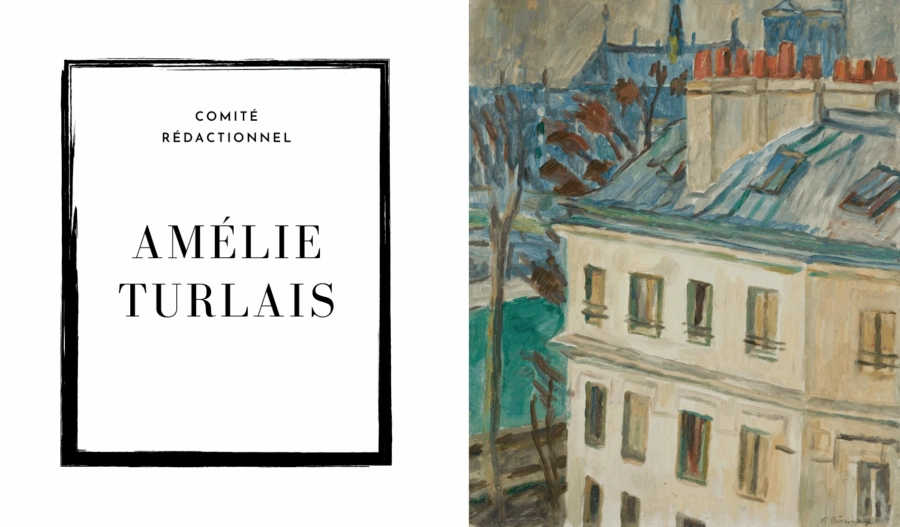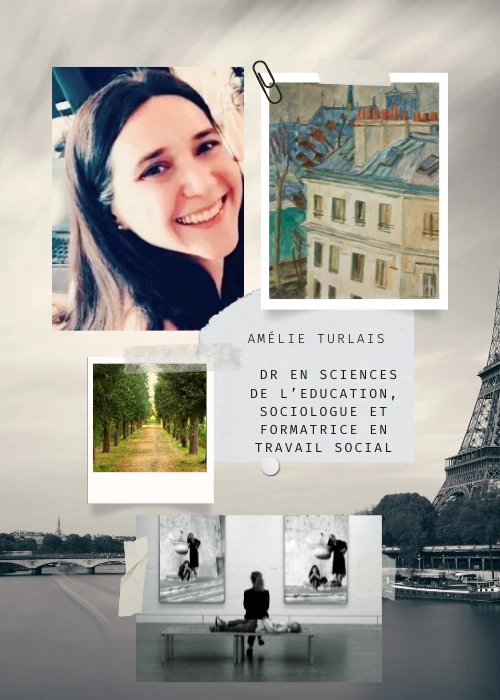Lors des temps informels, j’ai beaucoup été questionnée sur le quotidien d’une thésarde[1]. Encore aujourd’hui, une de mes réponses résonne : « Pendant mes années de thèse, je n’ai été qu’une tête. »
Une tête chercheuse, j’ai perdu la tête, je me suis pris la tête, je suis tombée mille fois sur la tête, j’ai voulu faire de nombreuses têtes au carré, beaucoup m’ont cassé la tête et comme vous pouvez vous en douter j’ai eu la tête qui tourne ; mais à la fin je crois que j’ai su garder la tête froide et en sortir avec une tête bien faite.
Mais voyez-vous, si je n’avais été qu’une tête avec une vie certes bien remplie qu’en était-il du corps ?
Ce corps, je l’avais éprouvé lors de mes années à l’hôpital de jour, pourquoi sur ce temps de présentation je n’avais pas réussi à me saisir de ce qu’il m’avait appris.
Le corps en travail social, en psychothérapie institutionnelle n’était-il pas un outil réflexif ? Si je ne m’en étais pas saisie à ce moment, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous dans cette newsletter, les ébauches de ma réflexion.
Pour construire ma pensée, je partirai de quatre observations faites avec différentes casquettes : en tant que formatrice de futures éducatrices de jeunes enfants, en tant qu’animatrice d’analyse de pratique, en tant que soignante et en tant que chercheuse.
1re observation : Les étudiant.es EJE, le mouvement et les douleurs du corps
Dans mon statut de formatrice auprès de futur.es éducateur/rices de jeune enfant, j’interviens entre autres sur les enjeux de la communication non verbale.
Ma pratique pédagogique s’appuie sur la maïeutique, et une approche active, de la découverte. Je fais le pari que c’est en mettant les étudiant.es en action, qu’ils/elles peuvent s’engager dans une réflexion sur un sujet donné.
Aussi, en début de mois, je commence un cours que j’ai tout simplement intitulé : Le corps en travail social. Pendant plus d’une heure et demie, les étudiant.es ne sont pas assis.es derrière une table mais déambulent dans la salle, marchent, vite, lentement, seuls, à deux, à quatre, à huit.
Ils/elles jouent en se mouvant, en s’exprimant non pas par les mots mais par leurs gestes. Elles/ils apprennent à se regarder, à lire les expressions de l’autre, des autres.
Au bout de 45 minutes, certains signes de fatigue se font sentir, certaines têtes tournent, certains genoux deviennent sensibles, certains dos deviennent douloureux.
J’observe les tenues, les chaussures, ils/elles savaient que nous allions être en mouvement cet après-midi-là. Certain.es sont en claquettes, d’autres en Crocs. A cette vision mon propre corps devient douloureux.
2e observation : Les douleurs du corps comme un allant de soi du quotidien en crèche
Depuis quelques années, j’anime des groupes d’analyse de pratiques en crèche. Il est régulier que les professionnel.les lors de ces temps de parole abordent leurs douleurs au corps : mal aux genoux, mal au dos, mal aux bras.
J’aime bien alors travailler avec elles sur les expressions en lien avec ces tensions corporelles : en avoir plein le dos, être sur les genoux, porter à bout de bras.
Pourtant, quand elles me racontent leur quotidien, je vis avec elles à quel point leur corps est mis à rude épreuve. Être EJE, c’est être en mouvement constant, au sol, à hauteur d’enfant, se lever pour se rasseoir, se plier pour ramasser, s’étirer pour ranger en hauteur, porter les enfants, les asseoir, les endormir.
Quand j’aborde avec elles, les techniques pour s’asseoir, pour porter, j’ai alors l’impression d’une grande traversée du désert. Je crois qu’aucune ne sait jamais poser la question de comment faire avec son corps, comment celui-ci est un outil de travail.
3e observation : Maxime et mon écharpe : Le vacillement d’une chercheure que l’on fait soignante[2]
Mardi, je ne participe pas à la prise en charge des enfants ce soir. 16h30 retentit par la sonnette qui s’agite. Ce bruit lancinant me sort de ma bulle, cette bulle qui m’enveloppe.
La douceur du vent, la légèreté des feuilles se percent. La dureté et la lourdeur des pas me ramènent à une autre temporalité de l’hôpital de jour. 16h30, l’heure du goûter, les premiers enfants arrivent.
Je me détache de ma cachette, de la lecture des dossiers, et je me jette dans l’arène. J’observe ces enfants, ces adultes. Maxime finit de me soustraire de ma légèreté, mon observation devient participante.
Je suis chercheure, je suis soignante. Mes racines sont fragiles, mais je construis mes branches. Entre les deux, je vacille. Les soirs où je suis soignante, Maxime m’ignore de « ta gueule ».
Les soirs où je suis chercheure, il s’agrippe à moi. Ce soir, il s’agrippe à mon écharpe. Du haut de ses 7 ans il me déracine.
Paul me fait reprendre pied. Il est maintenant 17h00, les enfants entrent dans leur groupe et je retrouve mon terrier. 20h00, je ne suis plus dans les murs de l’hôpital de jour, je n’entends plus les pas des enfants et pourtant je ne peux pas les oublier, Maxime m’a laissé une marque à mon cou.
4e observation : Désexualiser son corps pour être soignante
Au fil du temps passé à l’hôpital de jour lors de mes années de thèse, mon style vestimentaire s’est transformé les soirs ou j’étais soignante. J’ai tout d’abord perdu les grandes boucles d’oreille, puis j’ai arrêté de mettre des chaussures à talon pour les troquer contre des baskets.
Je suis aussi passée de jupes courtes, à jupes longues pour finir en jeans. Les enfants à l’hôpital de jour m’ont appris à m’habiller en tant que soignant (non, je n’ai pas oublié le E, à la fin de soignant).
Par leurs réponses verbales et physiques, ils n’ont jamais manqué de venir sanctionner un comportement qui me déplaçait en tant qu’adulte dans une posture autre que celle de soignant. J’ai très vite compris que pour les enfants les signes de féminité déplaçaient la soignante dans un autre statut, difficilement acceptable pour eux, celui de femme.
Les boucles d’oreilles longues, les bracelets, les jupes devaient rester au placard, ils dérogeaient pour les enfants à la fonction de soignant.
Qu’est-ce que le corps nous apprend sur nos pratiques ?
Le corps est-il un « outil » de travail ? Le corps est-il « une marchandise » ?
Je ne m’engagerai pas dans ce débat ici, de grand.es auteurs/rices (Héritier, Despentes, etc…) le nourrissent bien mieux que je ne pourrais le faire.
Cependant, toutes ces observations m’amènent à penser le corps comme un « outil » de médiation, de création, de support, de travail. Souvent dans nos métiers du social et du sanitaire, il est négligé, peu considéré, peu respecté.
Parfois, nous oublions nous-même d’en prendre soin. Parfois, nos institutions le maltraitent. Parfois, ce sont les autres qui y laissent des traces. Parfois, un contexte en dessine une autre image.
Nos métiers du social et du sanitaire transforment notre corps. Si vous avez l’occasion de rencontrer la personne avec qui je partage ma vie, vous pourrez constater en quoi son métier d’EJE a modelé ses bras et sa force.
Si vous avez l’occasion d’échanger avec les étudiant.es que j’accompagne, elles pourront vous partager comment se réapproprier son corps et comprendre celui des autres dans leurs pratiques professionnelles.
De mon côté, mon corps, depuis quelques années, j’en fais un agent réflexif. Les traces que m’ont laissé les enfants de l’hôpital de jour m’ont permis de mieux comprendre ce qu’ils vivaient, ce qui se jouait à ces instants pour eux.
Être à l’écoute de son corps et de ses éprouvés n’est-ce pas avoir accès à de nouvelles clefs de compréhension d’analyse de nos pratiques professionnelles ?
D’ailleurs, vous, qu’est-ce que vous apprend votre corps de vos pratiques, et de votre métier ?
[1] Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, je vous recommande la lecture de « Carnet de thèse » écrit et mis en dessin par Thipaine Rivière.
[2] Ce texte a été écrit lors d’un atelier d’écriture et essaye de raconter poétiquement un vécu en hôpital de jour lors de ma collecte de données pour mon travail doctoral.
♣ Amélie Turlais