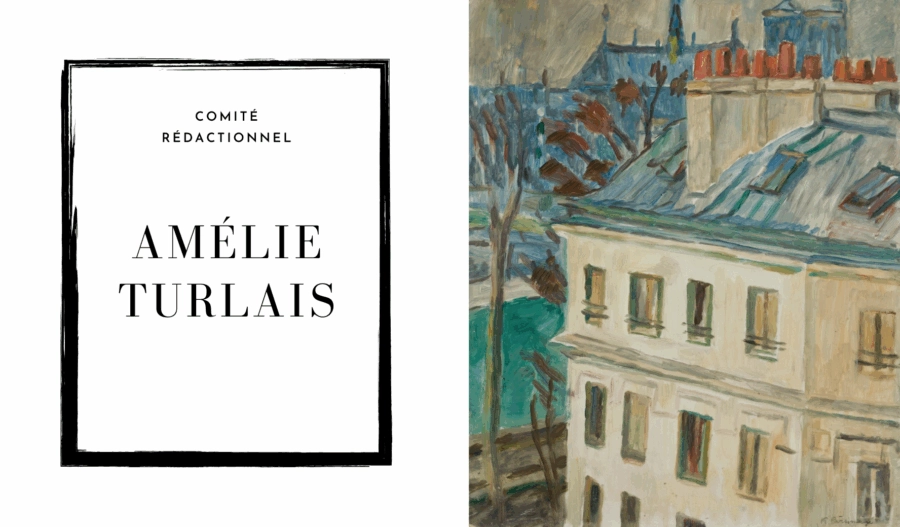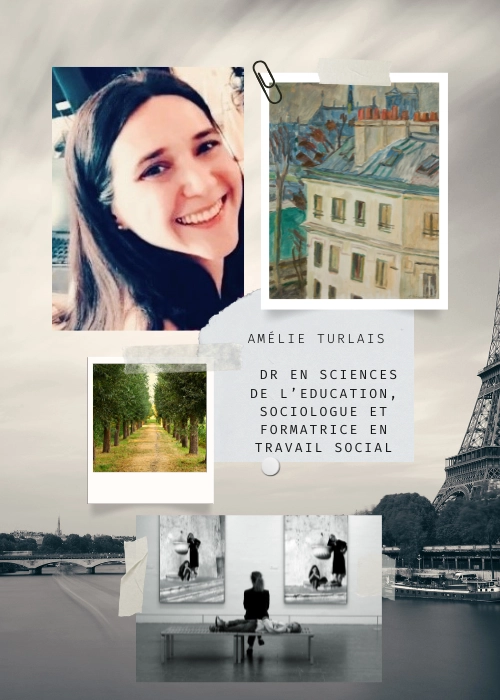Avec ma casquette de sociologue, je me suis dit que je pourrais parler de la socialisation primaire, de la socialisation secondaire en prenant appui sur les travaux de Berger et Luckmann (1966), et aussi de la socialisation plurielle en me replongeant dans les écrits de Lahire (1998), de son idée d’acteur pluriel et de processus de socialisation contradictoires dans des sociétés ultra-différenciées.
Au fil de mes pérégrinations, certains souvenirs de ma vie étudiante me sont revenus, en particulier des échanges entre sociologues et philosophes en herbe. Sans en avoir une grande connaissance, j’ai pensé aux travaux de Deleuze (1968), l’idée qu’être serait le devenir, être ne serait pas fixe, ce serait un processus d’affirmation.
En me plongeant dans cette théorie, comme toujours ma casquette clinique a pris le dessus et je voudrais vous partager un moment de vie qui parle de tout cela. Si depuis mes études de sociologie j’ai beaucoup changé, je crois que ce n’était que pour devenir pas autre, mais plus finement et harmonieusement l’Être que j’ai toujours été.
En 2019, je travaille à l’ONPE en remplacement d’un congé parental sur une période de six mois. Je suis chargée de réaliser une revue de littérature, ou tout de moins d’en poser le cadre et les limites. Le thème est herculéen : les violences sexuelles sur mineurs.
Pendant les trois premiers mois, sans vraiment comprendre pourquoi, tous les matins, dès que mon ordinateur s’allume j’ai envie de vomir. Les lectures sur la prostitution des jeunes, la pédopornographie dès le plus jeune âge, l’inceste sont en train de me rendre malade.
Pourtant, je n’en suis pas à ma première expérience de recherche dans le champ de la protection de l’enfance. Dans mon parcours : de soignante, de chercheuse, de formatrice, j’ai déjà eu à faire face à cette thématique des violences sexuelles sur mineurs.
Cependant, dans ce travail de revue de littérature, quelque chose est différent.
Je sens bien que je suis ulcérée sur un plan figuré – et après consultation auprès de ma médecin – sur un plan physiologique. Les premiers temps, je ne le comprends pas, cela m’inquiète, moi qui me présente comme chercheuse dans le champ de la protection de l’enfance et de la santé mentale infantile, qui suis-je si les sujets auxquels je me confronte au quotidien me rendent malade ?
Ma première hypothèse est que je suis en train de m’essouffler, je n’ai plus la force d’affronter cette partie de l’humain sombre et révoltant. Seulement, quelques années après, j’entendrais parler du traumatisme vicariant. Bien sûr, depuis mon entrée en thèse, je me suis créée des espaces d’élaboration : une supervision, une thérapie et une pratique régulière du yoga.
Après l’exercice de la thèse qui avait beaucoup sollicité la tête, il m’avait fallu renouer avec le corps. Le yoga m’avait permis cela. Certainement, est-ce pour cela que je ne suis pas passée à côté des signes de ces vomissement répétitifs qui chaque matin me rappelaient que quelque chose dans mon quotidien était indigeste.ga. Est-ce le traitement de l’ulcère, la décision de ce rendez-vous en terre, ou bien les deux, en tout cas à partir de ce moment précis, les vomissements se sont peu à peu estompés.
Aussi, un jour en plein mois d’avril, pendant ma pause déjeuner, ma folie me pousse à acheter un billet pour l’Inde. En un coup de clic et quelques euros dépensés sur mon compte en banque, me voilà prête à partir du 1er septembre au 30 septembre, à Rishikeh. Sur ce qui pourrait paraître un coup de tête, je venais de décider d’aller faire un 200h de yoga.
Puis arrive septembre, dans le voyage qui durera plus de 24h de Paris à Rishikesh, les questions se percutent dans ma tête : qu’est-ce que je suis en train de faire ? qu’est-ce que je pars chercher si loin ? est-ce que je veux devenir professeur de yoga ? qu’en est-il de mon statut de chercheuse ? J’ai peur de me perdre et pourtant j’ai l’impression que je pars pour me trouver me retrouver.
Lors de cette formation, j’ai une chance incroyable de rencontrer des jeunes femmes qui viennent du monde entier avec qui nous échangeons beaucoup sur le sens de la vie et aussi de rencontrer un professeur de philosophie indienne qui est aussi diplômé en psychologie.
Sa manière d’aborder les textes anciens et de les mettre en lien avec les maux de notre société contemporaine font de chaque jour de cette formation une source de réflexion, d’émerveillement, de réflexivité et de retour aux sources.
J’étais partie pour tester les limites de mon corps physique (lever : 5h, coucher : 21h et 10 heures de pratiques de yoga intensif, de cours de philosophie, de cours d’anatomie, de travail respiratoire…) et je me retrouvais dans mon identité de chercheuse qui veut comprendre le monde, l’étudier n’ont pas seulement pour le dépeindre mais pour aussi avoir une action sur lui.
J’étais partie à l’autre bout du monde avec une envie de changement, de devenir quelqu’un d’autre, de fuir un monde professionnel qui me rendait malade et en fait chaque jour je me rapprochais un peu plus de mon essence personnelle et professionnelle : pourvoir agir sur la société et accompagner les autres dans cette société si complexe.
Plus les journées passaient plus je comprenais certaines choses dans le détail : mon travail de revue de littérature sur les violences sexuelles m’avait rendue malade parce que j’avais du mal à y voir le sens. Dans ma vie professionnelle, face à certaines noirceurs de ce monde pour y jouer un rôle j’avais besoin d’être sur le terrain, d’échanger avec les enfants, les parents, les professionnels, de les accompagner pour avancer dans les pratiques éducatives, parentales, professionnelles.
De ce rendez-vous en terre inconnue, la rencontre que j’ai faite est celle de moi-même. J’ai compris que je n’étais pas un être constant, que je changerai tout au long de la vie, de mes expériences, de mes rencontres. La société avait son influence, à moi d’en être consciente pour affirmer mes valeurs et celle que j’étais.
Bibliographie
Berger, P., Luckmann, T. (2012 [1966]). La construction sociale de la réalité. Paris : Armand colin
Deleuze, G. (1968) Différence et répétition. Paris : Presses universitaires de France,
Lahire, B. (1998). L’homme pluriel. Les ressorts de l’action. Paris : Nathan
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de janvier 2025