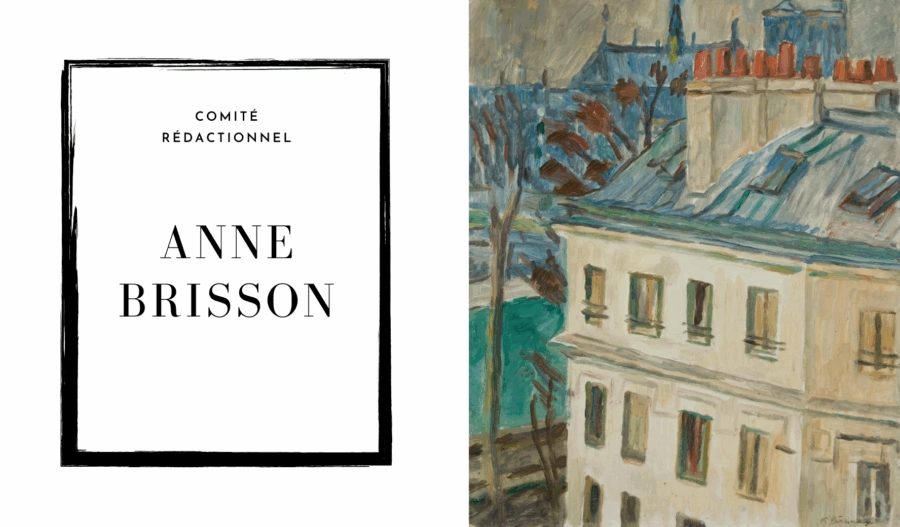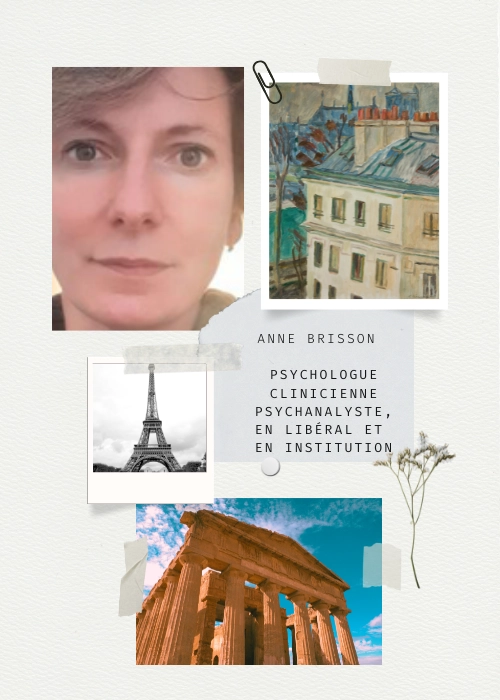Je me demande d’ailleurs comment j’aurais répondu à la consigne avec mon Moi âgé de 17 ans. Qui étais-je à cette époque ?
Suis-je encore aujourd’hui capable de retrouver cette couche archéologique de ma propre construction ? Peut-on remonter le fil de son propre développement, penser à rebours et retrouver la personne que l’on était adolescent ? La saluer, lui serrer la main, la congratuler pour avoir été le bon socle qui a permis la croissance de la personne qu’elle est devenue…
Lui faire quelques reproches peut-être sur la lenteur, sur la résistance aux changements, sur une certaine rigidité, sur des choix qui auraient peut-être modifié la suite de la trajectoire…
Le cycle même de la vie, de la naissance à la mort, nous impose le changement. La poussée du développement, de la maturation, du vieillissement implique des transformations quotidiennes, même si elles ne sont pas toutes perceptibles, aussi bien sur le plan somatique que psychique. Au mieux, chaque jour, on perd des neurones, mais on gagne en sagesse ! Cela me fait penser à tous les témoignages de personnes sur les réseaux sociaux qui racontent leur quête pour devenir une meilleure version de soi-même…
Il existe même une série télé qui a cette formule pour titre et dont le synopsis résume parfaitement les changements que notre société moderne nous propose à foison : Blanche Gardin est une humoriste à succès, mais elle souffre d’un problème digestif chronique. Elle consulte un naturopathe qui lui explique que son symptôme est le résultat de l’auto-dérision qu’elle pratique sur scène. Blanche prend conscience que la seule guérison possible est de se montrer bienveillante à l’égard d’elle-même.
Elle prend la décision d’arrêter son métier d’humoriste et s’engage sur la route du développement personnel, du bien-être et de la recherche spirituelle afin de devenir une meilleure version d’elle-même. Il paraît que la série contient plein d’écueils, on va donc se contenter du synopsis qui nous dit déjà beaucoup sur ce qui nous conduit à souhaiter le changement et sur les moyens qu’on se donne pour l’atteindre.
Les philosophes de l’antiquité, pour ceux qui font l’hypothèse que le changement est possible (et utile), vendaient un autre rêve : se connaître soi-même plutôt que de devenir quelqu’un d’autre. « Connais-toi toi-même » est une maxime gravée à l’entrée du temple d’Apollon à Delphes. Elle est utilisée à plusieurs reprises dans les dialogues de Platon, Socrate lui donne valeur de socle dans la construction intellectuelle et morale de chaque individu.
C’est une invitation à l’introspection, car pour Socrate il s’agit de trouver/retrouver le savoir en nous-mêmes, au moyen d’un dialogue entre l’âme et elle-même, ou entre le maître et l’élève. C’est d’ailleurs un tournant dans l’histoire de la philosophie qui fait résonance avec l’introspection psychanalytique, car cela fait de la conscience intérieure l’instance de la vérité et de la décision : l’esprit universel unique n’est plus loin au-dessus de nous, mystique et inatteignable, mais il se trouve accessible à l’intérieur de l’homme lui-même.
D’autres philosophes grecs font l’hypothèse que le changement n’existe pas : Parménide, dans son poème Sur la nature, estime que l’existence est une et immuable, ce qui permet d’ailleurs de résister à l’effritement du néant. L’être est unique, éternel et indivisible, ce qui signifie qu’il ne peut pas se transformer ou être soumis à l’altérité.
Le changement n’est qu’illusion produite par les différentes positions que nous avons dans le temps et dans l’espace. Cette pensée radicale remet en cause une représentation du monde fondée sur les sens, l’idée de mouvement et de transformation (qui ne seraient que tromperies) et présente la vérité comme uniquement accessible par la raison. Si l’on poursuit la réflexion avec Parménide, alors il va être compliqué de parler de changement !
Je vous propose d’enchaîner avec les philosophes empiristes anglo-saxons qui sont les premiers à avoir travaillé la question de l’identité personnelle (et du changement) : John Locke au 17e siècle et David Hume au 18e. Dans le chapitre 27 de son Essai sur l’entendement humain, Locke traite de l’identité personnelle et de son rapport à la conscience et à la mémoire.
Pour commencer, il considère qu’une personne est un être pensant qui se reconnaît comme unique à travers les variations de temps et de lieux. Le sentiment d’identité personnelle se constitue à partir de la conscience. Ainsi ce n’est pas la continuité du corps qui fait l’identité d’une personne, mais la continuité de sa conscience qui est le lieu où se rassemblent les perceptions. Puis c’est la mémoire qui met en œuvre sa capacité à lier les perceptions passées aux perceptions présentes.
Pour Locke, je suis une même et seule personne parce que je me souviens de mes actions, de mes perceptions et de mes expériences passées. Mais alors qu’en est-il de l’oubli et de ses conséquences sur l’identité personnelle ? Si l’on oublie totalement une portion des souvenirs de notre vie, peut-on dire que l’on est malgré tout la personne qui a fait les actions oubliées ?
Pour répondre à cette question, Locke distingue la personne de l’individu : on n’est pas la même personne, car on n’a pas conscience d’avoir réalisé ces actes ou d’avoir eu ces pensées. En revanche on est bien l’individu qui les a réalisées. L’individu est une unité corporelle ou spirituelle, tandis que la personne est constituée par la continuité de la conscience.
C’est pourquoi, quand on regarde des photos de notre enfance, on constate que l’on a changé de corps, mais on n’a pas le sentiment d’être une autre personne, même si parfois la mémoire, lorsqu’elle effectue son travail de compilation d’expériences, nous laisse pour quelques secondes ou quelques minutes dans un certain flottement identitaire. La conscience est un contenant, une sorte de foyer de synthèse, qui rassemble, associe, organise nos expériences successives, ce qui donne à chacun le sentiment d’exister, quels que soient les changements intérieurs et extérieurs.
David Hume va encore plus loin que Locke du côté des sensations et des expériences comme réservoir bouillonnant de l’identité. Dans le chapitre « De l’identité personnelle », issu de son Traité de la nature humaine, il affirme que les hommes « ne sont rien qu’un ensemble, une collection de différentes perceptions qui se succèdent les unes aux autres avec une inconcevable rapidité et qui sont dans un flux et un mouvement perpétuels.
Nos yeux ne peuvent tourner dans leurs orbites sans faire varier nos perceptions. Notre pensée est encore plus variable que notre vue, et tous nos autres sens et toutes nos autres facultés contribuent à ce changement. Il n’est pas un seul pouvoir de l’âme qui demeure inaltérablement identique peut-être pour un seul moment. L’esprit est une sorte de théâtre où différentes perceptions font successivement leur apparition, passent, repassent, glissent et se mêlent en une infinie variété de positions et de situations.
Il n’y a en lui proprement ni simplicité en un moment, ni identité en différents moments. La comparaison du théâtre ne doit pas nous induire en erreur. Ce sont seulement les perceptions successives qui constituent l’esprit. Nous n’avons pas la plus lointaine notion du lieu où ces scènes sont représentées. Ni des matériaux dont ils se composent ». L’identité personnelle est une fiction de l’esprit, une construction qui repose sur la mémoire et les connexions qu’elle peut faire entre toutes les expériences.
Et c’est ainsi que la pensée de Hume est le terreau dans lequel pousse l’idée plus contemporaine d’une identité narrative, telle que Ricoeur l’a ensuite développée : pour construire notre identité, nous produisons des récits qui donnent du sens et de la cohérence aux événements de notre vie qui n’en ont pas par eux-mêmes.
Chaque individu change dans un monde lui aussi en perpétuelle mutation. D’une manière générale et sans même s’en rendre compte, on s’ajuste tous les jours à nos propres changements mais aussi à ceux des autres et de l’environnement : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », disait Héraclite pour qui le changement est la seule constante de l’univers.
Toutes ces modifications nous enrichissent, nous refaçonnent, nous bouleversent, nous font parfois vaciller, nous désorganisent si nous sommes à ce moment-là trop fragiles pour les traverser. Mais je suis convaincue, avec Hume qui estime que l’identité est une fiction (nous changeons sans cesse) et avec Locke, qu’il existe bien une identité relativement stable grâce à l’unité contenante de la conscience et aux capacités de liaison de la mémoire.
Le changement ne contient ni la promesse, ni la menace de devenir quelqu’un d’autre, mais nous confronte souvent à un sentiment que je ne peux qualifier ni de « plaisant », ni de déplaisant » : la nostalgie !
Dans cette tonalité, je partage avec vous les réflexions d’Amélie Nothomb dans son livre L’impossible retour. Elle fait le récit de son dernier voyage au Japon où elle est née mais qu’elle a quitté, et les résonances avec d’autres séjours dans ce pays très important pour elle.
A l’âge de 53 ans, elle visite avec une amie le temple des cloches qu’elle avait découvert avec son père quand elle avait 5 ans et revisité quand elle avait 22 ans.
Elle est submergée par la nostalgie et raconte : « Papa, quel est notre problème ? Et pourquoi me l’as-tu légué ? Que suis-je censée faire de ces émotions tentaculaires ? Si au moins je savais le temps de ma souffrance !
Afin d’en supporter l’idée, je prends la seule décision possible : il n’y a pas de temps. Le temple des cloches le prouve : il n’a pas changé d’une poussière entre 1972 et 1989. Allons jusqu’au bout du raisonnement : moi non plus, je n’ai pas changé. Pour être plus précise, je me reconnais mieux en 1972 qu’en 1989. Me comparer à une jeune femme de 22 ans me semble plus absurde que me parangonner à l’enfançonne. Cette dernière m’habite profondément ».
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de janvier 2025