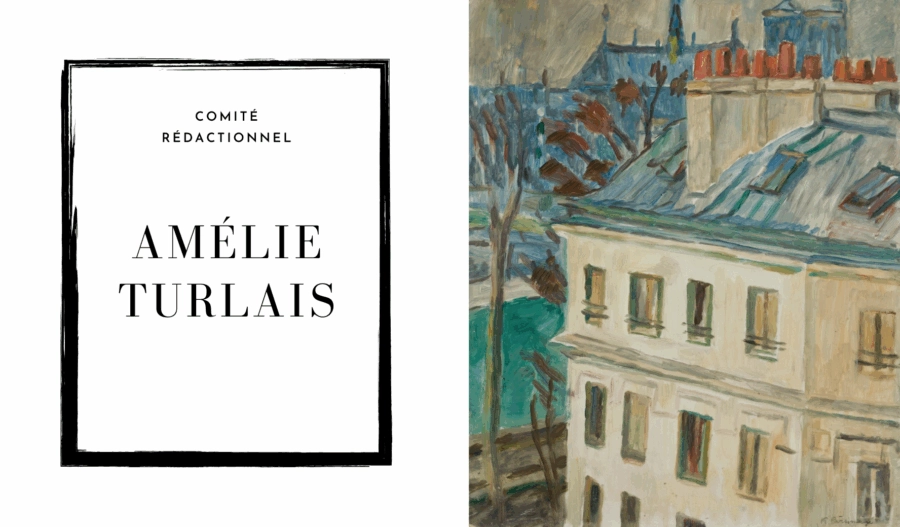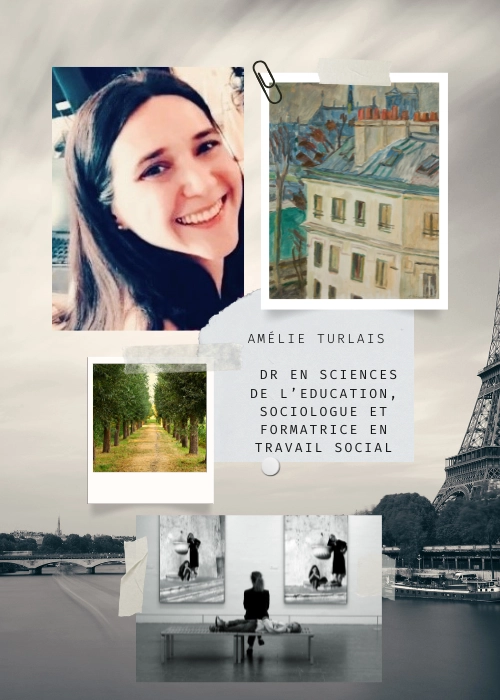Je n’avais en ma possession que le livret d’accueil avec des adresses qui dataient pour les plus anciennes de 1981 et pour les plus récentes de 2001. Nous étions en 2011 !
En parcourant les pages blanches, Facebook (seul réseau social à ce période), et en réseautant dans le quartier, il a été possible de reprendre contact avec certains.
Trop peu pour d’un point de vue scientifique exploiter ces données, mais assez pour qu’un souvenir me soit resté et marque régulièrement mes réflexions que ce soit dans mes accompagnements de pratiques professionnelles ou dans la recherche.
Ce souvenir est celui d’une femme que je reçois pour un entretien de recherche. Elle a été l’une des premières patientes de l’hôpital de jour.
Quand elle arrive, ces yeux sont en mouvement constant, elle regarde partout, elle semble chercher ses souvenirs. Ses premières paroles sont de me faire savoir ce qui a changé et ce qui est resté identique dans les locaux.
Elle dit avoir la quarantaine, elle me renvoie l’image d’une femme proche de la retraite. Moi si sensible à la posture du corps, je la perçois voutée, dans une apparence qui dans mon regard est empreinte d’un manque de prendre de soin, d’hygiène.
Lors que nous échangeons, je dois à plusieurs reprises reformuler mes paroles, mes questions. Ses phrases sont minimales : sujet, verbe, complément. Je ne sais comment retranscrire le son, le rythme de ses paroles : hachées, saccadées.
Peut-être a-t-elle un retard cognitif ? En tout cas, je sens que l’émotion est forte. Une vague de souvenirs qui vient la submerger. L’entretien se déroule, elle me parle d’elle maintenant, de ses souvenirs à l’hôpital de jour, pourquoi elle a voulu faire cet entretien.
Elle aurait aimé revoir les soignants, mais personne n’est présent sur le créneau où je la reçois. Puis la conversation touche à sa fin, je la raccompagne, je lui dis au revoir. Je lui dis ce qu’il a été convenu quand nous avons préparé le protocole de recherche : si cet échange vient la secouer ces prochaines semaines, ces prochains mois, elle peut reprendre contact avec moi et je pourrais la mettre en lien avec un psychologue.
Cependant, quand elle part, je ne sais quoi penser de cet entretien. Les personnes participant à des entretiens de recherche souvent mettent en avant son effet cathartique. Parfois, cela est comparé à une forme de contre don.
Mais ce jour-là, je me demande ce que pour la recherche je suis venue réveillée chez cette femme.
Se souvenir ou ne pas se souvenir, that is the question si j’ose paraphraser Shakespeare.
Dans mon cercle proche, souvent nous pouvons dire : à mettre sous le tapis, on risque de se prendre les pieds dedans et de chuter. Mais voyez-vous, les personnes que je côtoie sont majoritairement issues de la classe moyenne (haute).
Leur dotation en capital culturel et scolaire est plutôt élevée. Le capital économique n’est certes pas celui de la grande bourgeoisie mais leur permet de s’engager financièrement dans un suivi psy, ou une analyse.
Il me semble que nous sommes « équipé.es » socialement, pour accueillir nos souvenirs, mettre en mots nos éprouvés, les élaborer pour les transformer. Mais en est-il de même pour tout le monde ?
En est-il de même pour cette femme ? Bien que clinicienne, je suis sociologue, aussi la prise en compte de la dynamique sociale n’est jamais loin dans mon analyse. Je repense alors aux travaux de Castel (1995) qui met en avant le risque d’une régulation duale de la sphère privée.
Je m’explique… Dans nos sociétés hypermodernes, caractérisées par l’individualisme et l’indépendance, chacun, chacune est encouragé.e à être libre et autonome y compris dans la sphère privée et intime.
Cependant, d’après Commaille (2006) nous ne sommes pas toutes et tous égaux envers cette « démocratisation de la vie personnelle ». Certaines personnes seraient plus vulnérables à cette nouvelle tendance de l’autonomisation de la sphère privée.
Mon cercle proche, moi, certainement vous lecteurs et lectrices, nous possédons les bonnes ressources pour s’auto-déterminer, être des individus libres et responsables ; pour s’inscrire pleinement dans cette nouvelle tendance à l’auto-régulation et à la mobilisation de nos ressources.
Mais quand est-il des ressources des enfants, des adultes que nous accompagnons chaque jour ? D’après Castel (1995, 768) nous sommes entrées dans une nouvelle forme de bipolarisation : celle d’une « bipolarisation entre ceux qui peuvent associer individualisme et indépendance parce que leur position sociale est assurée, et ceux qui portent leur individualité comme une croix parce qu’elle signifie manque d’attaches et absence de protections ».
Aussi, en m’autorisant quelques raccourcis pour répondre au format de cet écrit, je voudrais émettre l’hypothèse de l’émergence d’un nouveau capital source d’inégalités, celui de l’accès à la réflexivité.
Je n’ai pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit, mais je partage avec vous mes doutes face à nos actions qui peuvent faire ressurgir des souvenirs « traumatiques » auprès de personnes qui n’ont pas engagé nécessairement avec nous un travail thérapeutique.
N’est-ce pas le cas des professionnels, des parents, des étudiants que nous accompagnons ? Un accompagnement qui n’est pas nécessairement thérapeutique. Un accompagnement qui est parfois formatif sur des pratiques professionnelles, sur des pratiques parentales.
Mais si je suis sociologue, je suis aussi clinicienne, aussi je ne peux pas oublier que ce qui est une affaire privée (notre psyché) a un impact sur nos pratiques sociales.
Alors comment faire ? Quoi faire ? Comment accueillir le « souvenir » quand nous sommes dans un statut autre que celui de soignant ?
Ah, Oury et la psychothérapie institutionnelle sont si aidants sur ce sujet. Le statut est-il si important dans ces conditions ? Est-ce que ce qui prime n’est pas la fonction que la personne rencontrée nous donne ?
J’aimerais vous répondre oui, parce que je le pense sincèrement. Mais trop souvent, je me retrouve dans des positions où il m’est rappelé (par des personnes en position d’autorité hiérarchique) que je ne suis QUE chercheuse, je ne suis QUE formatrice, je ne suis QUE…
Pourtant, moi je pense que je suis chercheuse-soignante, je suis formatrice-soignante, je suis …-soignante. Parce que peut-être que face à cette bipolarisation de la société, à cette nouvelle inégalité d’accès à la réflexivité, l’accompagnement quel qu’il soit est thérapeutique.
Le « souvenir » ressurgira à un moment donné ou à un autre ; alors quand celui d’un parent, d’une étudiante, d’un professionnel fait surface en ma présence si la personne m’y autorise je revêts ma casquette de soignante quitte à, par la suite, réorienter vers des personnes avec des compétences plus adéquates que les miennes.
Je m’autorise cette sortie de cadre, parce que j’ose penser que celle-ci garantit la solidité des liens avec les personnes que nous accompagnons.
Bibliographie
Castel, R. (1995). Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris : Fayard.
Commaille, J. (2006). L’économie socio-politique des liens familiaux. Dialogue, no 174(4), 95-105.
🎁Consulter l’intégralité de la newsletter TEMPO de février 2025